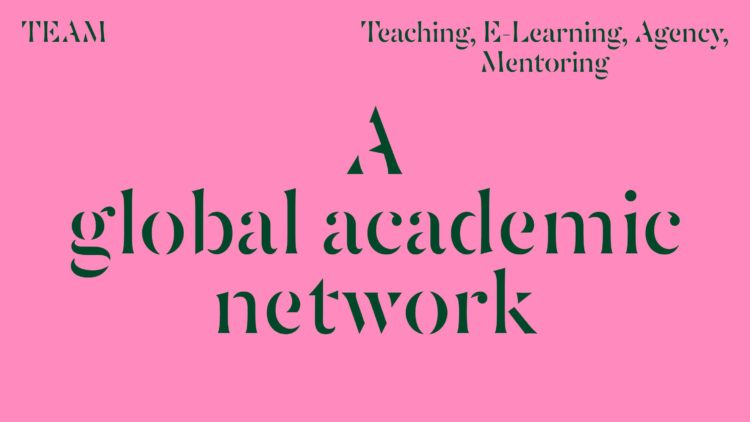Recherche
Mónica Millán, Si gano mucho como mucho, si gano poco como poco [Si je gagne beaucoup je mange beaucoup, si je gagne peu je mange peu], de la série El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2008, crayon sur papier, 150 x 200 cm © Courtesy Mónica Millán
Depuis 2002, Mónica Millán (née en 1960 à Misiones, en Argentine) travaille avec les tisserand·es du village de Yataity del Guairá, au Paraguay, considéré comme le berceau du tissu ao po’i (toile fine ou étroite en guarani), ainsi que de la dentelle jú. L’artiste conçoit l’art textile comme l’articulation créative entre recherches d’ordre spirituel et préoccupations écologiques. Selon elle, la nature demande à être protégée par sa conservation ou en y intégrant la culture et les écosystèmes comme autant d’entités à la source de notre humanité. Depuis le projet El vértigo de lo lento [Le Vertige de la lenteur] jusqu’à aujourd’hui, M. Millán réalise des propositions artistiques en lien avec les communautés auprès desquelles elle s’engage, à travers un dialogue et des échanges visant à améliorer leurs conditions de vie, tout en respectant l’environnement dans lequel elles s’inscrivent. L’armature conceptuelle qui traverse ses travaux postule que la nature irrigue nos vies, qu’elle est un espace culturel, de transmission des savoirs et des spiritualités.

Mónica Millán, El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur] (détail), 2002-2024, table avec des différents tissages ao po’I et dentelles jú, installation de dimensions variables © Courtesy Mónica Millán
De toute évidence, nous assistons actuellement à une crise écologique inédite, conséquence de l’action humaine. C’est dans ce cadre que les projets de M. Millán s’inscrivent, non sans une forte dimension activiste dont l’objectif est de renverser cet ordre des choses. À travers des travaux d’aiguille ainsi que du soin et de la protection de la terre, ses propositions utilisent l’art comme un outil fondamental pour la conscientisation, dans une perspective de transformation sociale et humaine.
El vértigo de lo lento marque le moment où l’artiste s’installe à Yataity del Guairá dans l’objectif de travailler avec les tisserand·e·s du village. Parmi iels, on peut mentionner Digna López et sa sœur Pablina, avec qui M. Millán va s’intéresser à l’analyse des mythes et des savoirs représentés dans le tissage et la broderie. Dans cette perspective, l’art textile est un outil de transmission de la culture au sein de la communauté, tout comme il est un réservoir pour le soin et la protection de la nature, puisqu’il requiert que le village cultive diverses espèces, notamment celles qui serviront de matière première pour tisser. Le coton blanc, le mandyju pytã, ou rouge ainsi que le marron proviennent de la zone de Guairá, le vert provient du Brésil, où il est introduit depuis 2021, quoique son usage soit encore en phase d’essai. Le croisement des cotons rouge et blanc crée une tonalité bien particulière que l’on appelle rubí, insérée comme motif dans les compositions. De nombreux textiles sont réalisés avec des fils de couleur naturelle qui n’ont pas besoin d’être teints.
À Yataity del Guairá, des femmes, des hommes, des personnes âgées ou encore des enfants tissent au grand air, à l’ombre des arbres peteribí, lapacho, ibirapitá, entre autres. Dans les cours ouvertes des maisons, on installe des tables autour desquelles les tisserand·es s’installent pour filer et pour raconter des histoires. Les petites filles transportent d’une maison à l’autre les tissages, afin que les habitant·s les complètent en y ajoutant des dessins et des motifs particuliers : dessins de festons, dentelles jú, ou pour réaliser des finitions spécifiques. En somme, les pièces sont le fruit du travail de la communauté entière, de même qu’elles sont le vecteur d’une transmission des savoirs d’une génération à l’autre. La ronde qui se forme autour du tissage comme action tisse également histoires et cosmogonies, au sein desquelles l’eau apparaît comme un élément primordial dont découle tout le reste. Ici, pas de division entre nature et culture, qui apparaissent comme les deux faces d’une même médaille : la nature façonne la culture de la même manière que la culture veille sur la nature.
Dans le journal commencé par l’artiste en 2002, dans lequel elle continue de consigner ses expériences et son vécu, on peut lire : « Digna et Don Enrique, dans leur cour en terre battue, celle où débouche la galerie où tous deux tissent au métier à tisser, il y a les plants de cotonnier. Ils en cueillent un petit flocon qu’ils ouvrent sous mes yeux et ceux d’une petite fille du village : Don Enrique le place sur l’alésoir, le flocon commence à vibrer puis se désagrège en plusieurs fils transparents, qui sont gonflés puis passés dans la boucle du fuseau. De là, en l’espace d’une seconde, surgit le fil : la petite et moi nous en rions d’émerveillement. Puis nous avons pris le chemin de la maison d’une dentelière (jú), qui semblait très concentrée sur un petit paquet qu’elle avait cousu à sa robe. Elle l’a ouvert. Elle y gardait très précieusement les graines de coton1. »

Mónica Millán, Si gano mucho como mucho, si gano poco como poco [Si je gagne beaucoup je mange beaucoup, si je gagne peu je mange peu] (détail), de la série El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2008, crayon sur papier, 150 x 200 cm © Courtesy Mónica Millán

Mónica Millán, Si gano mucho como mucho, si gano poco como poco [Si je gagne beaucoup je mange beaucoup, si je gagne peu je mange peu], de la série El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2008, crayon sur papier, 150 x 200 cm © Courtesy Mónica Millán
Au fil du temps, le work-in-progress El vértigo de lo lento a été déployé de différentes manières, selon ce qui surgit des échanges entre l’artiste et les tisserand·es. Je m’arrêterai sur l’installation réalisée en 2024 pour une exposition à la fondation Santander de Buenos Aires2, consistant en une projection vidéo, un métier à tisser avec des tissages ao po’i et de la dentelle jú rangés en pile, faisant face à un dessin intitulé Si gano mucho como mucho, si gano poco como poco [Si je gagne beaucoup je mange beaucoup, si je gagne peu je mange peu, 2008], une phrase de la tisserande Florencia Legal de Barreto. On trouve également une série de portraits des tisserand·es et des pièces textiles, qui sont le résultat des travaux produits par M. Millán avec la communauté, ou encore le fruit d’introspections personnelles.
Ce sont la grand-mère et la mère de M. Millán qui lui ont transmis l’art des travaux d’aiguille. C’est de là que vient son amour pour les textiles populaires et son positionnement dans le champ de l’art, qui vont l’amener à démolir les vieilles hiérarchies et à travailler avec le peuple tisserand de Yataity del Guayrá. Pendant ses longs séjours dans ce village, l’artiste analyse les processus autour de l’acte de tisser lui-même, questionnant la nature qui environne et accompagne cette activité, ses paysages, ses coutumes, ses cycles de temps, ou encore les affects sollicités. On y entend la voix de Enrique Narvaja, mieux connu sous le nom de Don Enrique :
« Le ao po’i est comme un oiseau qui parcourrait le monde et éduquerait les gens. Partout on lui demande : comment fais-tu cela ? On fait comme ci, on fait comme ça3 », dit-il dans la vidéo El vértigo de lo lento, qui documente les sept premières années de voyages et les moments que l’artiste a passés avec la communauté. « Selon notre travail nous mangeons. Si je gagne beaucoup je mange beaucoup, si je gagne peu je mange peu. Je vais rester ici jusqu’à ma mort, je n’ai nulle intention d’aller ailleurs4 », dit encore la tisserande Florencia Legal de Barreto. La réalité est à la fois simple et crue, tisser traverse l’existence de part en part.

Mónica Millán, El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur] (détail), 2024, pièces de dentelle jú et dessins faits par Ángeles Giulianna Goiris (fille de onze ans) © Courtesy Mónica Millán
Le dessin, dont le titre reprend cette citation de Florencia Barreto – Si je gagne beaucoup je mange beaucoup, si je gagne peu je mange peu –, rend compte de la relation des femmes et des enfants avec la nature de ce lieu, de même qu’elle renvoie au lien entre le tissage du coton, la nature et le corps. Les tisserand·es se fondent dans un paysage plein d’espèces grimpantes, insectes, amphibiens, papillons, nénuphars flottants. On retrouve la lumière du village dans la variété des gammes de gris, presque évanescentes, qui témoignent du caractère sacré du lieu. « J’aime penser à mes dessins comme s’il s’agissait de la peau d’un papier, comme une grande toile qu’on pourrait déployer5 », souligne M. Millán. Le centre des dessins concentre une tension qui ne va pas sans contraster avec les marges qui, elles, restent désespérément vides. Cette technique de dessin simule cependant celle du tissage des tisserand·es, comme M. Millán le raconte dans son journal :
« Montagnes d’Ibyturuzu
il pleut
brume
la flore se change en dentelle
je prends des diapositives.
Des portraits d’ombre et de lumière.
Elles prennent la pose pour moi chez elles.
Je reproduis la diapositive sur le papier et traduis la projection de l’ombre et de la lumière en une forme abstraite, à travers une ligne très fine, j’appuie à peine, j’en perds la composition générale de l’image et je me perds. On obtient des dessins millimétriques où la brodeuse se fond dans son contexte et c’est là qu’apparaissent les dentelles. Ce sont elles qui deviennent les dentelles, dentelées dans leur paysage6. »

Mónica Millán, Guaridas [Nests], from the series El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2002, terre, paille, miel de canne, dimentions variables © Courtesy Mónica Millán

Mónica Millán, Guaridas [Nests], from the series El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2002, terre, paille, miel de canne, dimentions variables © Courtesy Mónica Millán
Au beau milieu des vidéos, des dessins, des chaises, d’une table avec des piles de tissus ao po’i et de dentelle jú, est disposée une série de Guaridas [Terriers] en adobe, que l’artiste construit en utilisant la paume de sa main comme unité de mesure. Ces créations font écho à l’architecture naturelle des takurús, fourmilières en terre séchée que l’on trouve dans les vallées de la province de Misiones. Les premiers tatacuás – fours en terre utiles à la cuisson de la chipa guazú, soupe du Paraguay, entre autres plats – sont les tacurús, autrement dit, les formes réalisées par les fourmis charpentières qui ont inspiré l’artiste pour réaliser ces terriers marqués par la forme de sa main, comme l’a inspirée la géographie de la région avec ses serranías d’Ibyturuzu. On peut lire dans son journal :
« montagne
tacurú (provient de l’animal)
Tatacuá (des personnes)
Tout cela se transforme dans des formes réalisées en terre, en paille, en miel de canne (un mélange d’adobe et de tatacuá, maison-repas). Je travaille avec la main en cuillère, la main gauche sert à maintenir la construction de l’extérieur tandis que la main droite va et vient et maintient la forme produite par l’autre main. Le “creusement” vient depuis l’extérieur afin d’évider (la cavité du ventre) faire le vide à l’intérieur. La forme de la main en cuillère finit par s’imprimer sur cette pièce de 80 cm de diamètre et de 60 cm de haut, avant de revenir aux formes de broderies-montagnes avec des graines et de la pierre. Les mouvements que je réalise tout au long de ce cheminement reproduisent ceux du village d’un point de vue géographique : ils tournent sur eux-mêmes, à la manière de l’escargot sur sa carapace qui se construit sur lui-même, ou des fourmis qui portent leur tacurú pour finalement rester à l’intérieur.7 »

Mónica Millán, El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2024, vue d’installation de l’exposition Guyra ka’aguy / Pájaro Salvaje. Textiles de Mónica Millán, Fundación Santander, Buenos Aires, 2024 © Courtesy Mónica Millán

Mónica Millán, El vértigo de lo lento [Le vertige de la lenteur], 2024, vue d’installation de l’exposition Guyra ka’aguy / Pájaro Salvaje. Textiles de Mónica Millán, Fundación Santander, Buenos Aires, 2024 © Courtesy Mónica Millán
Toutes ces pièces constituent un univers où s’entrelacent les affects de l’artiste, les tisserand·es, ainsi que la nature environnante. L’activisme de M. Millán recourt aux travaux à l’aiguille afin de subvertir le binôme art/artisanat, artiste/artisan·e qui structure si fortement le champ de l’art, de même qu’il exhibe sans concessions à quel point ces œuvres textiles nécessitent un temps que le système actuel, patriarcal et capitaliste, cherche à supprimer via la promotion des textiles industriels. Le peuple tisserand de Yataity del Guayrá s’en trouve menacé, et c’est pourquoi il cherche d’autres modalités de subsistance, qui le conduisent à abandonner ce type de pratiques artistiques.
M. Millán travaille main dans la main avec les tisserand·es afin de protéger cet univers de savoirs. L’artiste considère que chaque point de couture ou de broderie qu’on cesse de pratiquer, qu’on ne nomme plus, tombe alors dans la zone grise de l’oubli, engendrant une perte des savoirs qui a des conséquences directes sur la langue. Le tissage a pour tâche symbolique de relier le monde matériel et le monde immatériel. Le fil de coton, cultivé par des paysan·nes locaux·ales, qui conserve ses pigments naturels, est entrelacé par les tisserand·es qui, ce faisant, rassemblent les récits des destinées humaines sur cette terre, celles qui donnent naissance aux cosmogonies et définissent les communautés à travers la culture. Son activisme consiste à conserver et à préserver des arts qui entrelacent le langage avec la culture et la nature.
Mónica Millán, Diario de viaje: El vértigo de lo lento [Journal de voyage : le vertige de la lenteur], 2002-2009. Document inédit.
2
Guyra ka’aguy / Pájaro Salvaje. Textiles de Mónica Millán, Fundación Santander, Buenos Aires, avril – novembre 2024.
3
La vidéo de El vértigo de lo lento est en accès libre : https://drive.google.com/drive/folders/1RD8ALkwrl2nReByljXjfvsJ_DCGOgr_8
4
Ibid.
5
Fabián Lebenglik: “Selva de líneas hipnóticas. Los dibujos de Mónica Millán en el ciclo La línea piensa” [Jungle aux lignes hypnotiques. Les dessins de Mónica Millán dans le cadre du cycle La ligne pense], publié dans Página 12, 8 septembre 2009, non paginé.
6
Mónica Millán, Diario de viaje: El vértigo de lo lento, op. cit.
7
Ibid.
María Laura Rosa est professeure d’esthétique à la faculté de philosophie et lettres (université de Buenos Aires) et chercheuse au sein du Conseil national de recherche scientifique et technique (CONACIT). Ses recherches portent sur l’art féministe en Argentine, au Brésil et au Mexique depuis les années 1970. Avec Luana Saturnino Tvardovskas, elle a édité O sexo da arte. Teorías e críticas feministas [Le Sexe de l’art. Théories et critiques féministes, 2023]. Elle est notamment l’autrice de De cuerpo entero. Debates feministas y ámbito cultural en Argentina 1960-1980 [Du corps en entier. Débats féministes et champ de la culture en Argentine 1960-1980, 2021]. Elle a est la commissaire de l’exposition Guya ka’aguy/Pájaro salvaje [Guya ka’aguy/Oiseau sauvage]. Textiles de Mónica Millán (2024).
Un article réalisé dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM international academic network: Teaching, E-learning, Agency and Mentoring.
María Laura Rosa, « Mónica Millán et la communauté des tisserand·es de Yataity del Guayrá » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 8 novembre 2024, consulté le 22 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/monica-millan-et-la-communaute-des-tisserand%c2%b7es-de-yataity-del-guayra/.