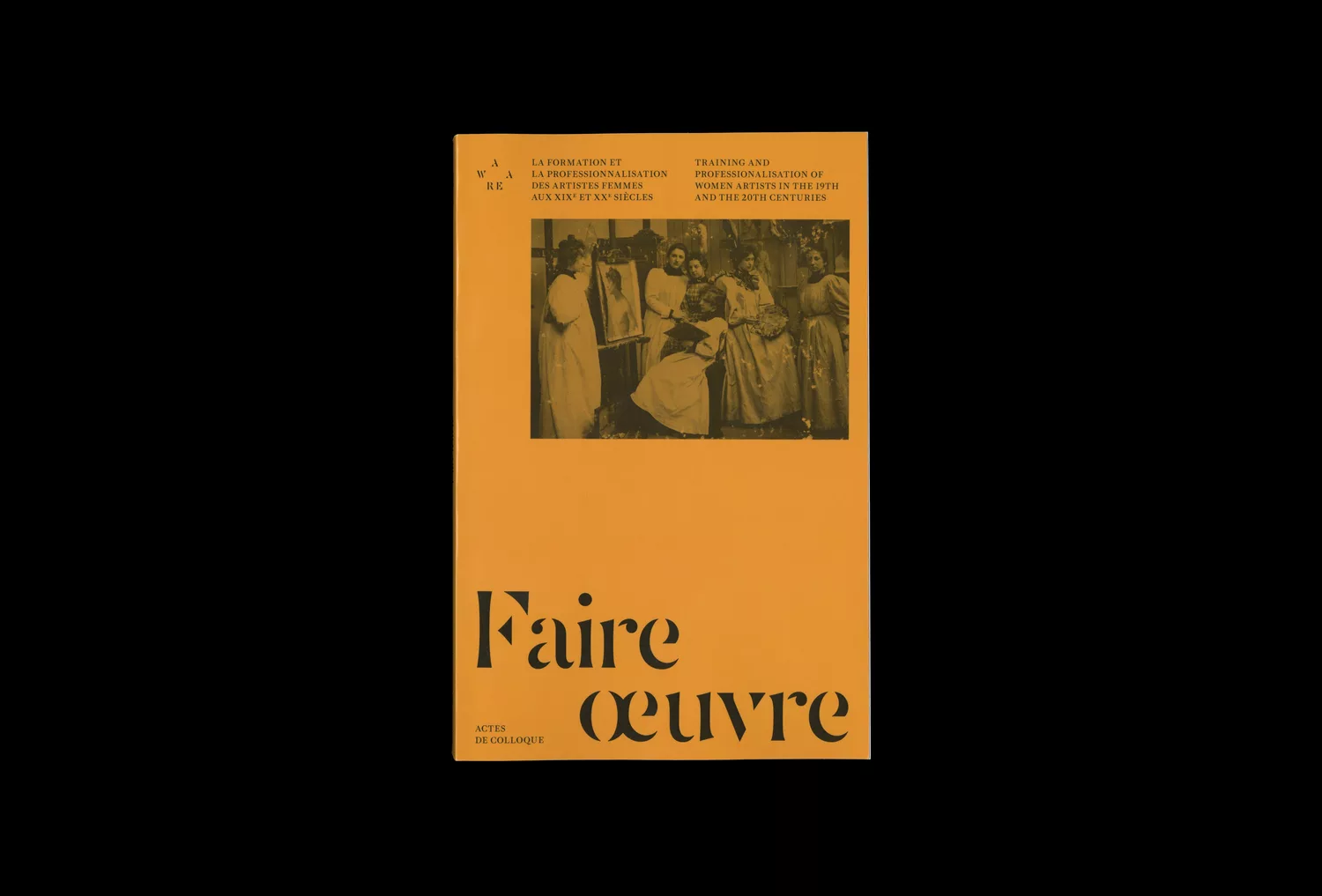Éditions
Cet ouvrage fait suite à la tenue d’un colloque international pluridisciplinaire organisé les 19 et 20 septembre 2019 au Centre Pompidou et au musée d’Orsay, à Paris, en partenariat avec l’association AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions). Intitulé Faire œuvre. La formation et la professionnalisation des artistes femmes aux XIXe et XXe siècles, le colloque entendait dresser un état actuel de la recherche sur l’accession des artistes femmes aux structures d’enseignement, en France et à l’étranger, qu’il s’agisse des ateliers, des académies privées ou des écoles publiques.
- Former des artistes ou des « ouvrières habiles » ? Les cours publics et écoles de dessin pour femmes et jeunes filles en France au XIXe siècle Renaud d'Enfert
- La méthode Cavé : reproduction et expression dans le projet d’une « école de femmes » Luciana Lourenço Paes
- La place des femmes à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs : une autre Histoire à écrire Lucile Encrevé
- L’accès des femmes à l’École nationale des beaux-arts de Paris : Une lutte de l’Union des femmes peintres et sculpteurs et de ses allié·e·s Catherine Gonnard
- Égalité des chances pour les femmes. Le soutien apporté aux femmes artistes à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles à la fin du XIXe siècle Wendy Wiertz
- Devenir artiste professionnelle en Argentine : le cas de l’Escuela Superior de Bellas Artes (années 1930-1940) Georgina G. Gluzman
- Genre, modèles, peintres et entrepreneuriat d’art : Le cas de l’académie Vitti à Paris (1889-1914) Maria Antonietta Trasforini
- Les femmes sculpteurs suédoises au tournant du siècle dernier. Origines et parcours éducatif et professionnel Linda Hinners
- Munich ou Paris ? Les artistes polonaises cherchent à s’instruire au tournant du XXe siècle Ewa Bobrowska
- L’académie Lhote au féminin Fanny Drugeon
- Femmes pionnières : leçons parisiennes et création de la scène artistique ouest-américaine Heather Belnap
- Reconnaissance voilée : Frances Hodgkins et la subversion de l’enseignement de l’art à travers une pédagogie radicale Samantha Niederman
- Des espaces de formation militants, entre transmission artistique et politisation du regard : les ateliers Super-8 de Klonaris/Thomadaki dans les années 1980 Ana Bordenave
- Si ce n’était la France : l’évolution d’Eliza Pratt Greatorex à travers sa formation artistique Katherine Manthorne
- Aspirations et négociations : l’artiste et modèle Victorine Meurent à son époque et dans l’histoire de l’art Yelin Zhao
- La formation d’artiste de Louise Bourgeois. Paris-New York Émilie Bouvard
- Être à l’œuvre. Entretien de Béatrice Casadesus avec Scarlett Reliquet
La formation d’artiste de Louise Bourgeois. Paris-New York
Émilie Bouvard
Résumé
Comme pour de nombreuses artistes femmes, la formation artistique de Louise Bourgeois fut à la fois longue et sinueuse. Débutée dans l’atelier de réfection de tapisseries de ses parents, elle se poursuit dans les académies parisiennes au cours des années 1930, puis à New York dans les années 1940, alors que Bourgeois est la mère de trois petits garçons. Pour elle, ce temps long répond aussi à deux singularités qui lui sont propres. Sa formation est plus intellectuelle que plastique, marquée par des rapports étroits avec ses professeurs : c’est un parcours mental. De plus, elle est à la recherche d’un « style propre », soit d’une méthode, d’un processus qui soit le sien, ainsi que de son médium de prédilection. Ce n’est que dans les années 1940 à New York qu’elle exécute ses premières pièces sculptées, alors qu’elle est en exil et que les « fétiches » extra-occidentaux font l’objet d’une recrudescence d’intérêt dans les milieux artistiques, notamment surréalistes. Son passage à la sculpture et son abandon définitif de la peinture passent à mon sens par un dernier détour et une dernière formation : son expérience de la gravure à l’Atelier 17, alors à New York, de William Hayter en 1946-1947.