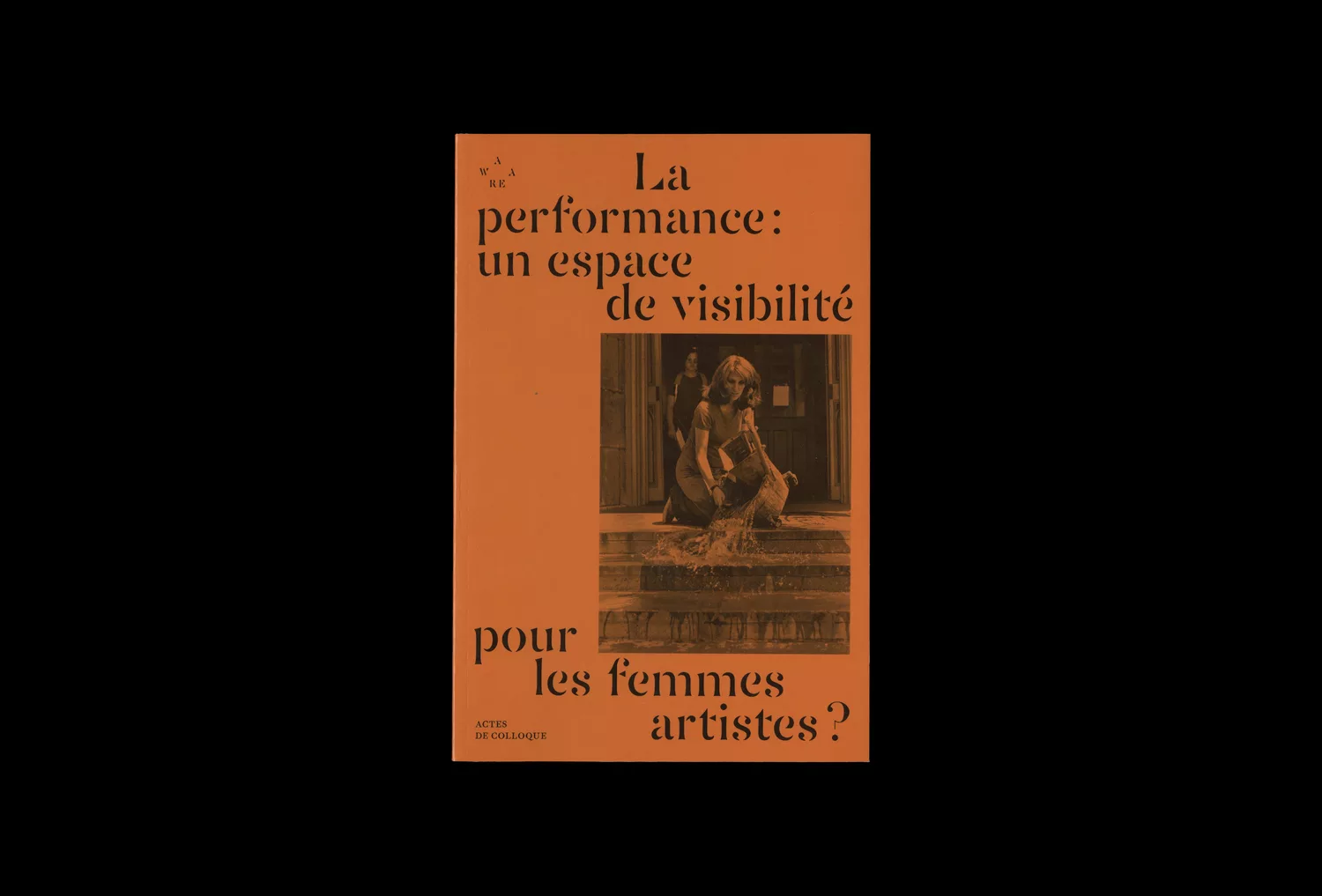Éditions
La présente publication fait suite à une journée d’étude qui s’est déroulée le 14 mai 2018 aux Beaux-Arts de Paris. Intitulée « La performance : un espace de visibilité pour les femmes artistes ? », cette journée s’inscrivait dans le cadre du programme de recherche interdisciplinaire « Visibilité et invisibilité des savoirs des femmes : les créations, les savoirs et leur circulation, XVIe-XXIe siècles ». Porté par Caroline Trotot au sein du laboratoire Littératures, Savoirs et Arts (LISAA) de l’université Paris-Est — Marne-la-Vallée en 2017-2018, ce programme a bénéficié, pour cette journée d’étude et pour cette publication, du soutien et de la collaboration active de l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions. Un des objectifs était d’étudier comment l’œuvre créatrice ou encore l’usage du corps pouvaient donner lieu à des stratégies de détournement permettant d’interroger les mécanismes de visibilité et d’invisibilité qui régissent les savoirs des femmes. La performance s’est en conséquence imposée comme un terrain imbriquant conjointement ces aspects du corps et de l’œuvre, d’autant qu’elle a, dans son histoire, été en grande partie investie par les femmes.
- « Faire le ménage c’est travailler » Camille Paulhan
- Sortir du cadre : stratégies féministes dans le cinéma élargi des années 1960 et 1970 Maud Jacquin
- Le corps en performance : l’impossible quête identitaire Thérèse St-Gelais
- Corporéités souffrantes et féminités transgressives dans les oeuvres performatives d’Yvonne Rainer, Jo Spence et Hannah Wilke Johanna Renard
- Les performances de Gina Pane au prisme du tarentisme apulien : entre économie répressive du sang et mise en visibilité de rituels populaires féminins Janig Bégoc
- Les contre-archives : fiction archéologique de la soumission incorporée Laboratoire de la contreperformance
Les performances de Gina Pane au prisme du tarentisme apulien : entre économie répressive du sang et mise en visibilité de rituels populaires féminins
Janig Bégoc
Résumé
Cet article se propose de considérer l’usage du sang dans les performances de l’artiste d’origine italienne Gina Pane comme la survivance de rituels populaires féminins que l’économie répressive du sang féminin a largement occultés. Il s’agit de montrer, en confrontant les gestes et les blessures produits par G. Pane à ceux qu’élaboraient les femmes mordues par la tarentule dans le rituel du tarentisme apulien, la façon dont les actions de G. Pane rendent visible, en la réactivant, une histoire des savoirs et du sang féminins qui, depuis l’Antiquité grecque, s’est tissée autour de la figure symbolique de l’araignée.
Docteure en histoire de l’art et ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Janig Bégoc est maîtresse de conférences à l’université de Strasbourg. Ses recherches portent sur les enjeux esthétiques, historiographiques et anthropologiques de l’art de la performance. Elle a codirigé la publication des ouvrages La Performance. Entre archives et pratiques contemporaines (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011) et Le Texte au risque de la performance, la performance au risque du texte (Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques, université de Strasbourg, paru en 2019).