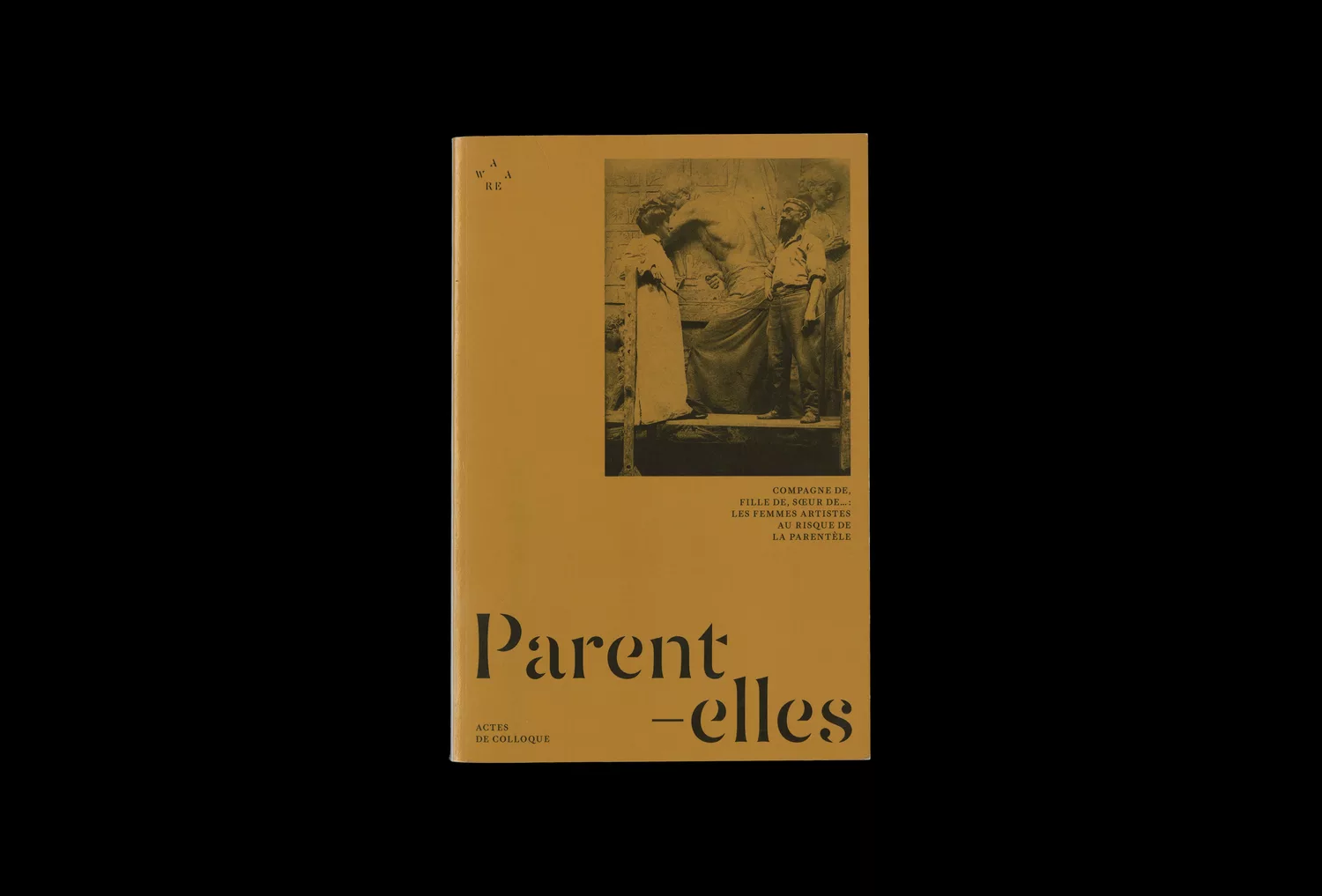Éditions
Cet ouvrage fait suite à la tenue d’un colloque international organisé les 23 et 24 septembre 2016, par le Musée Sainte-Croix, l’université de Poitiers (Criham) et l’association Archives of Women Artists, Research and Exhibitions (AWARE) à la faveur de l’exposition Belles de jour, femmes artistes — femmes modèles, organisée par le musée du 18 juin au 9 octobre 2016. Déployée dans le parcours des collections du musée poitevin, cette exposition, bénéficiant notamment d’un important prêt du Musée des Beaux-Arts de Nantes, explorait la figure féminine comme sujet entre 1860 et 1930, en faisant la part belle aux artistes femmes de Camille Claudel à Romaine Brooks.
- La vocation artistique à l’épreuve du mariage dans la Belgique du XIXe siècle Denis Laoureux
- De femme d’artiste à artiste femme : le combat émancipateur de Maria Cosway Amandine Rabier
- La « vie silencieuse » de Louyse Moillon (1610-1696) Cécile Coutin
- Madeleine Dinès, fille de, femme de : comment n’être pas que « l’envers d’un beau nom » ? Élodie Bouygues
- La parentèle au risque de la photographie ? Amateures et professionnelles au XIXe siècle et au début du XXe siècle (France, Grande-Bretagne, États-Unis) Thomas Galifot
- Des femmes au « caractère ambitieux », n’ayant « aucune envie sincère de s’arranger » : deux épouses de la dynastie Bonnart, éditrices et marchandes d’estampes à Paris sous l’Ancien Régime Pascale Cugy
- Juana Romani (1867-1923), élève de…, maîtresse de… La parentèle sous la plume des critiques d’art Marion Lagrange
- Ottilie Maclaren (1875-1947), « fille » de Rodin ? Eva Belgherbi
- Veuves, mais artistes. Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss après la Seconde Guerre mondiale Julie Verlaine
- Partenariats stratégiques. Réflexions sur le couple d’artistes autour de 1900 Charlotte Foucher Zarmanian
Partenariats stratégiques. Réflexions sur le couple d’artistes autour de 1900
Charlotte Foucher Zarmanian
Résumé
Enserrées entre l’obligation d’honorer le devoir conjugal et maternel, et le désir de s’épanouir professionnellement, les femmes artistes vont, pour certaines, choisir de s’unir à des hommes pratiquant parfois la même activité artistique qu’elles. Ce sont de ces femmes dont il est question ici, autour de 1900, et plus précisément dans les milieux symbolistes et nabis. En renversant la focale habituelle pour se placer de leur côté, le couple – hétérosexuel – est envisagé sous trois angles : l’effacement, la complémentarité des rôles et l’affranchissement. L’objectif est de rendre compte d’une variété de situations et de possibilités offertes ou non par le couple d’artistes qui sera appréhendé là comme une instance stratégique d’infiltration dans les mondes de l’art, recouvrant une multitude de sous-tactiques identitaires (anonymat, assistanat, rivalité…), esthétiques (mimétisme, miniaturisation…) ou encore sociales (entrisme, réception…). Car souvent, grâce à leur compagnon, les femmes bénéficient d’un réseau de personnalités influentes censées leur ouvrir les portes des Salons, des expositions et des revues.
Depuis mes premiers travaux sur les femmes artistes, j’ai été confrontée à la question du couple d’artistes. Jeanne-Élisabeth Chaudet, sujet de mon master 1, m’a obligée à réfléchir aux relations de couple entre artistes, puisque cette peintre était mariée au sculpteur Antoine-Denis Chaudet. La problématique du couple continue encore aujourd’hui d’irriguer mes recherches sur les historiennes de l’art, nombreuses à s’unir à une personne pratiquant la même activité qu’elles, comme Margot Wittkower, Dora Panofsky ou Gabrielle Rosenthal.
Le couple d’artistes a également été incontournable dans ma thèse de doctorat qui portait sur les femmes artistes dans les milieux symbolistes au passage du XIXe au XXe siècle1 où, pour justement construire ce corpus de femmes, j’ai été amenée à consulter l’ensemble des monographies d’artistes hommes — plus nombreuses – et qui révélaient très souvent que l’épouse, la compagne, la maîtresse, l’élève, exerçaient alors le même métier artistique qu’eux. Ce sont de ces femmes dont il est question ici (en tout cas plusieurs d’entre elles), autour de 1900 et plus précisément dans les milieux symbolistes et nabis, à une période charnière où elles sont enserrées entre l’obligation d’honorer le devoir conjugal et maternel, et donc de ne pas demeurer célibataires, et le désir fort de s’émanciper professionnellement. La période autour de 1900 marque aussi un point de tension crucial : les discours misogynes sont très nombreux, mais cette fois ils sont contrés par une première vague féministe – pour reprendre la formule de Christine Bard2 – qui émerge simultanément. Dans ce cadre, j’aimerais envisager le couple — hétérosexuel (je le précise) —, en considérant le point de vue des femmes, et ce sous trois angles stratégiques : celui de l’effacement d’abord, de la complémentarité des rôles ensuite, et enfin de l’affranchissement. L’objectif est de rendre compte d’une variété de situations et de possibilités offertes ou non par le couple d’artistes qui sera appréhendé là comme une instance d’entrée dans les mondes de l’art et recouvrira une multitude de sous-tactiques à la fois identitaires, esthétiques et sociales. Le concept de stratégie mobilisé ici reprend le sens que lui en a donné le sociologue Pierre Bourdieu qui l’entendait comme un système d’actions, un modèle de comportement détaché, ou non, d’une intention délibérée et consciente3.
Stratégie de l’effacement
La première stratégie relève de ce qui peut être qualifié d’effacement, et épouse d’abord un sens auctorial. Cette stratégie de l’effacement trouve le plus facilement à s’activer en 1900 dans des collectifs d’artistes, dominants à l’époque dans les arts décoratifs. Dans ce champ paradoxal, la femme occupe une place privilégiée, bien acceptée, mais est en même temps confrontée à des mécanismes de relégation, de subordination et d’invisibilité. Car, si l’anonymat des talents est souvent inséparable de toute production collective, il est également assez significatif de la production féminine, comme le rappelle Virginia Woolf dans Une Chambre à soi : « l’anonymat court dans leurs veines. Le désir d’être voilées les possède encore. Même aujourd’hui, elles sont loin d’être aussi préoccupées que les hommes par le soin de leur gloire4 […] ». L’invisibilité auctoriale des femmes est, par exemple, à l’œuvre chez les Nabis, que peu de travaux ont encore étudié du point de vue du genre. Pourtant, on sait qu’Angélique et Clotilde Narcis, respectivement amie et compagne d’Aristide Maillol, France Ranson, épouse de Paul Ranson, Laure Lacombe, mère de Georges Lacombe, et Lazarine Baudrion, compagne de József Rippl-Ronaï, ont évolué au sein de ce cénacle, mais sans jamais être considérées comme des artistes à part entière. Elles jouèrent toutefois un rôle essentiel dans l’atelier, lieu très marqué par la délégation et la division du travail selon des logiques genrées, où ce sont les femmes qui exécutent des œuvres auparavant conçues par les hommes. Ainsi, France Ranson, épouse de Paul Ranson, réalise à partir de 1890 l’équivalent d’une demi-douzaine de tapisseries d’après les cartons imaginés et dessinés par son mari [ill. 1].

1. Paul et France Ranson, Printemps ou Femmes sous les arbres en fleurs, 1895, tapisserie à l’aiguille en laine sur toile à canevas, 167 × 132 cm, Paris, musée d’Orsay ; Femme en rouge ou Femme à la cape rouge, 1895, tapisserie à l’aiguille, laine sur canevas, 150 cm × 100 cm, reproductions extraites de : Agnès Humbert, Les Nabis et leur époque (1888-1900), Genève, Pierre Cailler, 1954, © Collection particulière.
Parmi les tapisseries aujourd’hui conservées, mais qui ont retenu pendant longtemps la signature du mari, plusieurs représentent des figures féminines dans des jardins ou occupées à des activités journalières, où dominent une simplification des lignes et une économie de couleurs. Si on ne peut pas vraiment dire que les sujets pensés par Paul Ranson s’illustrent par leur originalité, il est toutefois possible de reconnaître la qualité technique de ces tapisseries, à une époque d’émergence de la mécanisation des arts (à laquelle s’opposaient justement les Nabis) : ces œuvres sont en effet réalisées sans le recours d’un métier à tisser, artisanalement, à la main, sur un canevas que France Ranson brodait avec de grosses laines de couleurs vives. Chez les Nabis, France Ranson n’était pas précisément caractérisée comme appartenant strictement au groupe. Bannie des réunions mensuelles, elle était surnommée la « Lumière du Temple », surnom qu’elle devait aux Grands Initiés d’Édouard Schuré, et plus précisément au personnage de Dévaki, figure de Vierge-mère, décrite comme gardienne du temple, guide spirituelle ou muse inspiratrice (elle sera d’ailleurs représentée comme telle par Paul Ranson et Maurice Denis). La question de son intégration au groupe est donc plus que complexe et le statut qu’elle occupe, difficile à définir avec précision, à mi-chemin entre l’épouse, la muse, la collaboratrice. L’effacement de la main féminine (au sens de la signature, et non bien sûr de la pratique), peut également revêtir un sens esthétique, comme chez le couple Pierre Puvis de Chavannes – Alix d’Anethan. Ce couple reconduit à nouveau cette question du camouflage, pour ne pas dire du caméléonisme, à travers la relation hiérarchique entre le maître et l’élève. Les œuvres de la baronne belge Alix d’Anethan révèlent une prédilection pour la peinture murale et les grandes fresques d’histoire allégorique, religieuse ou mythologique, comme chez Pierre Puvis de Chavannes. Portant non seulement sur le contenu iconographique, cette contiguïté esthétique entre les deux s’affirme également dans leur style où priment composition épurée, dessin synthétique, gamme de couleurs restreinte et affirmation d’une planéité. Les rapprochements entre les deux artistes sont souvent saisissants. Dans Les Saintes femmes au tombeau de 1892 (Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), le rythme ternaire des figures et la réduction de la gamme chromatique au bleu-gris rappellent nettement le style puvisien, même si la restriction du coloris semble encore plus extrême chez d’Anethan qui, pour un autre envoi en 1895, fut même qualifiée de « décoloriste5 », un terme évocateur illustrant bien l’idée du retrait et de l’effacement soi-disant propre à l’art des femmes.
Stratégie de la complémentarité des rôles
Défini par Marie-Jo Bonnet comme « une unité de production au sein de laquelle l’homme est toujours certain de garder le premier rôle6 », le couple d’artistes n’échappe évidemment pas à la reconduction d’un différentialisme, tel qu’il a pu par exemple être théorisé dans les années 1980 par la philosophe et psychanalyste Luce Irigaray. Dans Éthique de la différence sexuelle, Irigaray explique que le différentialisme des sexes se fonde sur la question d’une complémentarité des rôles et des espaces, qui a justement à voir avec l’idée d’émulation et donc de domination d’un sexe sur l’autre : « Pour advenir à la constitution d’une éthique de la différence sexuelle, il faut au moins faire retour à cette passion première selon Descartes : l’admiration. Cette passion n’a ni contraire ni contradictoire, et qui est toujours pour une première fois. Ainsi l’homme et la femme, la femme et l’homme sont toujours une première fois dans la rencontre parce qu’ils sont insubstituables l’un à l’autre. Jamais je ne serai à la place d’un homme, jamais un homme ne sera à ma place. Quelles que soient les identifications possibles, jamais l’un n’occupera exactement le lieu de l’autre — ils sont irréductibles l’un à l’autre7. »
Cette partition complémentaire des rôles telle qu’elle a pu être défendue dans les années 1980 trouve, autour de 1900, une ressource particulièrement féconde dans la presse féminine. De luxueux magazines féminins, comme Femina et La Vie heureuse, fondés par des hommes mais destinés à un lectorat féminin, choisissent en effet de s’éloigner d’un féminisme politique, qui exhorte plus radicalement la femme à sortir de l’espace domestique, pour développer un féminisme en demi-teinte, un « féminisme mystifié » selon la formule de Colette Cosnier8. Dans leurs pages, l’artiste, à côté de la romancière, y est érigée en modèle émancipateur soutenu par des titres bruyants et une mise en page illustrée défendant une nouvelle individualité de la femme artiste qui parvient à neutraliser le clivage entre la création et la procréation, pour combiner harmonieusement les deux. C’est dans ce contexte que sont régulièrement publiés des articles justement consacrés au « ménage d’artistes9 » : là, au sein de visions plutôt idéalisées voire utopiques de l’union, fonctionnant, en apparence, en symbiose et en égal, la femme endosse en réalité les rôles de « compagne d’âme » et de « collaboratrice morale ». Prenons par exemple le cas d’Albert et Charlotte Besnard particulièrement significatif. Dans cet article de Louis Vauxcelles, Albert Besnard est présenté comme le maître influent, tandis que Charlotte Besnard est décrite comme « l’admirable compagne » ou la mère de famille, bien qu’elle soit également artiste. Son art, jamais exploré pour lui seul, subit systématiquement le filtre de son statut d’épouse, de maîtresse de maison et de mère de famille :
« [L]a sculpture de Mme Besnard se ressent des qualités de dialogue, de raison de son mari, car ce cerveau féminin est accessible aux plus hautes conceptions, les lectures les plus abstraites lui sont familières. Néanmoins, Mme Besnard, artiste et intellectuelle, n’a rien abdiqué des grâces de la femme du monde, ni des devoirs de la mère de famille10. »

2. Alexandre et Élisa Beetz travaillant au relief de La Famille heureuse, 1905, héliogravure, © Collection particulière.
Toujours sous l’angle équivoque d’une prétendue complicité intellectuelle, certaines peintures et photographies représentant le couple d’artistes reconduisent ce discours minorant la place des femmes. Le tableau du Finlandais Albert Edelfelt11 réactive, pour sa part, le différentialisme des genres sur la base du clivage actif/passif : c’est Ville Vallgren qui est debout quand Antoinette Vallgren est assise sur une chaise, lui qui travaille quand elle est réduite à un rôle contemplatif (et peut-être d’inspiratrice), lui qui tient les outils quand elle porte un bouquet de myosotis. Ce strict partage des rôles aspire à une dimension qui semble en apparence plus positive pour la femme dans deux photographies représentant le couple d’artistes Alexandre Charpentier et Elisa Beetz, tous deux actifs dans le champ des arts décoratifs. Dans la première, au sein d’une image qui insiste nettement sur les rapports masculin/féminin faisant correspondre la tête d’Elisa Beetz avec celle de l’homme travaillant dans le relief en arrière-plan, la femme figure en égale, debout, sur le même plan que son mari et collègue masculin [ill. 2]. Dans la seconde12, elle est montrée en train de travailler à sa sculpture, au centre de l’image, contrairement à Charpentier assis sur un coin de table, et relégué à droite. Cependant, le contexte relatif à ces photographies apporte un nouvel éclairage, moins constructif pour la femme, qui est avant tout à relier au travail de collaboration pour le bas-relief monumental La Famille heureuse et dont Charpentier fut, dans les écrits – en dépit des faits –, considéré comme l’unique signataire. Et on peut penser que cette œuvre sculptée, qui célèbre avec un idéalisme proudhonien le partage des rôles dans la sphère familiale, a peut-être inspiré le photographe Dornac pour son cliché qui, en situant Elisa Beetz au centre, dans une position intermédiaire entre l’allégorie maternelle et son époux artiste, semble aussi insister sur ce statut mixte d’assistante, de mère et d’artiste professionnelle.
Stratégie de l’affranchissement
Mais, loin de revêtir un aspect uniquement négatif, et infériorisant, où l’homme tiendrait systématiquement le premier rôle, le couple peut également être vu pour les femmes comme une stratégie positive, vectrice d’émancipation et d’affirmation d’une identité d’artiste. C’est ce que cette troisième et dernière partie propose d’examiner. Face aux nombreux discours qui pointèrent la plupart du temps la difficulté des femmes artistes à s’affirmer dans un style personnel, la question de l’influence, qui a longtemps suscité le débat dans les travaux d’histoire de l’art, doit à ce titre évidemment être posée. Dans ma thèse, où il s’agissait d’intégrer a posteriori des femmes artistes au mouvement symboliste, il était nécessaire d’utiliser ces notions d’influence, d’émulation, d’appropriation, tout en sachant aussi les questionner, les contourner et les dépasser. En sculpture, l’ascendance d’Auguste Rodin sur plusieurs femmes artistes (qu’elles aient eu un lien direct avec lui en tant qu’élèves, praticiennes, ou qu’elles n’aient pas directement travaillé dans son atelier) persiste pourtant dans toute une réception critique, si l’on songe par exemple à l’oeuvre bien commentée de Camille Claudel, sculptrice et maîtresse de Rodin. La critique de Louis Vauxcelles est emblématique de ce contexte : « Que serait Claudel sans Rodin ? Les Bavardes, le Persée, La Valse sont de frémissants morceaux de sculpture, nul ne les conteste. Mais Rodin a passé par là, et l’empreinte de son pouce est sur ces statues de femme13 ». Pourtant, il est permis de penser que si, au titre de très bonne élève, Claudel absorba l’enseignement de Rodin, elle sut s’en détacher pour déployer assez vite une véritable stratégie d’affranchissement, comme le résument les mots très connus de l’artiste adressés à son frère en 1893 : « Tu vois que ce n’est plus du tout du Rodin14 ». Cette année-là, Claudel expose en effet au Salon de la Société nationale des beaux-arts les deux groupes en plâtre La Valse et Clotho, et s’emploie à y exprimer les émotions et passions humaines avec une originalité qui n’a déjà plus complètement à voir avec l’art de Rodin. Dans La Valse, l’artiste propose une scène, je trouve, plus vibrante que celle de Rodin dans Le Baiser ou L’Éternelle idole avec qui elle a souvent soutenu la comparaison. Claudel y représente la passion d’une étreinte amoureuse de deux êtres dansants à moitié nus. Debout, le corps légèrement incliné en avant, l’homme enlace de son bras droit la taille de la danseuse qui, presque renversée, s’appuie vigoureusement sur l’épaule de son partenaire en saisissant sa main pour rétablir l’équilibre. Cette sculpture, au centre de gravité légèrement désaxé, suggère l’ivresse des sens avec un dynamisme qui se différencie de la représentation du Baiser de Rodin.
Mais l’émancipation de l’artiste, déjà tangible ici, s’exprime plus visiblement encore par la miniaturisation de plusieurs œuvres réalisées dans les années 1895–1897. Ces sculptures, qui pourraient évoquer trop vite un art du bibelot, semblent signifier, surtout, son éloignement volontaire, assumé, de l’étouffante monumentalité du style de Rodin. Dans Les Causeuses, présenté dans la version plâtre au Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1895, et, en 1897, dans une version mêlant l’onyx au bronze [ill. 3], puis avec La Vague, dont le plâtre est exposé en 1897, l’artiste traite, dans la première, d’un motif familier (trois femmes écoutent une quatrième derrière un paravent) et renouvelle, dans la seconde, le thème des baigneuses. L’originalité du sujet importe ici peu, et Claudel cherche surtout prétexte à prouver sa maîtrise technique de matériaux difficiles à travailler comme l’onyx et sa capacité à traiter de motifs autres que ceux à l’œuvre chez Rodin. Dans ces deux sculptures, elle démontre une dextérité remarquable et une préciosité d’exécution dans le détail qui la rapprochent de l’art japonais, découvert en 1883 lors d’une exposition organisée à la galerie Georges Petit. Son lien à l’Art nouveau est également manifeste lorsqu’elle s’approprie le traitement des arabesques et des sujets organiques en fondant la femme dans la nature, ou lorsqu’elle intègre de nouveaux matériaux comme l’onyx et, enfin, lorsqu’elle élargit le statut de l’oeuvre sculptée à celui de l’objet d’art. Sa participation, en 1895 puis en 1896, au Salon de l’Art nouveau lancé par Samuel Bing achève de sceller définitivement son appartenance à ce courant artistique, et constitue une alternative – plus constructive il me semble – au discours général qui a souvent soutenu la comparaison avec Auguste Rodin15.
Les trois stratégies présentées ici montrent combien le couple d’artistes active une diversité de relations, entre complémentarité heureuse et rivalité productrice d’émulation ou de subordination. On est bien loin ici d’envisager le mariage comme l’éteignoir de toute création16, mais plutôt de considérer l’union comme le résultat de pratiques endogamiques, très présentes — on le sait – dans le monde artistique. L’endogamie recouvrirait ici, non une obligation formelle, mais bien une union préférentielle qui apporterait une légitimité aux femmes comme artistes. On peut en effet penser que, grâce à leur compagnon, les femmes bénéficient à l’époque d’un réseau de personnalités influentes censées leur ouvrir les portes des Salons, des expositions et des revues critiques, autant de structures justifiant leur statut d’artiste. Alix d’Anethan devient par exemple l’élève et la maîtresse de Puvis de Chavannes qui prend, à la mort de Meissonnier en 1891, le poste décisif de directeur de la Société, année où elle devient justement associée de la Société nationale des beaux-arts. Nommée associée et sociétaire aux objets d’art en 1902, Charlotte Besnard a peut-être aussi bénéficié de l’entremise de son époux, Albert Besnard, alors membre actif de cette Société. Ces exemples révèlent que ces relations d’abord d’ordre privé peuvent aussi agir comme de puissants sésames professionnels où l’homme, le compagnon, endosse également le rôle de « facilitateur » et de cooptateur.
Plus largement, enfin, il est nécessaire aussi de replacer ces couples dans une société où la valorisation de la vie conjugale et familiale est légion. Les trajectoires de célibataires, ou de femmes choisissant d’aimer des femmes, constituent – pour reprendre une terminologie foucaldienne – des modes de vie « périphériques », plus ou moins bien acceptés par la société de l’époque. Car si la célibataire laisse encore planer le doute et susciter l’espérance devant l’idéal reproductif17, la lesbienne brise plus radicalement encore le contrat hétérosexuel en tournant concrètement le dos aux hommes, et donc en défiant une omnipotence masculine, on le sait à l’époque, omniprésente dans les institutions artistiques. Le cas emblématique de Rosa Bonheur, qui ne cacha jamais son homosexualité, sans pour autant la revendiquer, contribua à fabriquer l’archétype de l’artiste lesbienne en subvertissant à plus d’un titre les codes convenus de la féminité. Un peu plus tard, Louise Abbéma et Sarah Bernhardt prolongeront à leur manière l’héritage laissé par Rosa Bonheur, dans leur incarnation d’un couple d’artistes femmes accomplies, décomplexées et libres. L’historienne de l’art anglaise Miranda Mason l’a bien montré dans sa thèse consacrée à la pratique sculptée de Sarah Bernhardt que l’on voit surtout comme une comédienne de théâtre mais qui a aussi été peintre et sculptrice18. Originale, cette thèse analyse la pratique sculptée de Bernhardt au prisme de sa relation professionnelle, amicale et amoureuse avec la peintre Louise Abbéma. Sous cet angle, Mason tente de décrypter les raisons qui ont convaincu Bernhardt, en dépit des nombreuses critiques qui lui ont été faites sur ses pratiques artistiques, de continuer à exister en tant que sculptrice professionnelle. La raison principale, fondamentale même, semble être pour Mason sa rencontre avec Louise Abbéma. Une attention particulière est en effet portée sur le buste que Sarah Bernhardt réalisa en 1878 de Louise Abbéma, et sur l’histoire qui est retracée de cette oeuvre si intime, analysée alors comme le parangon du désir : désir de sculpter parce que désir pour une autre femme, artiste elle aussi. Véritable acte d’amour, ce buste a été gardé par Bernhardt toute sa vie, toujours exposé dans ses appartements-ateliers successifs où il était bougé régulièrement, jamais montré dans les expositions publiques sauf en 1923 juste avant la mort de Bernhardt et directement légué à Louise Abbéma. Sans avoir le temps de commenter plus avant ce couple – on peut le signaler, assez exceptionnel à l’époque, et qui ne pose pas tout à fait les mêmes questions en termes de genre –, il est toutefois à remarquer que se réactivent les mêmes processus stratégiques que dans les couples hétérosexuels : la stratégie de l’effacement au travers de leur relation amoureuse tacite et des dialogues implicites par l’art qu’elles entretiennent, la stratégie de complémentarité des rôles (Abbéma peintre / Bernhardt sculptrice ; et si l’on veut aller encore plus loin, Abbéma « impressionniste » / Bernhardt « symboliste »), ou même la stratégie de l’affranchissement, puisque chacune aura accompli sa carrière indépendamment de celle de l’autre, et aura bénéficié d’une reconnaissance publique.
Docteure en histoire de l’art, Charlotte Foucher Zarmanian est chargée de recherches au CNRS, affiliée au Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité (LEGS — UMR 8238). Elle a soutenu une thèse de doctorat sur les femmes artistes dans les milieux symbolistes en France, qui a été récompensée du Prix du musée d’Orsay 2013 permettant la publication d’un essai chez Mare & Martin en 2015. Ses recherches portent actuellement sur les savoirs artistiques des femmes (XVIIIe-XXe siècles).
Soutenue en 2012, cette thèse a depuis fait l’objet d’une publication sous la forme d’un essai : Charlotte Foucher Zarmanian, Créatrices en 1900. Femmes artistes en France dans les milieux symbolistes, Paris, Mare & Martin, 2015. Sur le couple, voir précisément p. 92-93.
2
Christine Bard, Les féministes de la première vague, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
3
Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1980 [1976], p. 119.
4
Virginia Woolf, Une chambre à soi, Paris, Denoël, 1992 [Londres, Hogarth Press, 1929], trad. fr., p. 76.
5
Louis de Fourcaud, « Salon du Champ-de-Mars 1895 », Le Gaulois, no5462, 24 avril 1895, p. 1.
6
Marie-Jo Bonnet, Les femmes dans l’art. Qu’est-ce que les femmes ont apporté à l’art ?, Paris, La Martinière, 2004, p. 52.
7
Luce Irigaray, Éthique de la différence sexuelle, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 19.
8
Colette Cosnier, Les Dames de Femina. Un féminisme mystifié, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009.
9
M. D’Auray, « Les Associées », Femina, 15 janvier 1903, no48, p. 407-408 ; Louis Vauxcelles, « Ménages d’artistes », Femina, no78, 15 avril 1904, p. 125-126 ; Frantz Jourdain, « Un ménage d’artistes. Monsieur et Madame Albert Besnard », La Vie heureuse, no1, janvier 1904, p. 2-4 ; [Anonyme], « Un ménage d’artistes : M. et Madame Thaulow », La Vie heureuse, no8, août 1904, p. 152-153. Cf. également Paris, bibliothèque de l’INHA, fonds Vauxcelles, archives 80, carton 153, dossier 2, sous dossier « Femmes d’artistes ».
10
Louis Vauxcelles, « Ménages d’artistes », Femina, no78, 15 avril 1904, p. 125.
11
Albert Edelfelt, Ville et Antoinette Vallgren, 1886, pastel sur toile, 116 × 139 cm, Göteborg,
Götenbugs Konstmuseum.
12
Paul Marsan dit Dornac, Alexandre Charpentier et Élisa Beetz dans leur atelier, 1905 ou 1907, carte photographique de la série « Nos contemporains chez eux », tirage argentique, Paris, collection particulière.
13
Louis Vauxcelles, « Digression touchant l’art féminin », coupure de presse isolée, Paris, bibliothèque de l’INHA, fonds Vauxcelles, archives 80, carton 150.
14
Citée dans Anne Rivière, Bruno Gaudichon (dir.), Camille Claudel. Correspondance, Paris, Gallimard, 2003, p. 97.
15
Cf. de récents travaux qui intègrent aujourd’hui mieux cette perspective : Bruno Gaudichon, « Camille Claudel dans l’art de son temps », Pablo Jimenez Burillo et al. (dir.), Camille Claudel 1864-1943, cat. expo. (2007-2008), Paris /Madrid, Musée Rodin/Gallimard/Fondation Mapfre, 2007, p. 33-47 ; Anne Rivière, Bruno Gaudichon (dir.), Camille Claudel. Au miroir d’un art nouveau, cat. expo., Roubaix, La Piscine (8 novembre 2014 — 8 février 2015), Paris/Roubaix, Gallimard/La Piscine, 2014.
16
Cette formule est reprise de Caroline Giron-Panel, Sylvie Granger, Bertrand Porot, « Introduction », Que fait le couple à la musique des femmes ? Musiciennes en duo. Mères, filles, sœurs ou compagnes d’artistes, Rennes, PUR, 2015, p. 24.
17
Cf. X…, L’Amour saphique à travers les âges et les êtres. Ouvrage documentaire sur la physiologie et la pathologie de la passion homosexuelle féminine ou amour lesbien, ses causes, ses origines, ses effets et ses aberrations, Paris, chez les marchands de nouveautés, [1902], p. 119-120 : « La grossesse lui cause une terreur et une répulsion invincibles. Sa honte de la maternité ne peut se mesurer qu’avec son impatience et son dégoût envers son enfant. Lorsque celui-ci est devenu grand, l’invertie peut se montrer envers lui excellente mère, très énergique, très sensée ; mais pour le premier âge elle fait une maman détestable. »
18
Cf. Miranda Mason, Making Love/Making Work. The Sculpture Practice of Sarah Bernhardt, thèse de doctorat en histoire de l’art, 2 volumes, université de Leeds, histoire de l’art et études culturelles, mai 2007 (non publiée).