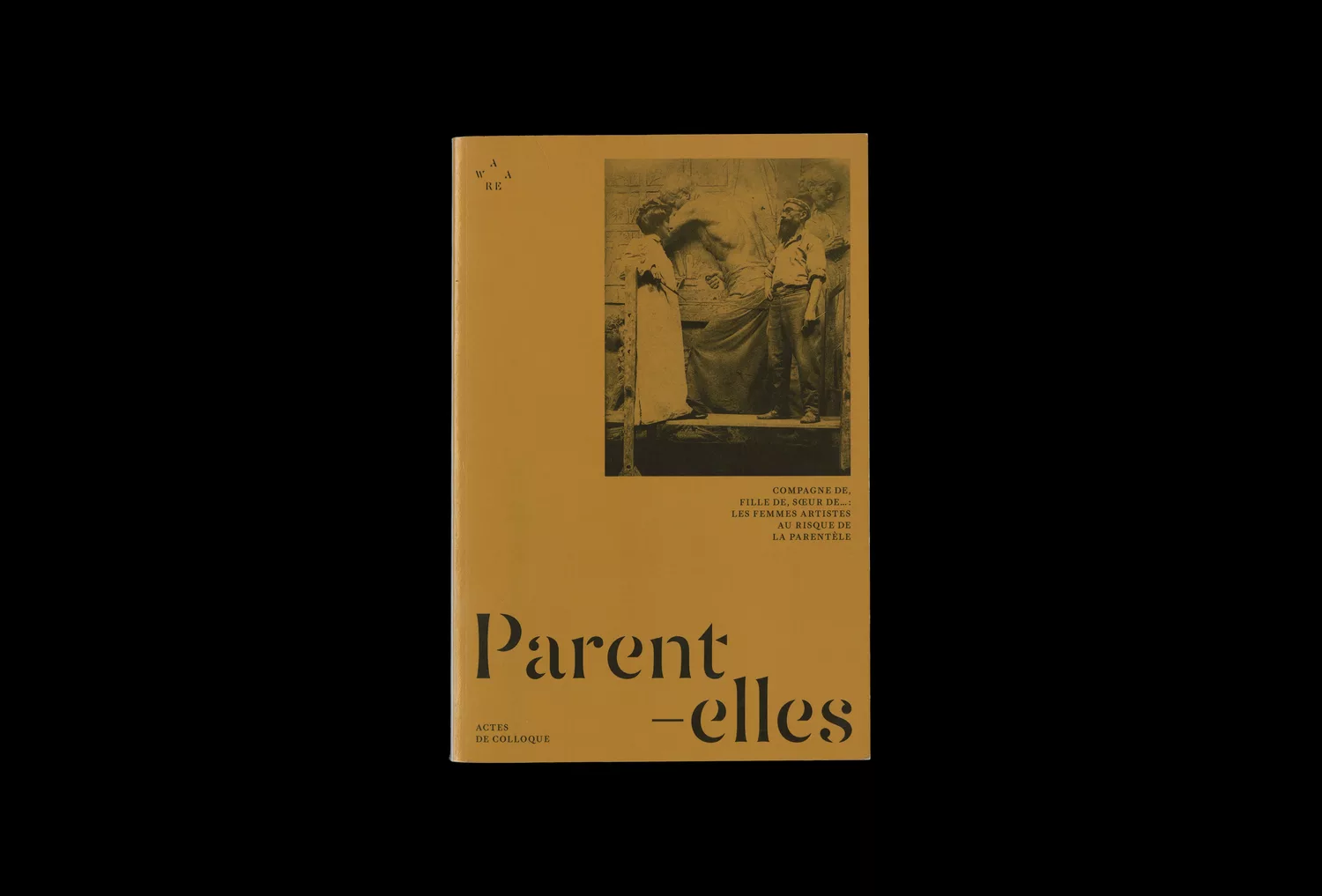Éditions
Cet ouvrage fait suite à la tenue d’un colloque international organisé les 23 et 24 septembre 2016, par le Musée Sainte-Croix, l’université de Poitiers (Criham) et l’association Archives of Women Artists, Research and Exhibitions (AWARE) à la faveur de l’exposition Belles de jour, femmes artistes — femmes modèles, organisée par le musée du 18 juin au 9 octobre 2016. Déployée dans le parcours des collections du musée poitevin, cette exposition, bénéficiant notamment d’un important prêt du Musée des Beaux-Arts de Nantes, explorait la figure féminine comme sujet entre 1860 et 1930, en faisant la part belle aux artistes femmes de Camille Claudel à Romaine Brooks.
- La vocation artistique à l’épreuve du mariage dans la Belgique du XIXe siècle Denis Laoureux
- De femme d’artiste à artiste femme : le combat émancipateur de Maria Cosway Amandine Rabier
- La « vie silencieuse » de Louyse Moillon (1610-1696) Cécile Coutin
- Madeleine Dinès, fille de, femme de : comment n’être pas que « l’envers d’un beau nom » ? Élodie Bouygues
- La parentèle au risque de la photographie ? Amateures et professionnelles au XIXe siècle et au début du XXe siècle (France, Grande-Bretagne, États-Unis) Thomas Galifot
- Des femmes au « caractère ambitieux », n’ayant « aucune envie sincère de s’arranger » : deux épouses de la dynastie Bonnart, éditrices et marchandes d’estampes à Paris sous l’Ancien Régime Pascale Cugy
- Juana Romani (1867-1923), élève de…, maîtresse de… La parentèle sous la plume des critiques d’art Marion Lagrange
- Ottilie Maclaren (1875-1947), « fille » de Rodin ? Eva Belgherbi
- Veuves, mais artistes. Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss après la Seconde Guerre mondiale Julie Verlaine
- Partenariats stratégiques. Réflexions sur le couple d’artistes autour de 1900 Charlotte Foucher Zarmanian
Veuves, mais artistes. Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss après la Seconde Guerre mondiale
Julie Verlaine
Résumé
À partir des itinéraires comparés de Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss, cet article montre comment les différentes facettes de leur activité pendant le veuvage (1941-1979 pour la première, 1943-1966 pour la seconde) se sont heurtées puis articulées, et comment elles ont été perçues. La parentèle – en l’occurrence ici le lien posthume avec un grand artiste – a été à la fois obstacle et moteur d’une création individuelle et d’une reconnaissance comme artiste pour Mmes « Vve Delaunay » et « Vve Freundlich ». Le nom et l’œuvre des grands disparus ont fait de l’ombre au travail d’artiste de leurs compagnes qui se sont d’abord consacrées à construire leur notoriété posthume et n’ont pas vu leur œuvre reconnue comme création autonome et originale. Ils ont également été des facteurs de notoriété pour leurs veuves, ainsi placées au cœur de la vie artistique parisienne d’après-guerre. Sonia Delaunay parvient cependant mieux que Jeanne Kosnick-Kloss à inverser les rapports de force à son bénéfice.
« Rien n’est moins indiqué pour un peintre que d’être la femme, puis la veuve, d’un peintre et qui pis est, d’un grand peintre. Et rien n’est moins indiqué, non plus, que d’avoir participé très intimement et de la façon la plus active à ses recherches les plus personnelles. »
Par ces mots commence, en 1953, le compte rendu de l’importante exposition personnelle de Sonia Delaunay à la galerie Bing de Paris1. Douze années après la mort de Robert Delaunay survenue en octobre 1941, l’œuvre de l’artiste est toujours rapportée à celle de son compagnon, tout comme son parcours, ses choix et son style, non sans ambiguïté car même si son statut de créatrice peine à s’émanciper de l’ombre tutélaire du mari défunt, en tant que « veuve de » elle bénéficie ainsi d’une évidente notoriété par procuration.
Cette ambiguïté est l’un des traits saillants du statut des veuves d’artistes qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont continué de créer tout en s’occupant de la postérité de l’œuvre de leur compagnon. Une étude des itinéraires comparés de Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss permet de montrer comment les différentes facettes de leur activité pendant la période de leur veuvage (1941-1979 pour la première, 1943-1966 pour la seconde) se sont heurtées puis articulées et comment elles ont été perçues2. Après-guerre, ces deux femmes ont en effet deux identités publiques concurrentes : celle de veuve, chargée de la mémoire, de la transmission et de la patrimonialisation posthumes de l’œuvre d’un autre ; et celle d’artiste, désireuse de voir reconnue son œuvre comme création autonome et (surtout) originale. La parentèle – en l’occurrence ici le lien conjugal posthume avec un grand artiste – semble bien avoir été à la fois obstacle et moteur d’une création individuelle et d’une reconnaissance comme artiste pour Mmes « Vve Delaunay » et « Vve Freundlich ».
Comment expliquer l’invisibilité (ou la quasi-invisibilité) sociale de leur identité d’artiste à la Libération ? Il faut commencer par rappeler que ces femmes d’artistes jouissaient, avant-guerre, d’une moins grande notoriété que leur mari : l’écart préexistant se creuse encore à la mort de ce dernier. À leur niveau respectif, les noms de Robert Delaunay et d’Otto Freundlich, après 1945, deviennent célèbres et leur œuvre fait l’objet d’une nette reconnaissance posthume. Il ne se produit pas une telle hausse de notoriété pour leur compagne, bien au contraire : dans le cas de Sonia Delaunay, très connue dans l’entre-deux-guerres, on constate même une occultation de son travail après 1945. Les lettres qu’elle reçoit à son retour à Paris en février-mars 1945, après plusieurs années passées dans le Sud, l’illustrent bien : ainsi Paul Martin, grand industriel lyonnais, collectionneur d’art et directeur de la Galerie de France, lui parle des toiles de Delaunay qu’il souhaite exposer3. Sans équivoque aucune, Sonia Delaunay n’est, à ses yeux, que la veuve de Robert : il n’est jamais question, dans leur correspondance, de sa création à elle (textile ou plastique). Cette identité prédomine nettement durant plusieurs années : l’engouement dont fait l’objet l’œuvre de Robert Delaunay fait de l’ombre aux créations de Sonia.
Même quand leurs œuvres sont exposées ensemble, et notamment dans les Salons (comme dans celui des Réalités nouvelles, en 1946), les critiques d’art sont dans l’embarras pour parler du lien conjugal entre les deux artistes et de leur proximité créatrice. Si le statut d’artiste de Robert Delaunay et d’Otto Freundlich est une évidence, celui de Sonia Delaunay et de Jeanne Kosnick-Kloss est bien plus incertain : compagnes, assistantes, muses,… les qualificatifs employés les renvoient à l’à-côté de la création, à la passivité, au soutien moral du grand artiste. L’enjeu est crucial : sont-elles de « vraies » artistes, ou simplement des artistes par proximité ? N’ont-elles fait que recevoir, ou ont-elles donné quelque chose à Robert et Otto ? Cette dialectique prendre / recevoir, fort présente dans les textes de cette période, se heurte à une représentation de l’artiste comme inspiré(e) par sa relation au monde et à la méfiance fondamentale par rapport à la création collective, ou partagée.
Évoquer le travail créatif de Sonia Delaunay revient ainsi le plus souvent, pour ses commentateurs après-guerre, à faire (maladroitement) une liste de ce que Robert doit à Sonia, sans pour autant le dévaloriser. San Lazzaro, préfaçant l’exposition consacrée au couple à la galerie Bing en 1958, évoque une tension entre deux individualités autonomes, mais se concentre sur la question des influences4. Le fameux retour à la couleur de Robert en 1911 serait dû à Sonia. Mais prédomine l’idée, renforcée par la mort de l’homme, que sa femme poursuit l’œuvre de Robert par ses propres toiles et ses gouaches, ce qui revient de facto à poser une inégalité de statut, de talent et d’originalité entre les deux. La recherche de schématisme pousse certains critiques à établir des caractérisations bancales, nourries des plus rétrogrades stéréotypes de genre : Bernard Dorival, à l’occasion de l’importante exposition organisée au musée national d’Art moderne en 1967, attribue à Robert Delaunay le sens du monument, de l’espace public, et à Sonia le goût de la vie de tous les jours, du familier, du domestique, du populaire5… L’enjeu est de savoir si Sonia Delaunay a un style propre, et si son œuvre est autonome : en somme, de déterminer si la compagne de Robert Delaunay peut prétendre, elle aussi, à la qualification socialement admise d’« artiste » [ill. 1].
Pour Jeanne Kosnick-Kloss, la donne est un peu différente. Ses expositions dans l’immédiat après-guerre ne sont pas clairement associées à son statut de veuve, qui est alors rarement mis en évidence. Tout se passe comme si on ignorait son lien avec Freundlich, lequel sombre aussi un peu dans l’oubli, pour partie à cause de sa mort en déportation et de l’occultation collective des crimes nazis6.
On trouve dans les archives de Jeanne Kosnick-Kloss quelques articles de presse parus en 1945 lors de son exposition (très confidentielle au demeurant) à la galerie du Verseau dirigée par Raymond Creuze7. Le fait que son prénom n’est, le plus souvent, pas cité peut être interprété de manière positive (reconnue comme artiste, elle n’est pas stigmatisée par une énonciation péjorative, disqualifiant les femmes artistes, en donnant leur prénom) ou négative (elle manque encore de la notoriété signalée par un nom complet…). La conclusion d’un article lui dénie le statut d’artiste : « tout cela reste encore plus décoratif que pictural8 ». Au même moment, un article en anglais paru dans la New Review évoque sa personnalité « bi-sexuée » (« a dual-sexed personnality ») reflétée dans son œuvre, d’abord féminine (mystique, exotique, lyrique) puis masculine (construite). Trois marques de dénigrement sont présentes dans cet article : l’idée qu’elle crée pour s’occuper (« to keep herself busy »), que sa créativité s’exerce en grande partie avec de la laine et des tissus (« self-spun wool »), et que personne n’achète ses œuvres9. Dans Combat, une même rhétorique ambiguë, qui semble louer pour mieux disqualifier, distingue ses travaux abstraits et notamment ses mosaïques, qui renouvellent l’art mural, pour conclure : « Quel sera l’architecte qui utilisera ses magnifiques moyens10 ? » Comme nombre de femmes artistes, Jeanne Kosnick-Kloss se voit dénier la qualification de créatrice, tout juste est-elle une décoratrice ayant besoin d’un architecte pour utiliser ses talents. Son identité de veuve surgit fortuitement au détour d’un article, essentiellement pour souligner qu’elle a bénéficié de la proximité d’Otto Freundlich et été influencée par son œuvre [ill 2].

2. Jeanne Kosnick-Kloss, Composition, ciment, verre, 28 × 26 cm (avec cadre 35 × 33 × 8 cm), Pontoise, musée Tavet-Delacour, DOF 1968.1.99, © Pontoise, musée Tavet-Delacour.
La moindre visibilité de Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss n’est pas uniquement subie : toutes deux ont volontairement cherché, dans les années suivant la fin de la guerre, à se mettre en retrait, laissant l’ombre portée par leur compagnon disparu dissimuler leur propre travail créatif. Un premier indice, à la fois très concret et très symbolique, est leur signature dans la correspondance professionnelle : Sonia Delaunay signe, non plus Sonia Terk ou Sonia Delaunay-Terk, mais « Sonia Vve Robert Delaunay ». Pour Jeanne Kosnick-Kloss, qui n’était pas mariée avec Otto Freundlich, le geste est encore plus volontaire : elle ne peut légalement signer « Mme Vve Freundlich », et pourtant elle le fait dans les correspondances artistiques et financières. Ainsi la Société de la propriété artistique des dessins et modèles (SPADEM) donne une attestation le 11 juin 1957 confirmant que Jeanne Kosnick-Kloss essaie tout à la fois de prouver qu’elle est l’ayant-droit d’Otto Freundlich (et peut donc percevoir le droit de suite sur ses œuvres), d’obtenir le droit d’accoler son nom au sien et d’être naturalisée française11.
La mission mémorielle et promotionnelle qu’elles choisissent de mener pour l’œuvre de leur compagnon entre en conflit avec leur propre activité de création : elles manquent de temps pour tout faire et tâchent, du moins dans les premières années de leur veuvage, de donner la priorité à la postérité de Delaunay et Freundlich. « Je ne m’appartiens pas » écrit Sonia Delaunay dans son autobiographie-journal à l’entrée du 8 mai 194612. Neuf ans plus tard, à l’entrée du samedi 29 janvier 1955 : « Je réalise pour Robert ce qu’il rêvait d’avoir : être parmi les premiers peintres de son époque13. » Jeanne Kosnick-Kloss formule différemment la même idée dans une lettre à son ami Tonyko Navarro en 1964 qui évoque l’atelier de la rue Henri Barbusse [ill 3] : « Je suis occupée non seulement par mon travail d’artiste, que je remets souvent au lendemain, par manque de temps, de concentration, mais aussi actuellement par l’embellissement de l’atelier de notre inoubliable Otto, qui y reste et restera toujours le ‹ Maître › ; après les réparations de la toiture et des poutres de l’intérieur, voilà maintenant le nettoyage des murs par la peinture. Et vue la hauteur de l’‹ autel › de cette ancienne chapelle, ce travail est très dangereux et il est fait par un jeune poète de Moravie, qui désire aussi devenir un vrai peintre, et qu’il faut aider par la suite14. »
Il est notable que le qualificatif de « travail » soit employé par les deux veuves dans leur correspondance et leurs écrits autobiographiques pour désigner aussi bien ce qu’elles font pour la postérité de l’œuvre de leur compagnon (gestion de l’atelier, classement et inventaire des œuvres, prêts et dons, organisation d’expositions, publications) que leur création. D’une manière plus générale, il apparaît que la reconnaissance de leur compagnon est facteur d’une notoriété par procuration, elle-même à l’origine d’une dynamique de promotion personnelle.
La mise au service de la mémoire et de l’œuvre d’un autre peut en effet faire naître un espace de valorisation personnelle, non seulement en matière de position socio-culturelle dans le champ artistique (Sonia Delaunay et Jeanne Kosnick-Kloss sont reconnues, respectées et même valorisées, comme veuves d’un grand artiste) mais aussi pour promouvoir leur propre travail d’artiste. Un exemple probant de cette évolution est donné par la correspondance entre Sonia Delaunay et le marchand d’art Henri Bing-Bodhmer, qui reflète un changement progressif de rapports de force15. Au départ de leur collaboration, en 1951, l’asymétrie entre homme et femme est très forte. En témoignent notamment les accords financiers passés pour les œuvres : Bing s’engage à réaliser des achats fermes d’œuvres de Robert Delaunay avant de présenter l’exposition « Hommage à Robert Delaunay » en 1952, à hauteur de 5,7 millions de francs réglés avant le vernissage. Concernant les œuvres de Sonia Delaunay, la galerie accepte la même année que certaines soient mises en dépôt et proposées à la vente, tout en s’octroyant une commission de 30 % sur le prix payé en cas de vente. Une fois que la galerie Bing aura fait une exposition, tous frais à sa charge, elle gardera 50 % sur les prix de vente (en outre, une œuvre est offerte par Sonia après son exposition en 1953).
Progressivement, Sonia Delaunay devient plus autonome, et son œuvre fait véritablement son entrée sur le marché de l’art. Une valeur, tant esthétique que financière, commence à lui être reconnue. L’un des jalons importants dans ce processus est l’achat par l’État, pour le musée national d’Art moderne, du Bal Bullier en 1953. Cet achat se produit en quelque sorte grâce à Robert et à sa notoriété : en octobre 1952, Bernard Dorival demande à Sonia Delaunay si elle accepte de prêter des œuvres de son défunt mari pour l’exposition Cubisme qu’il prépare ; lorsqu’il visite l’atelier de la rue Saint-Simon, le conservateur étend son invitation à Sonia et est frappé par le Bal Bullier. Il revient avec Jean Cassou, le 11 décembre 1952 : « Ils ont demandé à voir mon Bullier et avaient l’air de l’aimer beaucoup. On va l’exposer aussi. Cassou a demandé si je vendais cette toile, j’ai dit que oui, elle est très encombrante, elle a besoin d’être restaurée 16 ». Le 7 avril 1953, le service des Travaux d’art écrit à Sonia pour lui demander à quel prix elle accepterait de céder sa toile à l’État. Celle-ci est assurée pour une valeur de 600 000 francs ; Sonia propose de la vendre pour 200 000 francs. L’accord officiel porte comme destinataire « à Sonia Delaunay, artiste-peintre ».
À partir du milieu des années cinquante, Sonia Delaunay prend de l’assurance comme artiste : dans ses discussions avec son marchand Henri Bing, elle remet les choses au point, durcit le ton et refuse que des toiles en dépôt soient considérées comme propriété de la galerie. Elle oppose le traitement dont elle fait l’objet à celui d’Arp et Magnelli qui ont exposé avec elle chez Bing :
« Je suis désintéressée, mais ce n’est pas une raison pour que l’on me traite autrement que les autres. Je me connais assez en peinture pour connaître ma propre valeur, même si pendant un temps assez long je me suis volontairement effacée. Pour me résumer je vous propose de garder mes 18 tableaux en dépôt et aux conditions convenues – 50 % en cas de vente. J ’envisagerais alors de faire prochainement une exposition chez vous – malgré les propositions que me font d’autres Galeries et après les Expositions que je vais avoir à Venise, Milan et Bâle, organisées par des personnes très emballées par ma peinture17. »
Bing, dans sa réponse, conteste cette vision des choses et s’attribue le succès de Sonia18. La querelle s’envenime, Bing et Sonia Delaunay font intervenir leurs avocats qui parviennent à un règlement à l’amiable en 1957 : l’artiste laisse 14 tableaux d’elle en dépôt chez Bing, qui s’engage à organiser une exposition sur des œuvres du couple, en novembre-décembre 1957.
Sortie gagnante de ce bras de fer, Sonia Delaunay est désormais poussée à distinguer nettement son œuvre de celle de Robert. Chose notable, ce sont des femmes qui l’accompagnent dans cette démarche, d’abord des galeristes puis des conservatrices de musées. À New-York dans un premier temps, Peggy Guggenheim et surtout Rose Fried tiennent un discours d’« empowerment » très fort et encouragent Sonia Delaunay à sortir de l’ombre de Robert, à prendre la place qu’elle mérite19. L’artiste ne répond pas directement aux injonctions de Rose Fried… mais accepte de faire une exposition solo à New York. Un peu plus tard, c’est avec la galeriste parisienne Denise René que Sonia Delaunay noue des liens importants : un contrat signé en 1962, renouvelé par tacite reconduction en 1965, rompu en 1968, engage Denise René à organiser des expositions personnelles en France et à l’étranger, en échange d’un droit de première vue sur les œuvres nouvelles de Sonia Delaunay, d’un droit de représentation exclusive mondiale, sauf en Allemagne et en Suisse, d’une commission sur toute vente de 40 % du prix20. Cette action importante de médiatrices dans la promotion de Sonia Delaunay comme femme artiste se poursuit ensuite au musée : Simone Guillaume à Nancy en 1972, Lise Carrier à La Rochelle en 1973, Marie-Claude Beaud à Grenoble en 1974, Agnès de la Beaumelle au CNAC en 1976 ont toutes œuvré à sa reconnaissance comme artiste.
On note une même présence très importante des femmes dans l’entourage de Jeanne Kosnick-Kloss, à commencer par Sonia Delaunay qui la soutient financièrement et moralement, lui donne des vêtements (ce que Jeanne Kosnick-Kloss appelle « les bienfaits que vous m’avez accordés sous forme vestimentaire21 » ) et lui prête des tableaux pour des expositions non-marchandes. Jeanne Kosnick-Kloss est intégrée à un réseau d’artistes femmes qui s’entraident et se conseillent : ainsi Marcelle Cahn l’encourage et parle d’elle à des galeristes, en particulier à Colette Allendy ; Arlette Susse, qui dirige la célèbre entreprise familiale de fonderie, écrit à des galeries (Marlborough de Londres) et à des musées (Kröller-Müller à Otterlo aux Pays-Bas) pour vanter à la fois le travail d’Otto Freundlich et celui de Jeanne Kosnick-Kloss22. Il est néanmoins bien plus difficile pour Jeanne Kosnick-Kloss que pour Sonia Delaunay de s’affirmer. Elle tente, dans les années soixante, quelques timides approches auprès des musées : sollicitée par Bernard Dorival en décembre 1962 pour qu’une grande sculpture architecturale de Freundlich soit exposée au Palais de la Découverte dans une exposition collective, Jeanne Kosnick-Kloss argumente – maladroitement – pour qu’une de ses œuvres soit également présentée, faisant valoir à la fois l’imminence d’une exposition du couple à Berlin, et conditionnant le prêt d’une œuvre de Freundlich à la présence d’une de ses œuvres à elle23. Dorival refuse sèchement. Jeanne Kosnick-Kloss ne prête finalement qu’une Sculpture architecturale d’Otto Freundlich. L’année suivante, elle répond à une nouvelle demande de prêt d’œuvres :
« Ne figurant pas sur votre liste sous mon nom d’artiste, J. Kosnick-Kloss, je me permets de vous demander s’il n’était pas encore possible d’être acceptée. J ’ai exposé dans différents Musées, Saint-Étienne, Yverdon, Zurich, Le Havre, Royaumont… Dans ce cas, je serais en mesure de mettre à votre disposition deux bronzes : ‹ Le Mémorial en souvenir de Otto Freundlich › actuellement en petite dimension pouvant être agrandi jusqu’à 2 mètres de hauteur. La Sauterelle (moyenne) dont ci-inclus les reproductions24. »
En soulignant les liens entre ses œuvres et le souvenir de son mari, Kosnick-Kloss pense à juste titre avoir plus de chances de figurer dans l’exposition, sans pour autant être reconnue comme une artiste autonome. Dans l’ensemble, son œuvre reste méconnue. Le discours nécrologique prononcé par René Drouin, président
de l’association « Les Amis d’Otto Freundlich » qu’elle a fondée en 1957, retient surtout son altruisme :
« Elle fut la compagne fidèle et inlassable de Otto Freundlich, partageant une vie de pauvreté. À ce titre seul, sa vie méritait d’être honorée. Son œuvre, qu’elle avait commencée seule avant de le rencontrer, en a reçu naturellement une influence, mais surtout une justification. Son imagination l’entraînait à se servir de toutes les techniques. Peintures, tapisseries, sculptures et mosaïques exposées au Musée de Pontoise, attestent de leur qualité. Enfin, elle ne rêvait que d’aider les jeunes artistes, de leur permettre de travailler. Elle l’a fait souvent au-delà de ses moyens. Cet atelier Otto Freundlich, situé 38 rue Henri-Barbusse, relevait de la sainteté25. »
En revanche, l’œuvre de Jeanne Kosnick-Kloss, comme celle de Sonia Delaunay, entre avec l’œuvre de leur compagnon au musée – le musée national d’Art moderne pour Sonia Delaunay, qui effectue le 14 janvier 1964 une donation de 32 œuvres de Robert et de 55 œuvres d’elle-même. Quelques mois plus tard, en juin 1964, Sonia Delaunay renonce à son usufruit, ce qui permet l’installation immédiate des œuvres dans les galeries du musée ; le musée de Pontoise pour Jeanne Kosnick-Kloss qui lègue le fonds d’atelier de la rue Henri-Barbusse. Leurs œuvres sont-elles pour autant accrochées aux cimaises, reproduites au catalogue, prêtées et valorisées ? Bien moins que celles de leur compagnon, qui font partie des chefs-d’oeuvre du musée récipiendaire.
Néanmoins, la logique patrimoniale, en misant sur un bénéfice indirect du principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises, leur donne la chance (une chance que d’autres artistes femmes n’ont pas eue, faute d’avoir un mari jugé digne d’entrer au musée) d’être redécouvertes, exhumées, réévaluées. C’est ce qui s’est produit, assez rapidement, pour Sonia Delaunay ; peut-être est-ce à venir pour Jeanne Kosnick-Kloss.
Julie Verlaine est maîtresse de conférences en histoire culturelle contemporaine à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et membre du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058, CNRS/Paris I). Ses recherches portent sur les rapports entre arts et sociétés à l’époque contemporaine, avec une attention particulière portée au marché de l’art, à l’histoire des collections publiques et privées et aux processus de patrimonialisation.
« Sonia Delaunay, galerie Bing », Art d’aujourd’hui, 4e série no5, juillet 1953, p. 31.
2
Les archives Delaunay ont été consultées au centre de documentation du musée national d’Art moderne (Paris), celles de Jeanne Kosnick-Kloss et Otto Freundlich à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Abbaye d’Ardenne, près de Caen). Complétées par des sources imprimées (presse, catalogues d’exposition) et orales (entretiens), ces archives constituent les sources principales de cet article qui s’inscrit dans un travail de recherche plus large sur veuvage et postérité après 1945. La démonstration s’appuie sur des archives financières (contrats avec les galeries, factures), des correspondances (avec d’autres artistes, des galeristes et des conservatrices de musées) et des publications (catalogues d’exposition).
3
Lettres de Paul Martin à Sonia Delaunay, 6 février, 17 mars et 23 mars 1945, B.04 fonds Delaunay, bibliothèque Kandinsky, Paris.
4
San Lazzaro, préface au catalogue de l’exposition consacrée à Robert et Sonia Delaunay, Galerie Bing, Paris, 29 novembre-31 décembre 1957 ; voir Œuvres de jeunesse de Robert et Sonia Delaunay : œuvres récentes de Sonia Delaunay, cat. expo., Paris, Galerie Bing, 1957.
5
Bernard Dorival, préface au catalogue de l’exposition Sonia Delaunay organisée par le musée national d’Art moderne de Paris en 1967 ; voir Michel Hoog, Rétrospective Sonia Delaunay, Paris, Réunion des musées nationaux, 1967.
6
Sur Otto Freundlich, voir Alain Bonfand, Otto Freundlich, Paris, La Différence, 1988.
7
Coupures de presse, B.5, chemise 4, 1945-1948, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
8
« À travers les galeries et les expositions », s. n. s. d., chemise « Coupures de presse », B.5, chemise 4, 1945-1948, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
9
New Review, 22 mai 1945, B.5, chemise 4, 1945-1948, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
10
Combat, 11 octobre 1945, B.5, chemise 4, 1945-1948, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
11
« Madame Kloss nous dit être l’héritière de l’œuvre de Freundlich selon la dernière volonté de ce dernier, dont l’original lui a été transmis par l’assistance sociale de la Croix Rouge. Madame Kloss continue à faire des dons en son nom et étant donné les sentiments qui la liaient à cet artiste, elle aimerait pouvoir porter son nom comme pseudonyme accolé à son nom d’artiste Kosnick-Kloss. » Lettre de la SPADEM, 11 juin 1957, fonds Otto
Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
12
Sonia Delaunay, Nous irons jusqu’au soleil, Paris, Robert Laffont, 1978, p. 147.
13
Ibid., p. 183.
14
Lettre de Jeanne Kosnick-Kloss à Tonyko Navarro, 27 février 1964, B.4, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
15
Dossier Galerie Bing, 1951-1970, B.06, fonds Delaunay, bibliothèque Kandinsky, Paris.
16
Note manuscrite de Sonia Delaunay, s.d. [11 décembre 1952], B.06, fonds Delaunay, bibliothèque Kandinsky, Paris.
17
Lettre de Sonia Delaunay à Henri Bing-Bodmer, 28 septembre 1956, B.06bis, fonds Delaunay,
bibliothèque Kandinsky, Paris.
18
« Indépendamment de l’exposition que j’ai faite de vos œuvres, j’ai exposé continuellement
vos tableaux sur mes cimaises, et ai propagé l’idée, dont je suis profondément convaincu,
que Sonia Delaunay est la grande femme peintre de notre époque. Lorsque j’ai commencé
à vous exposer, vos œuvres n’avaient pas, de loin, le succès qu’elles peuvent avoir maintenant,
puisque selon vos propres dires, les demandes d’exposition vous viennent maintenant
de partout, et que les Musées s’intéressent à l’acquisition de vos tableaux. » Lettre d’Henri Bing-Bodmer à Sonia Delaunay, 9 novembre 1956, B.06bis, fonds Delaunay, bibliothèque Kandinsky, Paris.
19
“In my opinion, it would be wrong to put a reproduction of Robert’s work on the cover of your catalogue. I want to push your work now – it is about time that the collectors saw the difference between you and Robert and gave you the place you deserve. But that is not to say that we can’t reaffirm Robert’s important position through this exhibit. What do you think about this?” (« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre une reproduction d’une œuvre de Robert en couverture de votre catalogue. C’est votre travail que je veux désormais mettre en avant : il est temps que les collectionneurs voient la différence entre vous et Robert, et te donnent ainsi la place que vous méritez. Ceci ne les empêcherait toutefois pas de réaffirmer l’importance de Robert au travers de l’exposition. Qu’en pensez-vous ? »), lettre de Rose Fried à Sonia Delaunay, 25 novembre 1957, B.30, fonds Delaunay, bibliothèque Kandinsky, Paris.
20
Correspondance entre Sonia Delaunay et Denise René, 1961-1968, B.29, fonds Delaunay, bibliothèque Kandinsky, Paris.
21
Brouillon d’une lettre de Jeanne Kosnick-Kloss à Sonia Delaunay, 22 octobre 1958, B.07, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
22
« L’idée me vient qu’il se pourrait qu’un jour vous soyez intéressés par l’œuvre (peinture, sculpture monumentale, relief, etc) d’Otto Freundlich et de sa femme Madame Kosnik-Kloss Freundlich qui est de la même envergure, de la même ligne et de la même importance quoique hélas trop peu connue. Si vous aviez l’occasion de venir à Paris, il me semble que vous pourriez trouver dans l’atelier de madame Freundlich matière à une très belle exposition. (…) » Lettre d’Arlette Susse à Marlborough Gallery (Londres), 20 décembre 1962, B.10, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
23
Lettre de Jeanne Kosnick-Kloss à Bernard Dorival, B.10, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
24
Lettre de Jeanne Kosnick-Kloss à Denys Chevalier, 26 mars 1963, B.08, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.
25
B.01, fonds Otto Freundlich Jeanne Kosnick-Kloss, IMEC, abbaye d’Ardenne.