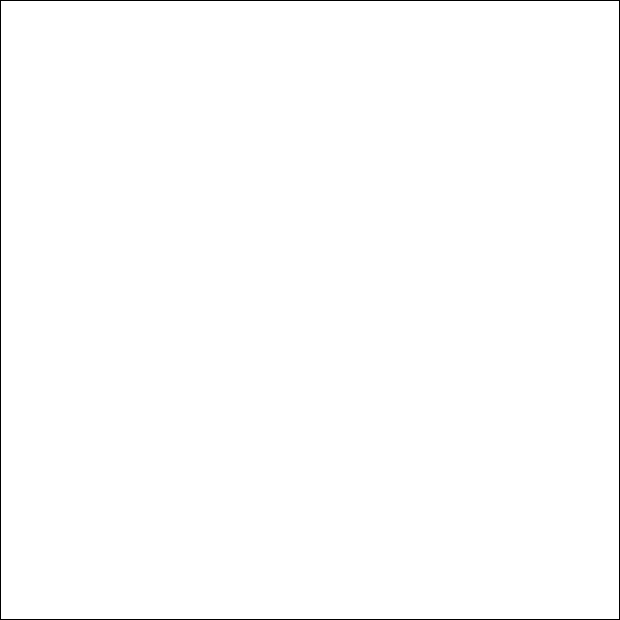Critique
Myriam Bat-Yosef (1931-2023) bénéficie d’une exposition monographique, la première depuis plusieurs années, qui offre un modeste mais néanmoins complet survol de sa carrière, en embrassant la diversité des médiums employés avec cohérence par l’artiste.

Myriam Bat-Yosef, Donner à voir. Hommage à Paul Éluard, 1984, © ADAGP, Paris

Myriam Bat-Yosef, La Tour des prières, 1977, © ADAGP, Paris
La trajectoire complexe de M. Bat-Yosef dans le XXe siècle est liée autant à l’histoire transnationale de ce qu’on a appelé un temps l’école de Paris qu’à un certain mode de survivance du surréalisme. En effet, bien que l’artiste n’ait jamais formellement pris part aux activités du groupe fédéré par André Breton, qui assignait aux femmes un rôle premièrement passif en leur déniant simultanément presque toute capacité d’agir et toute inscription dans le canon1, on retrouve chez elle cette idée de résolution des antinomies propre à l’esprit surréaliste2 – augmentée de ses lectures de la Kabbale et de son imprégnation du tao.
Il en va ainsi de l’opposition supposée entre l’art et la vie, que M. Bat-Yosef rend caduque dès 1964 en recouvrant de peinture des objets usuels, ce dont témoignent ici une dizaine d’exemples tardifs (1984-1993). Or s’il y a effectivement lieu d’associer ce geste à celui dont rend compte le ready-made3, il importe de considérer l’intrication immédiate de ces œuvres avec une pratique de la performance, où le corps est également peint, comme une riposte féministe directe aux Anthropométries (1960) d’Yves Klein et un écho aux happenings impulsés à la même époque à Paris par Jean-Jacques Lebel, qui ne se distinguaient habituellement pas non plus par leur émancipation du corps féminin4. La transition d’une problématique à l’autre est articulée par un poste de télévision diffusant des vues de performances en regard d’un autre objet peint, La Tour des prières (1977). La présence à côté de l’objet d’une photographie documentant son activation par l’action induit une interrogation supplémentaire sur son statut, quand son existence en tant qu’image dans des travaux sur papier renseigne sur son importance au sein des représentations propres à l’artiste.
D’une série de travaux à l’autre, la grande cohérence de l’ensemble exposé par M. Bat-Yosef repose sur ses tentatives de figuration d’un sentiment extatique ressenti dans son corps, au travers d’enchevêtrements cryptés de couleurs. On peut se rappeler utilement, sur ce point, tant les rapports entre l’expérience mystique et la sexualité (faisant écho au titre de la manifestation) que la confusion recherchée, encore une fois, entre l’art et l’existence dans cette forme de vie. En ce sens, le fait que la Maison nationale des artistes soit un lieu destiné à l’accueil d’artistes âgé·e·s en perte d’autonomie, où les résident·e·s sont susceptibles de poursuivre leur activité, corrobore tout à fait le décloisonnement qui fonde la substance du travail de M. Bat-Yosef.
Désir, Myriam Bat-Yosef, du 8 juin au 26 août 2018, à la Maison nationale des artistes (Nogent-sur-Marne, France).
Chadwick Whitney, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, Paris, Thames & Hudson, 2002.
2
« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. » André Breton, « Second manifeste du surréalisme », dans André Breton, « Second manifeste du surréalisme », La Révolution surréaliste, no 12, 15 décembre 1929, p. 1.
3
Notons, entre autres, que l’artiste expose par trois fois, en 1964, 1969 et 1972, à la galerie d’Arturo Schwarz à Milan, qui, on s’en souvient, a entretenu des liens étroits avec Marcel Duchamp.
4
Le rapprochement entre M. Bat-Yosef, Y. Klein et J.-J. Lebel ainsi que cette orientation de lecture sont le fait de Sarah Wilson, à partir d’un entretien avec l’artiste. Voir Wilson Sarah, « Rites de passage : Myriam Bat-Yosef et la performance », dans Pascaud Fabrice (dir.), Myriam Bat-Yosef. Peintures, objets, performances/Paintings, objects, performances, Paris, Somogy, 2005, p. 95-97.
Valentin Gleyze, « Myriam Bat-Yosef, le désir au corps » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 27 juillet 2018, consulté le 5 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/myriam-bat-yosef-le-desir-au-corps/.