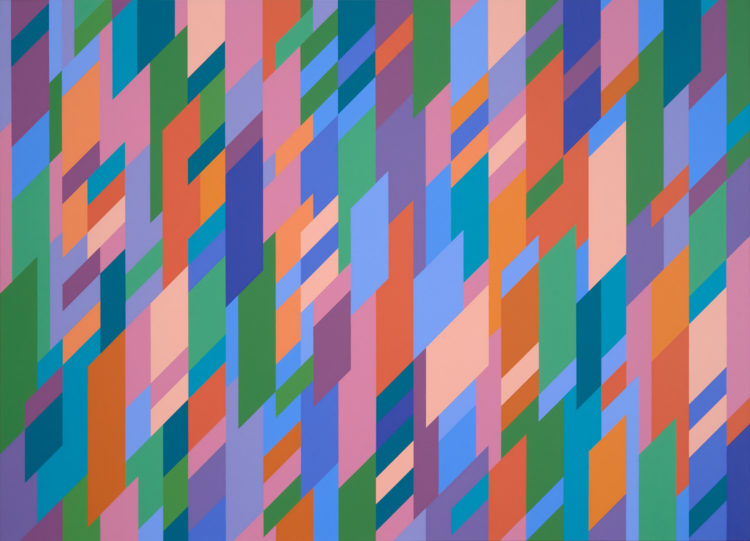Joan Mitchell
Bernstock Judith E., Joan Mitchell, New York, Hudson Hills Press, 1988
→Nochlin, Linda (dir.), The Paintings of Joan Mitchell, cat. expo., Whitney Museum of American Art, New York ; Birmingham Museum of Art ; Modern Art Museum of Fort Worth ; Phillips Collection, Washington (2002-2004), New York/ Berkeley/Los Angeles/Londres, Whitney Museum of American Art/University of California Press, 2002
Joan Mitchell, galerie nationale du Jeu de paume, Paris, 22 juin – 11 septembre 1994 ; musée des Beaux-Arts, Nantes, 24 juin – 26 septembre 1994
→Joan Mitchell, Young Museum, San Francisco, 1er novembre – 31 décembre 2007
→Joan Mitchell Retrospective: Her Life and Paintings, Kunsthaus Bregenz, 18 juillet – 25 octobre 2016 ; Museum Ludwig, Cologne, 14 novembre – 22 février 2016
Peintre états-unienne.
Joan Mitchell est l’une des plus grandes peintres américaines du XXe siècle, l’équivalent de ses contemporains expressionnistes abstraits, Jackson Pollock (1912-1956) ou Mark Rothko (1903-1970), sachant qu’elle abhorrait toute forme de catégorisation de l’art. Fille d’une poétesse et d’un médecin artiste amateur, elle hésite un temps entre la poésie et les arts plastiques. Elle étudie, dans le sillage de ses parents cultivés, à la Francis W. Parker School de Chicago, où son professeur d’art lui fait découvrir Oskar Kokoschka. À l’Art Institute de Chicago, elle suit les cours de l’artiste allemand Robert Von Neumann et de Louis Ritman, peintre russe ayant séjourné à Giverny. Elle passe, dans une forme d’isolement créatif volontaire, l’essentiel de sa carrière à Vétheuil, village situé au-dessus de la Seine, qu’elle dit avoir choisi « par hasard », à quelques kilomètres seulement de Giverny, deux lieux « inventés » par Claude Monet (1840-1926), lequel exercera sur son œuvre, d’après elle, une influence moindre que Paul Cézanne (1839-1906) ou Vincent Van Gogh (1853-1890).
En 1948, J. Mitchell s’installe à Paris où elle loue un atelier rue Galande. Après un voyage au Lavandou au début de l’année 1949, elle épouse Barney Rosset (le futur grand éditeur). Elle retourne à New York à la fin de l’année où elle travaille dans le même immeuble que Philip Guston (1913-1980) et fréquente les lieux de l’avant-garde artistique américaine comme l’Artist’s Club, où les seules autres femmes admises sont Elaine de Kooning,Lee Krasner et Helen Frankenthaler. Quoique ses œuvres soient abstraites, et ce, dès 1951, elle se décrit comme une peintre « visuelle », à la recherche de la sensation. La peinture qu’elle met au point dans cette période, large, lumineuse, énergique, s’appuie sur l’exemple de la nature, dans laquelle la couleur joue un rôle essentiel. « Je peins des paysages remémorés que j’emporte avec moi, ainsi que le souvenir des sentiments qu’ils m’ont inspirés, qui sont bien sûr transformés… », dira-t-elle.
Si son processus créatif est lent, œuvre de J. Mitchell se reconnaît à sa graphie hâtive, à la ligne expressive, à la composition éparse et fourmillante, au chromatisme acide, au vide méditatif, au renversement du motif. Pierre Schneider parle aussi de « navette perpétuelle entre l’intériorité et l’extériorité ». Simultanément, elle fait la rencontre à Paris de Sam Francis et du Canadien Jean-Paul Riopelle (1923-2002), dont elle va partager la vie pendant plus de vingt ans. Jusqu’en 1959, elle passe autant de temps à Paris qu’à New York, puis finit par choisir la France comme nouvelle patrie. À partir de 1967, date de l’achat de sa maison de Vétheuil où elle ne s’installe que l’année suivante, son galeriste parisien Jean Fournier la montre régulièrement, tandis que l’art américain est plutôt marqué par les développements du pop art et les débuts du minimalisme. L’utilisation du polyptyque, dès la seconde moitié des années 1960 (Girolata Triptych, 1963 ;Chicago, 1966), ajoute de la force à son œuvre. En 1969, elle réalise ses premières œuvres de la série des Tournesols en hommage à Van Gogh, initiant le principe de nombreuses séries (Tilleul, 1978 ; La Grande Vallée, 1983-1984 ;Champs, 1990). Présentée largement au public, à l’occasion d’une exposition présentant ses œuvres récentes (1974) organisée par la célèbre conservatrice du Whitney Museum of American Art de New York, Marcia Tucker, son œuvre est ensuite soutenue par le galeriste new-yorkais Xavier Fourcade (entre 1976 et 1987). Après la mort de ce dernier, elle est représentée dans cette ville par la galerie Robert Miller. En 1979, J. Mitchell se sépare de J.-P. Riopelle. Son œuvre fait l’objet d’une première exposition rétrospective au musée d’Art moderne de la Ville de Paris (1982). En 1989, elle installe pour ses séjours parisiens un atelier rue Campagne-Première, où elle peint au pastel. Quant à sa démarche picturale, elle la décrit avec franchise : « Je suis émue par les couleurs mises ensemble sur une surface plane […], pas excitée par une idée. »
© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013




 Joan Mitchell | On This Spot NYC, février 2024 (anglais)
Joan Mitchell | On This Spot NYC, février 2024 (anglais)  Interview de Joan Mitchell dans son atelier
Interview de Joan Mitchell dans son atelier  Portrait de Joan Mitchell
Portrait de Joan Mitchell