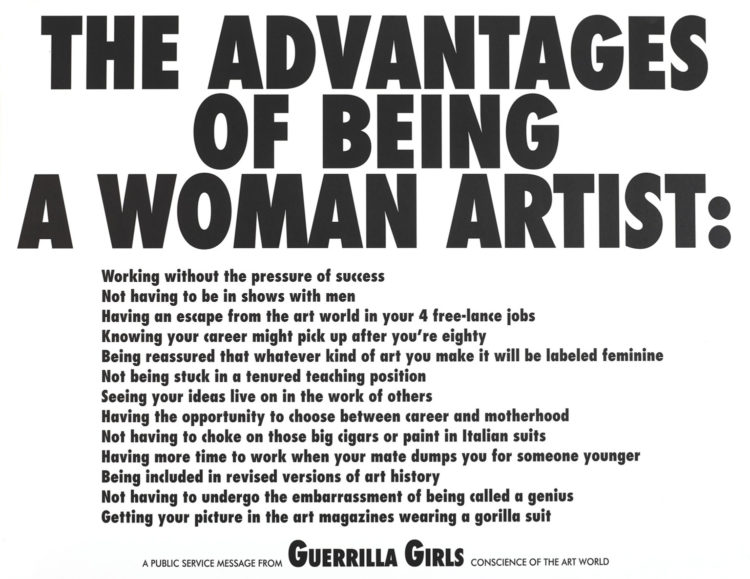Long Sophea
Corey, Pamela N., « The ‘First’ Cambodian Contemporary Artist,” Udaya: Journal of Khmer Studies, no 12, 2014, p. 61–94
→Nov, Ana, McPhillips, Jody, « Handcrafted Silk Batik Mixes With Traditional Khmer Art, » The Cambodia Daily, 25 octobre 2000
→Muan, Ingrid, article inédit (sans titre), vers 1998, Ingrid Muan Archives, boîte 15, dossier 61–80, National Museum of Cambodia Library, Phnom Penh
2nd Fukuoka Asian Art Triennale, Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, 21 mars – 23 juin 2002
→Batik: Hand Painting on Silk (exposition individuelle), Reyum Institute, Phnom Penh, octobre – décembre 2000
→Communication (exposition collective), Situations Gallery (renommé plus tard Reyum Institute), Phnom Penh, décembre 1998
Artiste textile cambodgienne.
« Je voulais montrer la fragilité de la vie… son imprévisibilité », déclare Long Sophea dans un entretien, à la fin des années 1990. Elle est alors une artiste très active et éminente au Cambodge, à une époque où le pays réintègre les réseaux artistiques régionaux et mondiaux, après des décennies d’isolement dues à la guerre civile et au génocide.
Les œuvres d’art textile de L. Sophea sont caractérisées par sa grande maîtrise technique comme par sa sensibilité délicatement poétique. La Valeur de la vie (1999), par exemple, est peint à la main sur de la soie, avec des couches de teinture appliquées sur des couches de cire, ce qui donne lieu à une représentation semi-abstraite de feuilles et de matière organique. De loin, le tableau se présente comme un lavis de couleurs chaudes ; de près émerge une multitude d’infinitésimaux détails, dont des lignes de diverses épaisseurs, rendues dans des tons froids, ainsi que des traces de coups de pinceaux. Les qualités manuelles du travail du batik deviennent ainsi comparables à celles organiques de la nature.
Chose inhabituelle pour cette période, La Valeur de la vie – comme plusieurs autres œuvres de L. Sophea – évite toute référence visuelle explicite au Cambodge. La répétition de lignes et de formes circulaires rappelle toutefois le système codifié de l’ornementation khmère, connu sous le nom de kbach racana, que l’artiste a étudié. L. Sophea explique que les feuilles imbriquées dans la peinture « symbolisent les relations de toutes sortes, à la fois humaines et naturelles ». (Cette citation, comme la précédente, provient d’un entretien inédit de 1998 entre l’artiste et l’historienne de l’art et curatrice Ingrid Muan.)
En 1985, L. Sophea est diplômée en peinture khmère traditionnelle de l’université royale des beaux-arts de Phnom Penh. Elle est également l’une des rares femmes parmi un groupe de près de vingt-cinq artistes cambodgien·nes envoyé·es suivre des études supérieures dans l’ex-Union soviétique au cours des années 1980. Elle étudie à Kiev, puis à Moscou, et rédige un mémoire de master en russe sur l’art textile et l’esthétique khmères. Elle est diplômée de l’académie d’art et d’industrie Stroganov de Moscou en 1992. Parmi ses camarades de classe figurent des artistes venu·es de Cuba, de Corée, du Nicaragua et d’Europe de l’Est.
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, L. Sophea est la seule artiste exposant au Cambodge qui travaille à partir du textile, et la plus éminente parmi le peu de femmes exposant de manière professionnelle dans le pays à l’époque. Elle est la seule femme cambodgienne invitée à participer à d’importantes expositions, telles que la Fukuoka Asian Art Triennale (2002), au côté de ses pairs masculins, dont Svay Ken (1933-2008) et Prom Sam An (?-?).
À Moscou, L. Sophea maintient une connexion esthétique avec le Cambodge. L’une des œuvres majeures réalisées durant ses études, Printemps (1991), représente Sovanmacha, un personnage du Ramayana khmer, et est inspirée par la salle de conférence de Chaktomuk, conçue par Vann Molyvann (1926-2017), l’architecte le plus éminent du Cambodge. Vers 2005 environ, L. Sophea cesse sa pratique en raison de pressions familiales et financières. Ses œuvres sont conservées dans les collections du Fukuoka Asian Art Museum et de la National Gallery Singapore.
Une notice réalisée dans le cadre du programme The Flow of History. Southeast Asian Women Artists, en collaboration avec Asia Art Archive
© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025