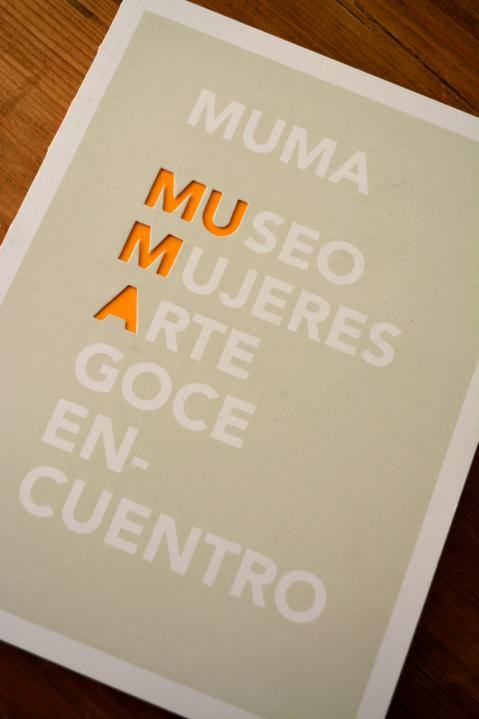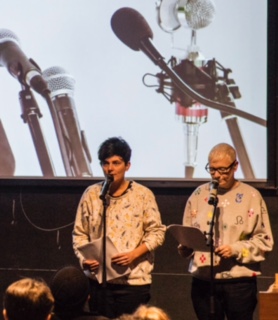Rosemary Mayer
Eva Birkenstock, Laura McLean-Ferris, Robert Leckie, Stephanie Weber (dir.), Rosemary Mayer: Ways of Attaching, cat. exp., Lenbachhaus, Munich (Allemagne), Ludwig Forum, Aix-la-Chapelle (Allemagne), Spike Island, Bristol (Angleterre), Swiss Institute, New York (États-Unis) (2021-2022), Cologne, König Books, 2023
→Warsh, Marie (dir.), Excerpts from the 1971 Journal of Rosemary Mayer, Chicago, Soberscove Press, 2020
→Mayer, Rosemary, avec Julia Ballerini et Richard Milazzo, Pontormo’s Diary, New York et Milan, Out of London Press, 1982
Rosemary Mayer: Ways of Attaching, Swiss Institute, New York, septembre 2021 – janvier 2022
→Rosemary Mayer: Conceptual Works and Early Fabric Sculptures, 1969–1973, Southfirst Gallery, New York, octobre 2016 – janvier 2017
→Rosemary Mayer, A.I.R. Gallery, New York, avril-mai 1973
Artiste états-unienne.
Rosemary Mayer est active sur la scène artistique du sud de Manhattan à partir de la fin des années 1960. Si elle est surtout connue pour ses sculptures en tissu, elle travaille avec une grande variété de médiums et crée aussi des dessins, des aquarelles, des livres d’artiste et des installations en plein air dans lesquels elle explore son rapport au temps, à l’histoire et à la biographie. Elle passe la majeure partie de sa vie à New York, principalement dans un loft du quartier de Tribeca, au sud-ouest de Manhattan.
R. Mayer naît et grandit dans le quartier new-yorkais de Ridgewood, qui s’étend à la frontière de Brooklyn et du Queens et accueille une importante communauté d’immigré·e·s allemand·e·s. Ses parents meurent tous les deux à la fin des années 1950 et, en 1962, elle épouse Vito Acconci, qu’elle a rencontré au lycée. Ils s’installent en Iowa, où elle étudie les humanités classiques et lui la poésie. R. Mayer refuse une bourse de Harvard qui lui aurait permis de poursuivre ses études classiques et décide plutôt de se lancer dans une voie artistique. Elle retourne à New York, où elle prend des cours au Brooklyn Museum of Art et à la School of Visual Arts. V. Acconci et elle divorcent en 1969, mais ils restent liés pendant plusieurs années en raison de leur implication commune sur la scène artistique avant-gardiste. Plusieurs œuvres des débuts de R. Mayer sont publiées dans la revue d’art expérimentale 0 to 9 (1967-1969), éditée par V. Acconci et la sœur cadette de R. Mayer, la poétesse Bernadette Mayer.
Au début des années 1970, R. Mayer commence à exposer son travail, qui est alors influencé par sa participation à un groupe de conscientisation féministe réunissant plusieurs amies artistes, dont Adrian Piper (1948-) et Donna Dennis (1942-). En 1972, elle est choisie pour cofonder la A.I.R. Gallery, la première galerie coopérative de femmes des États-Unis. Une exposition individuelle lui y est consacrée au printemps 1973, avec notamment trois grandes sculptures intitulées d’après des femmes de l’histoire ; la plus élaborée d’entre elles est Galla Placidia (1973), ainsi nommée d’après une impératrice romaine du Ve siècle. Elle démissionne de la coopérative en 1974, frustrée par ce qu’elle considère comme un engagement inégal dans le projet et par une atmosphère parfois compétitive.
Les sculptures de R. Mayer sont, à partir du début des années 1970, des déclarations délibérément féministes, qui puisent aussi dans l’intérêt profond de l’artiste pour les états fragiles et éphémères ainsi que dans ses études d’histoire de l’art et d’humanités classiques, qu’elle explore dans toutes ses œuvres par la suite. À la fin des années 1970, elle réalise une série d’installations en plein air à partir de matériaux périssables, comme des ballons et de la neige. Elle leur donne la forme de tentes, en cherchant à immortaliser et à célébrer les personnes et leur rapport au temps, à l’espace et à la nature. Dans un autre corpus d’œuvres produit au milieu des années 1980, elle investigue les formes et les fonctions de la vaisselle grecque classique pour créer une série de sculptures de papier et de tissu qu’elle solidifie avec de la colle de peau de lapin. R. Mayer inclut aussi du texte dans nombre de ses œuvres. Elle écrit enfin des essais qui sont publiés dans diverses revues artistiques, dont White Walls et Heresies, et produit un numéro du magazine d’avant-garde Art Rite. Sa publication la plus importante est Pontormo’s Diary (1982), qui rassemble sa traduction du journal de l’artiste maniériste Jacopo da Pontormo (1494-1557), des essais sur son propre travail et un catalogue de ses œuvres.
Dans les années 1990, R. Mayer commence à enseigner l’art, puis elle devient professeure à LaGuardia Community College, dans le Queens. Inspirée par le fait d’enseigner la narration graphique, elle travaille à l’illustration d’œuvres de littérature épique, dont Beowulf et l’Épopée de Gilgamesh. Son dernier projet, intitulé 100 Years, est une histoire des femmes des Empires romain et byzantin écrite et illustrée par ses soins.
Dans les années 1970 et 1980, R. Mayer expose son travail dans de nombreux lieux alternatifs de New York, dont la Clocktower, Franklin Furnace et le Woman’s Interart Center, ainsi que dans diverses galeries universitaires, mais elle a très peu de liens avec les galeries commerciales, et aucune exposition institutionnelle majeure ne lui est par ailleurs dédiée de son vivant. Depuis sa mort en 2014, sa succession a contribué à organiser plusieurs expositions et publications, qui ont permis d’élargir l’intérêt à son sujet. Ses œuvres se trouvent au Museum of Modern Art de New York, à By Art Matters de Hangzhou, à la Lenbachhaus de Munich, au Museum of Fine Arts de Boston et dans nombre de collections privées.