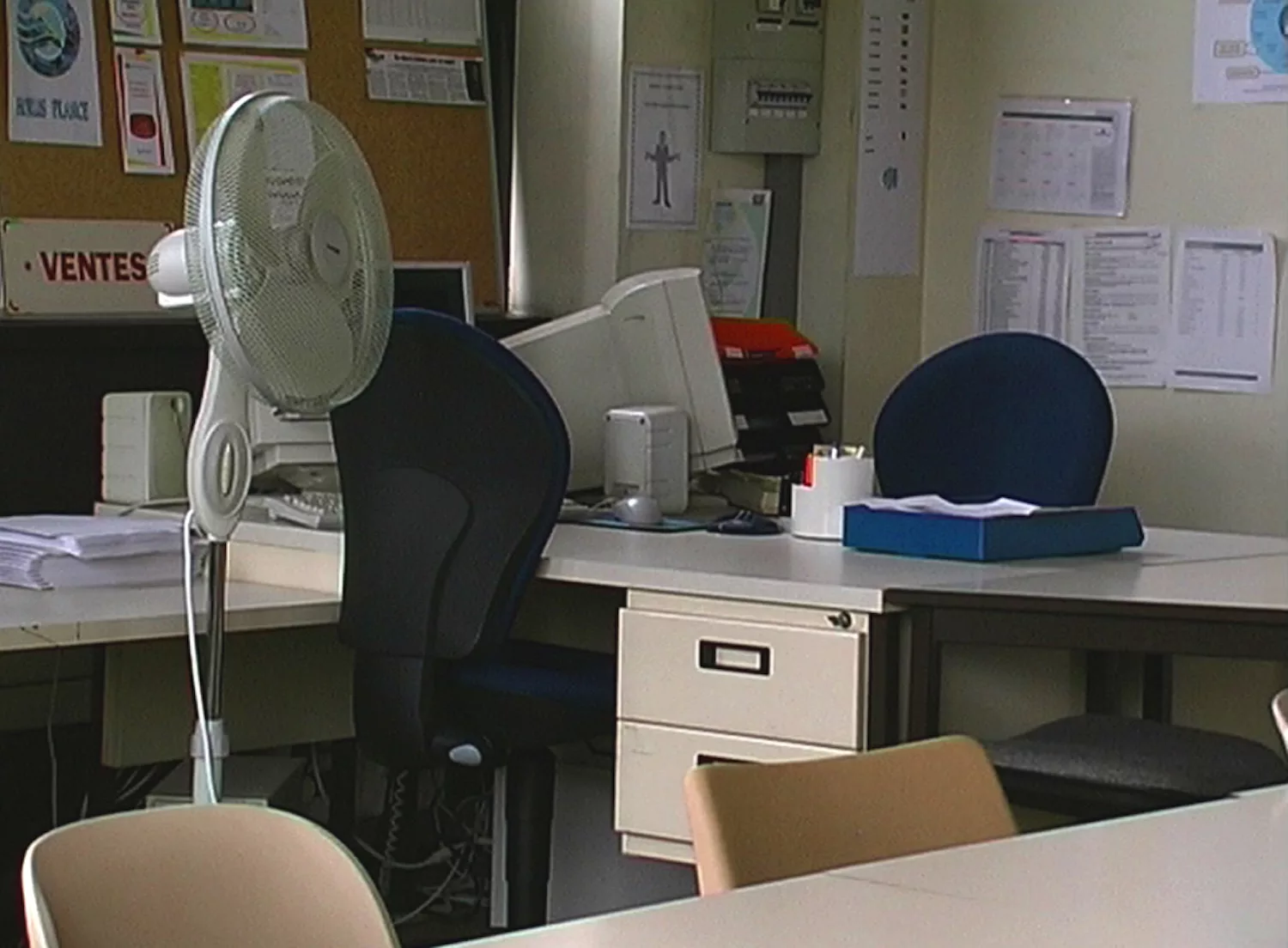Marie Voignier
Caillet Aline, Gallois Christophe, Roman Mathilde, Marie Voignier, Il n’est pas question d’explications, Rennes, éds. Presses Universitaires de Rennes, coll. Les arts à l’essai, 2023
→Voignier Marie, Original Copy, Paris, éds. Librairie Petite Égypte et Marcelle Alix, 2020
→Voignier Marie, La piste rouge, colonisation, travail forcé et sorcellerie dans le sud-est camerounais, Paris, éds. B42, 2017
Tinselwood, LAXART, Los Angeles, 30 mars–18 mai 2019
→International Tourism, Staging Real Life, Beirut Art Center, Beyrouth, 25 juillet – 7 octobre 2018
→Hinterland, CAC, Brétigny, 15 février – 21 mars 2009
Artiste et cinéaste française.
Après des études d’ingénieure à Compiègne puis à Berlin, Marie Voignier quitte cette route toute tracée pour bifurquer sans but précis, animée par ses engagements féministes et libertaires. De retour en France, elle entre aux Beaux-Arts de Lyon pour y poursuivre la pratique de la photographie à laquelle elle s’était initiée à Berlin. Elle préférera finalement la vidéo, dans un registre documentaire. Le genre, alors mineur au sein de l’école, est très bien représenté dans les festivals de cinéma qu’elle fréquente assidûment et porte en lui la promesse d’un art adossé au réel, d’une écriture complexe, politique, non dogmatique. Comme pour mieux en finir avec les sciences physiques, Marie Voignier termine ses études d’art avec Les Fantômes (2004), un film au titre programmatique tant il est question chez elle d’observer l’irreprésentable, avec toujours en main les outils du cinéma et une attention toute particulière à ce qui arrive. De ses années de double formation, elle garde une capacité à observer de très près alliée à une volonté de donner forme à l’intangible.
Avec à ce jour douze courts et moyens métrages, Marie Voignier construit une pratique qui se nourrit de ses propres expérimentations ; d’un film à l’autre, elle précise une méthode, un point de vue, une approche. Hearing the Shape of a Drum (2010) est sans doute un film fondateur par lequel elle négocie sa propre place au sein de la machinerie médiatique. Avec son équipement léger, elle se mêle aux journalistes devant les portes closes du tribunal lors du procès de l’affaire Fritzl, en Autriche. En l’absence d’images du père incestueux et alors que la situation touche à l’irreprésentable, Marie Voignier tourne sa caméra vers les dispositifs télévisuels et documente une fabrique du spectacle tournant presque à vide. Malgré l’effet repoussoir d’une pulsion scopique collective, elle reconnaît dans cette capacité à produire un récit à partir de fragments, une puissance propre au cinéma.
À son tour, Marie Voignier ruse avec les illusions du dispositif cinématographique et de la mise en scène. En première spectatrice de situations critiques qu’elle a identifiées, elle adopte la partialité du point de vue du témoin. Elle aborde l’événement par ses symptômes, à peine perceptibles, à peine audibles, à peine tangibles. À notre tour, on la suit pas à pas dans ses déambulations, comprenant à demi-mot ce qui jusqu’ici nous semblait étranger, par exemple le bellicisme d’agriculteurs démunis face aux nuées d’étourneaux ravageurs (Le Bruit du canon, 2006) ; l’obsession d’un cryptozoologue pour une bête qu’il imagine tapie dans les profondeurs d’un fleuve au Cameroun (L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé, 2011) ; le contrôle de soi de guides touristiques répétant la propagande d’État en Corée du Nord (Tourisme international, 2014) ; les habitant·es d’une forêt en Afrique exerçant par nécessité diverses formes d’extractivisme (Tinselwood, 2017) ; la ténacité de commerçantes spécialisées dans les copies de produits de luxe entre la Chine et le Cameroun (Na China, 2020) ; les risques pris par des migrant·es et les dilemmes des réseaux d’aidant·es dans la vallée de la Roya (Moi aussi j’aime la politique, 2022)… Au fil d’une écriture cinématographique qui affirme sa partialité se dessinent en creux de plus vastes réseaux d’influence – le capitalisme mondial, les relents du colonialisme, l’exploitation des ressources naturelles, la reproduction des rapports de domination. Ces images-là sont si grandes qu’il ne s’agit pas, pour Marie Voignier, de les capturer en un seul mouvement mais plutôt d’en saisir quelques-uns des mécanismes complexes qui s’expriment à travers des formes de proximité. Représentées par les moyens du cinéma, ces abstractions si implacables deviennent alors plus concrètes, plus familières, et sans doute aussi mieux contestables.
Une notice réalisée dans le cadre du programme +1.
© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025