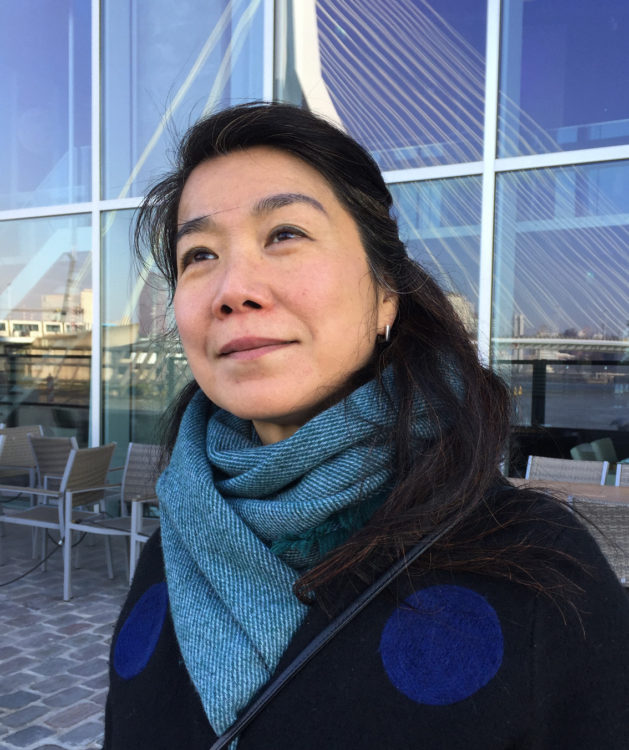documentation céline duval (doc-cd)
« Céline Duval », entretien avec Timothée Chaillou, dans Garance Chabert et Aurélie Mole (dir.), Les Artistes iconographes, Paris, Empire Éditions, 2018
→« documentation céline duval », entretien avec Jérôme Dupeyrat, dans id., Entretiens. Perspectives contemporaines sur les publications d’artistes, Rennes, Incertain Sens, 2018
→Anne Dietrich, « La destruction dans le processus de constitution de l’image : documentation céline duval », dans Egaña Miguel et Schefer Olivier (dir.), Esthétique des ruines. Poïétique de la destruction, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
les choses voient, Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars, juin-octobre 2014
→l’archipel des images, Micro Onde, Centre d’art de l’Onde, Vélizy-Villacoublay, septembre-décembre 2013
→images déployées, Centre régional de la photographie, Douchy-les-Mines, février-avril 2013
Iconographe française.
Étudiante à l’École des beaux-arts de Nantes, Céline Duval s’intéresse aux photographies publicitaires, soigneusement découpées dans des revues, puis recueille des cartes postales et des photos de famille, révélant les stéréotypes inhérents aux usages vernaculaires de l’image. À partir de 1999, devenue iconographe professionnelle, elle choisit de se faire connaître sous le nom de « documentation céline duval ».
L’œuvre de doc-cd se présente comme un fonds photographique composé d’images de natures différentes : certaines ont été prises par l’artiste, les autres sont le fruit d’une collecte parmi de nombreux supports imprimés (clichés amateurs, cartes postales, publicités, etc.). Ce fonds, loin d’être figé, accepte les dons, les prêts, les échanges, voire les destructions. Les milliers d’images qui le constituent sont envisagées sous l’angle de la comparaison, de la confrontation et de l’accumulation, révélant les usages photographiques derrière l’anecdote. Classées, répertoriées, elles sont considérées par l’artiste comme une écriture en tant que telle, qui ne nécessite aucun texte additionnel. Dans ce cadre, doc-cd refuse, d’une part, l’exposition de ses images dans un contexte institutionnel, où elles seraient accolées les unes aux autres de manière à former un ensemble, et, d’autre part, la mise en avant d’une photographie unique pour des raisons esthétiques. La sobriété l’emporte sur le démonstratif, afin que les images soient envisagées pour elles-mêmes et non comme illustration.
Ayant originellement pour point de départ ce fonds photographique, les œuvres de doc-cd reprennent les potentialités de l’image imprimée : installations (papiers peints, sucettes publicitaires, drapeaux…), estampes (sérigraphies, posters offset…), cartes postales, collages (série des tilt entre 1998 et 2007, où sont confrontées deux images se faisant écho), etc. À partir de 2001, l’artiste publie également des éditions, d’abord la Revue en quatre images (soixante parutions entre 2001 et 2009), qui opère à chaque numéro des rapprochements entre quatre images issues de clichés anonymes familiaux, par thèmes : le pique-nique derrière l’automobile, le jeu de colin-maillard, les photographies de bibliothèques… Entre 2001 et 2002, elle édite aussi sept Cahiers d’images en collaboration avec Hans-Peter Feldmann (1941-2023). Par la suite, elle travaille à des livres d’artiste, seule (sur un pied, 2010 ; cœur, point et ligne sur plan, 2013, d’après le fonds Vassily Kandinsky…) ou en collaboration (le jeu le cahier du dimanche avec Serge Elleinstein, 2006 ; l’édifice avec Nicolas Fructus, 2008-2009…).
En 2010, doc-cd brûle une partie du fonds, soit la totalité des images reproductibles (revues, publicités…), documentant cette destruction implacable et ritualisée dans une série de vidéos, Les allumeuses 1998-2010 (2011). À partir de cette série, l’artiste ne fait plus entrer de nouvelles images dans le fonds, qu’elle donne à la fin de la décennie au Musée royal de Mariemont (Belgique). De 2004 à 2024, elle enseigne à l’ésam Caen, faisant évoluer sa pédagogie et son travail autour de l’image imprimée à ceux du vivant au jardin. Les interactions entre les êtres, qui la passionnaient dans la photographie, se développent désormais au sein de l’association le chant des ourses (avec Blandine Barthélemy) : débarrassée des images, Céline Duval cherche à réinventer d’autres manières de vivre et de demeurer en mouvement.
Une notice réalisée dans le cadre du programme +1.
© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024



 Céline Duval rencontre Michel Poivert | Jeu de Paume, février 2016
Céline Duval rencontre Michel Poivert | Jeu de Paume, février 2016