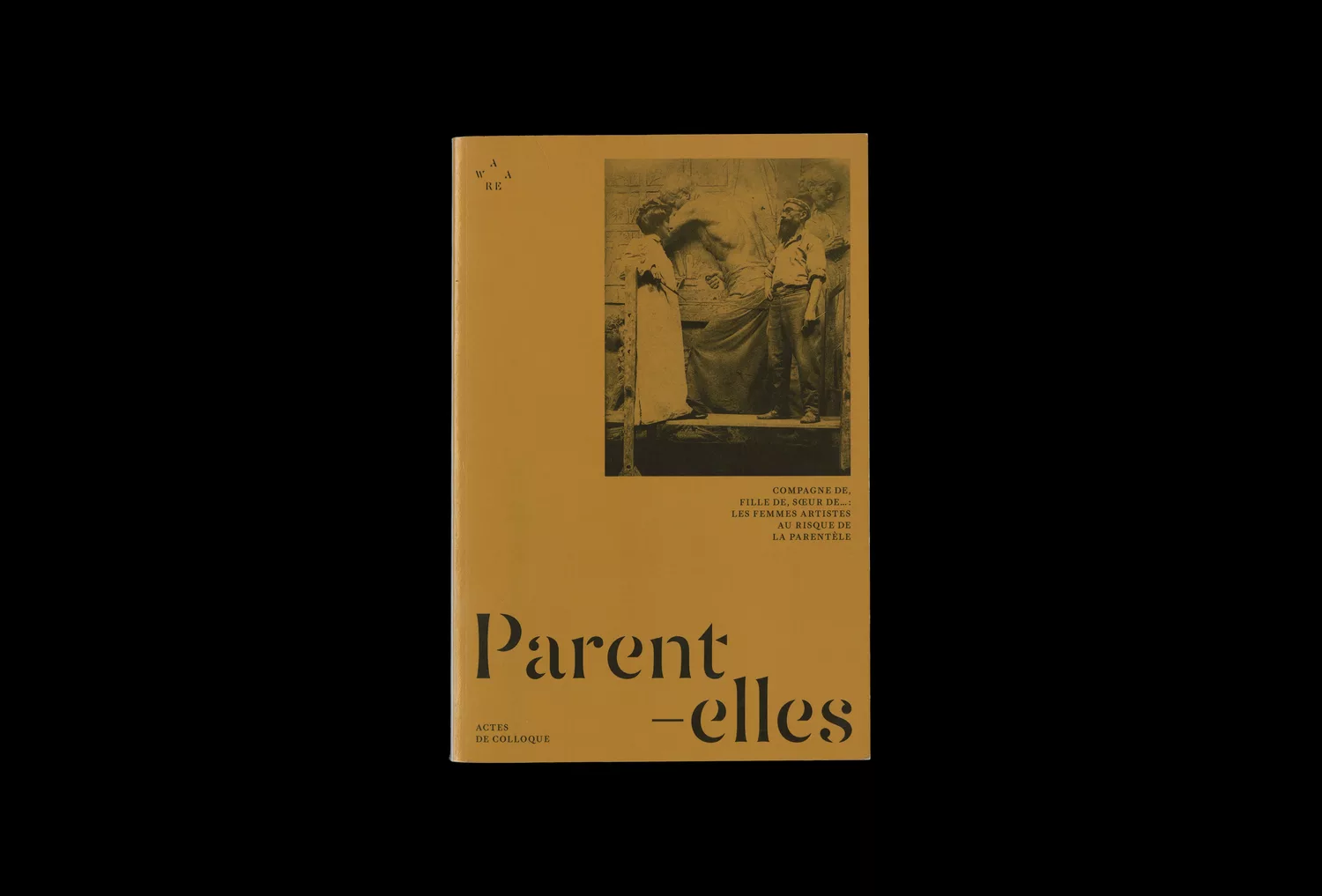Publications
Cet ouvrage fait suite à la tenue d’un colloque international organisé les 23 et 24 septembre 2016, par le Musée Sainte-Croix, l’université de Poitiers (Criham) et l’association Archives of Women Artists, Research and Exhibitions (AWARE) à la faveur de l’exposition Belles de jour, femmes artistes — femmes modèles, organisée par le musée du 18 juin au 9 octobre 2016. Déployée dans le parcours des collections du musée poitevin, cette exposition, bénéficiant notamment d’un important prêt du Musée des Beaux-Arts de Nantes, explorait la figure féminine comme sujet entre 1860 et 1930, en faisant la part belle aux artistes femmes de Camille Claudel à Romaine Brooks.
- The clash between an artistic vocation and marriage in 19th-century Belgium Denis Laoureux
- From artist’s wife to woman artist: the emancipative battle of Maria Cosway Amandine Rabier
- The “silent life” of Louyse Moillon (1610–1696) Cécile Coutin
- Madeleine Dinès, daughter of, wife of: how to invert a famous name? Élodie Bouygues
- Family relations risked by photography? Amateur and professional women in the late 19th and early 20th centuries (France, Great Britain and the United States) Thomas Galifot
- Women of “ambitious character”, with no “real desire to compromise”: two wives of the Bonnart dynasty, publishers and print-sellers in Paris during the Ancien Régime Pascale Cugy
- Juana Romani (1867–1923), pupil of …, mistress of … Family relationships as commented by art critics Marion Lagrange
- Ottilie Maclaren (1875–1947), Rodin’s “daughter”? Eva Belgherbi
- Widows but artists. Sonia Delaunay and Jeanne Kosnick-Kloss after World War II Julie Verlaine
- Strategic partnerships: Reflections on artist couples around 1900 Charlotte Foucher Zarmanian
From artist’s wife to woman artist: the emancipative battle of Maria Cosway
Amandine Rabier
Abstract
Like Angelica Kauffmann, Mary Moser and Anne Seymour Damer before her, Maria Cosway benefited from the support of her father and then her husband in the development of her artistic career. Like her elders, she found herself torn between her need for and rejection of male protection and emulation. Maria Cosway strove for recognition as a history painter. Unlike her contemporaries, however, she did not achieve emancipation as an artist, but as an educator and through the transfer of knowledge and artistic practice. It is this latter path that this presentation discusses, showing how, by turning her back on her status as the wife of an artist, Maria Cosway was led to a second renunciation, one that brought her true emancipation: the abandonment of her career as an artist in favour of overseeing the education of young girls.
[Full-length text only available in French]
Le cas Maria Cosway n’a presque jamais été étudié indépendamment de la carrière de son époux Richard1. Même l’étude la plus récente, celle de Carol Burnett Divided Affections: The extraordinary life of Maria Cosway: Celebrity Artist and Thomas Jefferson’s Impossible Love2 qui se veut une monographie de l’artiste, ne peut s’empêcher, de manière quasi romancée, de mettre l’accent sur la passion suscitée par un « amour impossible », mêlant notoriété et pouvoir, entre l’artiste et le futur troisième président des États-Unis. Difficile, même lorsque l’on est reconnue comme une artiste singulière, d’exister entre deux hommes, le peintre miniaturiste et académicien Richard Cosway et Thomas Jefferson. De même, dans son dictionnaire des peintres anglais3, Allan Cunningham consacre uniquement une entrée à Richard Cosway. La biographie du peintre commence classiquement, allant de la formation au succès jusqu’au mariage avec Maria Hadfield. Dès lors, le récit se transforme et Cunningham d’enchevêtrer les deux biographies dans un même récit laissant une large place à Maria, comme si l’histoire du peintre devenait le prétexte pour évoquer la personnalité de son épouse4.
Ce glissement fait selon nous écho au cheminement de Maria Cosway, qui l’amènera progressivement à s’affranchir de l’art afin de parvenir à s’émanciper en tant que femme. Dans son parcours, l’activité artistique est en effet autant une affirmation que le rappel d’une sujétion. Nous voulons montrer comment Maria va se départir de son statut de femme-artiste, étroitement lié à son statut de femme d’artiste, pour obtenir son indépendance de femme.
En Angleterre, au XVIIIe siècle, les femmes qui parviennent à jouir d’une réputation et à exercer une activité artistique régulière sont le plus souvent liées à la communauté masculine par des attaches familiales ou matrimoniales5. Maria Cosway ne déroge pas à cette règle. Elle naît en Toscane, d’un père britannique et d’une mère italienne, propriétaires d’auberges qui voyaient passer les personnalités britanniques durant leur Grand Tour. Elle reçoit une éducation catholique dans un couvent placé sous la protection du grand duc et de la duchesse de Toscane où elle apprend la musique et le dessin. À l’adolescence, elle devient l’élève du peintre Zoffany puis de Joseph Wright of Derby, lors de leur passage à Florence. Son père l’emmène à Rome dans les années 1770, où elle rencontre Battoni, Mengs et Fuseli. Elle est élue membre de l’Académie de Florence en 1778. Mais, à cette époque, elle perd son père et veut rentrer dans les ordres. Sa mère la convainc pourtant de partir à Londres et, en 1780, pour remédier à leurs problèmes financiers, elle arrange son mariage avec le très en vogue peintre, miniaturiste et académicien, Richard Cosway, de 20 ans son aîné6.
Le couple fonctionne très vite comme un binôme où Richard Cosway tient une posture ambivalente. Il l’encourage à continuer la peinture et devient son « instructeur7 ». À la suite de son mariage, elle expose à la Royal Academy aux côtés de son époux qui obtient cette année-là une critique moins favorable8. En 1782, année de l’exposition du Cauchemar de Fuseli, elle exécute le portrait de Georgianna, Duchess of Devonshire as Cynthia9 qui obtient un immense succès10. Exploitant l’aura de sa jeune épouse, Richard Cosway aime mettre son couple en scène comme outil de promotion11. Dans les représentations que Richard Cosway fait de sa compagne, l’artiste laisse souvent place à la muse, ou à l’épouse, notamment lorsque Richard assimile son couple à celui de Rubens et Isabelle Brant12 ou Hélène Fourment13. Cosway est ce que l’on appelle alors un macaroni, une de ces figures désireuses de cultiver la mode aristocratique du continent. C’est donc le respect de l’apparence qui prime pour cet homme qui s’efforce de construire l’image d’un couple élégant. Dans ses portraits de couple, il choisit donc son bon profil, et fait de sa femme un miroir de lui-même.
Dans leur propriété de Schomberg, Maria tient salon, organise des concerts, joue de la harpe. Le tout Londres est là. Elle est l’ambassadrice du couple, quitte à devenir, dans une gravure de Richard14, un élément de décor, faisant le pendant exact avec un pot de fleurs.
Si Richard encourage Maria dans son activité artistique, en revanche, il lui interdit l’accès au statut d’artiste professionnel, comme elle le déplore dans une lettre de 1830 : « Si M. Cosway m’avait autorisée à me ranger parmi les peintres professionnels, j’aurais dû être une meilleure artiste mais laissée à moi-même, je cessai peu à peu de progresser et perdis tout ce que j’avais appris durant mes jeunes années en Italie15 ». La dépendance financière était la dernière entrave que Cosway pouvait imposer à une femme à l’aura sociale si forte16. La confiner à l’amateurisme était aussi une solution pour bénéficier de ses talents sans en subir l’ombrage. La critique ne fut pas dupe comme en témoignent deux caricatures17 parodiant deux portraits du couple exécutés par Richard18. Ici [ill. 1] c’est Maria qui est représentée en peintre, certes aliénée, mais peintre tout de même.

1. Artiste inconnu, Maria Costive at her studies, 1786, gravure à l’eau-forte, 24 × 15,4 cm, Londres, British Museum, © Trustees of the British Museum.

2. Valentine Green after Maria Cosway, em>Self-portrait, 1787, mezzotint, 45.9 × 33.4 cm, Londres, British Museum, © Trustees of the British Museum.
Le dessin de Richard la montrait près d’un arbre, dans la caricature l’arbre est remplacée par un chevalet avec, autour d’elle, ses œuvres exposées à la Royal Academy entre 1782 et 1786 qui sont toutes des peintures d’histoire. On peut voir dans cette figure d’aliénée une métaphore de l’excentricité de ses compositions peu convenables pour une femme. Il semble ainsi que le caractère et le style d’un homme peintre tel que Fuseli deviennent, sous le pinceau d’une femme, indécent. Plus redoutable encore à l’égard de Richard cette fois, dans la caricature, une gravure de celui-ci sert de napperon à une coupelle de Maria, soulignant ainsi l’insignifiance de son travail de miniaturiste face au grand genre dans lequel elle s’illustre. On voit là ce qui menaçait l’époux si, d’aventure, il eut perdu le contrôle de sa femme.
Dans ce tiraillement constant, Maria semble peiner à trouver sa place, entre mondanité et activités artistiques. Un autoportrait, dont nous montrons ici la gravure [ill. 2], illustre ce dilemme : Maria se représente les bras croisés, en position d’attente ou de défiance vis-à-vis d’elle-même. Elle laisse apparaître son alliance à sa main gauche. Inscrit sur le muret, son corps est assigné à l’intérieur, contraint à ses obligations domestiques et maritales, tandis que son visage, inscrit sur un ciel façon Vigée Le Brun, trahit cette dichotomie entre être et paraître. Une croix autour du cou souligne sa préférence pour les questions spirituelles plutôt que pour les mondanités auxquelles elle est contrainte. Nous sommes loin des pauses macaroni de Richard Cosway. Ceci semble préfigurer les transformations qui conduiront à son émancipation.
Le 29 juillet 1796, son unique fille décède d’une infection pulmonaire. À partir de cet événement tragique s’opère, selon nous, en deux temps, son émancipation en tant que femme.
En 1800, elle publie un ensemble de gravures dans une veine hogarthienne The Progress of Female Virtue and Progress of Female Dissipation inspiré d’un ouvrage de Mary Wollstonecraft, Original Stories from Real Life. Ce cycle illustre d’un côté l’itinéraire d’une femme vertueuse, exemplaire, et de l’autre celui de la femme dévoyée par les vices d’une société frivole. C’est le conflit intérieur de l’artiste qui se manifeste là : son combat pour que ses qualités supplantent la simple recherche du plaisir et lui permettent enfin de devenir qui elle est. Ici, le médium artistique est appréhendé d’une autre manière. Le dessin et la gravure ne sont plus une fin en soi mais un instrument pédagogique, au service d’un nouveau projet: l’éducation des jeunes femmes.
La deuxième étape a lieu en 1801, lorsque Maria, avec la permission de son époux, part seule à Paris, afin de constituer un recueil de gravures recensant tous les tableaux exposés au musée du Louvre fraîchement ouvert.
Ce projet offre une double opportunité : la possibilité de s’affranchir de ce carcan marital, et la rencontre d’un nouveau cénacle. Elle côtoie la famille de Bonaparte et Vivant Denon, retrouve Jacques Louis David qui a une grande estime pour son travail, les peintres Gérard, Vincent, Vigée Le Brun. C’est ce cercle qui la mène à son nouveau destin. Elle se lie d’amitié avec l’oncle de Bonaparte, Joseph Fesch qui, devenu cardinal à Lyon, lui propose de prendre la direction en 1807 d’une nouvelle pension de jeunes filles. Si le retour des tensions politiques entre la France et l’Angleterre ne permet pas à Maria de rester à ce poste, sa vocation est trouvée.
En 1811, le Duc de Lodi achète le couvent de Lodi pour y installer une pension sur le modèle lyonnais. Elle en prend la direction en 1812. De ses nouvelles fonctions, elle dit : « Aujourd’hui je suis ici (en Italie) — je m’attache à aider cette école à s’établir solidement, ce qui me vaut la réputation d’être la première femme en Italie ayant suivi la vocation qui fut toujours la mienne : m’occuper de bonnes œuvres en faveur des jeunes femmes19. » La mission de se vouer à l’éducation des jeunes femmes fait d’elle une pionnière dans son pays natal. Si ses activités artistiques la liaient nécessairement à son époux ; dans la pédagogie, elle est le seul maître. L’éducation, la professionnalisation, le prolongement de son apprentissage de jeunesse, n’était-ce pas ce dont elle avait manqué, disait-elle, pour devenir une « meilleure artiste » ?
En reconnaissance de sa contribution concernant l’éducation, Maria Cosway est faite Baronne20 par l’empereur Francisco Ier en 1834. Cette précision, qui n’a rien de futile, signifie le plein accomplissement dont parle Maria Cosway, ce titre lui donnant enfin indépendance et respectabilité, sans caution maritale. Sa pension devint une institution reconnue et fréquentée par les jeunes filles de la haute société comme la fille de l’écrivain Alessandro Manzoni. Un tableau de Gabriele Rottini, peint en 1835, en témoigne : Maria Cosway y trône bienveillante, au milieu de toutes les jeunes filles qui la regardent ou lui font la lecture21. Cunningham achève la biographie de Richard Cosway sur ces mots qui pourraient aussi être l’heureuse fin d’un conte féministe moderne : « Sa veuve accomplie lui a survécu et réside aujourd’hui dans sa ville bien aimée de Lodi, où elle a établi son école de jeune filles, et est largement reconnue et respectée22. »
Docteure en histoire de l’art contemporain, Amandine Rabier a enseigné à l’École du Louvre avant d’être ATER à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a consacré sa thèse au peintre Henry Fuseli et à la question des spectacles (théâtre, pantomime, fantasmagories) en Angleterre au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Actuellement chercheuse post-doctorale au Labex Cap, ses travaux se concentrent sur la question de la Gallery comme nouveau mode d’exposition à Londres à la fin du XVIIIe siècle.
Voir George C. Williamson, Richard Cosway, his wife and his pupils, London, George Bell & Sons, 1897 ; voir également l’ouvrage de Stephen Lloyd sur lequel nous nous sommes particulièrement appuyés pour cet article, Stephen Lloyd, Richard & Maria Cosway Regency artists of taste and fashion, Edinburgh, Scottish National Portrait Gallery, 1995 ; Gerald Barnett, Richard and Maria Cosway: a Biography, Tiverton Devon, Westcountry books, 1995.
2
Carol Burnett, Divided Affections: The extraordinary life of Maria Cosway: Celebrity Artist and Thomas Jefferson’s Impossible Love, Column House, 2007.
3
Allan Cunningham, The lives of the most eminent British Painters, Sculptors and Architects, vol. VI, London, J. Murray, 1833.
4
“From this time it becomes the duty of the biographer, in relating the history of the painter, to remember the genius of his wife” (« À partir de ce moment, il est du devoir du biographe, en relatant l’histoire du peintre, de rappeler le génie de son épouse ») dans ibid., p.10.
5
Voir Isabelle Baudino, « Vie des femmes artistes à Londres au XVIIIe siècle : de l’ombre à la lumière ? » dans Bulletin de la société des études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles. Vie, formes et lumière(s), hommage à Paul Denizot, 1999, p. 245-259.
6
Ces informations biographiques sont relatées par l’artiste elle-même dans sa lettre autobiographique. Voir Maria Cosway, « Lettre autobiographique adressée à William Cosway, cousin de Richard Cosway », 1830, manuscrit, Londres, Victoria and Albert Museum, National Art Reference Library, MS (Eng.) L.961-1953, traduction de Anne-Laure Brisac-Chraïbi, dans Anne Lafont (dir.), Plumes et Pinceaux. Discours de femmes sur l’art en Europe (1750-1850)—Anthologie, Dijon, Presses du réel/Inha, 2012.
7
Allan Cunningham, op. cit., p.10.
8
Voir Gazetteer and New Daily Advertiser, May 12, 1781, Archive 16343, 17th-18th Century Burney Collection Newspapers.
9
Maria Cosway, Georgiana, Duchesse du Devonshire en Cynthia, 1782, huile sur toile, Devonshire Collection, Chatsworth House.
10
Voir la réception critique des journaux de l’époque, St James’s Chronicle or the British Evening Post, May 2-May 4 1782, Archives 3301, 17th-18th Century Burney Collection Newspapers, Morning Herald and Daily Advertiser, May 8, 1782, Archive 475, 17th-18th Century Burney Collection Newspapers.
11
Voir Richard Cosway, Autoportrait avec le buste de Michel-Ange et Rubens, 1789, crayon et encre, Lodi, fondation Cosway et Richard Cosway, Maria Cosway avec le buste de Léonard, 1789, crayon et encre, Lodi, fondation Cosway.
12
Nous rapprochons ici l’œuvre de Richard Cosway, Autoportrait avec Maria Cosway, 1785, craie blanche, sanguine et lavis, Lodi, fondation Cosway, de celle de Pierre Paul Rubens, L’artiste et son épouse, Isabella Brant, 1609, huile sur toile, Munich, Alte Pinakothek.
13
Nous rapprochons ici l’œuvre de Richard Cosway, Mr and Mrs Cosway, 1784, gravure à l’eau-forte, Londres, British Museum, de celle de Pierre Paul Rubens, Rubens dans le jardin avec Hélène Fourment, 1631, huile sur toile, Munich, Alte Pinakothek.
14
Voir W. Birch d’après William Hodges et Richard Cosway, A view from Mr Cosway’s Breakfast-room, Pall Mall, with the portrait of Maria Cosway, 1789, gravure au pointillé, Londres, British Museum.
15
Maria Cosway, « Lettre autobiographique adressée à William Cosway, cousin de Richard Cosway », 1830, op. cit.
16
Voir Stephen Lloyd, op. cit., p.45-73.
17
Artiste inconnu, Dicky Causway in Plain English, 1786, gravure à l’eau-forte, Londres, British Museum et artiste inconnu, Maria Costive at her studies, 1786, gravure à l’eau-forte, Londres, British Museum.
18
M. Bova d’après Richard Cosway, Rdus. Cosway Armiger R.A. Primarius Pictor Serenissimi Walliae Principis, 1786, gravure au pointillé, Londres, British Museum et F. Bartolozzi d’après Richard Cosway, Maria Cosway, 1785, gravure au pointillé, Londres, British Museum.
19
Maria Cosway, « Lettre autobiographique (…) » dans Anne Lafont (dir.), Plumes et Pinceaux, op. cit.
20
Stephen Lloyd, Richard & Maria Cosway Regency artists of taste and fashion, op. cit., p. 91.
21
Grabriele Rottini, Baronne Maria Hadfield Cosway écoutant Vittoria Manzoni, 1835, huile sur toile, Lodi, fondation Cosway.
22
“His accomplished widow still survives him, and resides at her beloved Lodi, where she has established her Ladies’ College, and is widely known and respected” dans Allan Cunningham, The lives of the most eminent British Painters, Sculptors and Architects, vol. VI, London, J. Murray, 1833, p. 20.