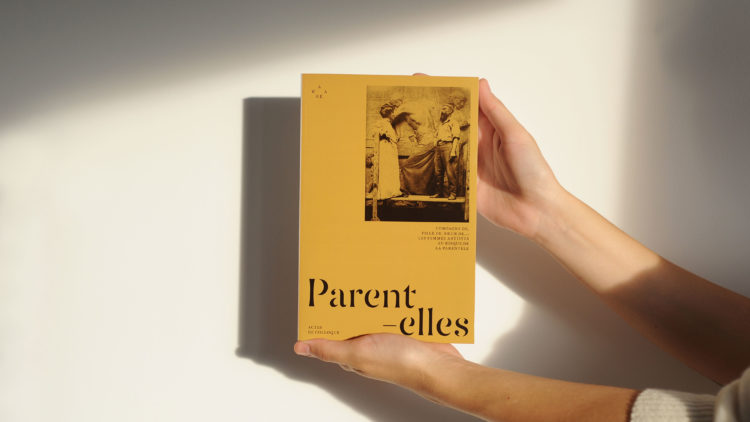Symposium papers
Published on
Women of “ambitious character”, with no “real desire to compromise”: two wives of the Bonnart dynasty, publishers and print-sellers in Paris during the Ancien Régime
Pascale Cugy
Abstract
This paper discusses Marie Fontaine (1685–1751) and Catherine-Thérèse Landry (1721–1769/1773), two women married to members of the Bonnart family, one of the most important dynasties of print-sellers on rue Saint-Jacques in Paris. Taking archival documents and prints as its starting point, it questions their role in the family business and the conflicts that arose on the deaths of their husbands, when their circumstances as widows placed them at the head of the boutiques Coq and L’Aigle. Taking two specific examples, the study considers the difficulties that the women might have faced in a business broadly founded on a patrilineal system, and the suspicions that underlay their decisions.
[Full-length text only available in French]
Les femmes ont occupé une place importante dans les milieux de l’estampe depuis les origines de cet art, effectuant a priori le même type de tâches que les hommes, avec cette différence qu’elles souffraient du statut attaché à leur sexe, qui les rendait au premier abord peu visibles et explique qu’elles disparaissent presque toujours derrière leur père, leurs frères puis leur mari, qui devaient les « autoriser » pour nombre d’actes de la vie courante1. La seule occasion où elles pouvaient accéder à une réelle visibilité professionnelle était en fait la mort de leur époux – lorsqu’elles se mettaient à exercer en tant que veuves, assurant seules et en leur nom la gestion d’un commerce généralement destiné à un fils ou à un gendre, pendant une période d’intérim2.
Au sein de la famille Bonnart, dynastie de graveurs et marchands d’estampes organisée autour de deux boutiques rue Saint-Jacques, L’Aigle et le Coq, dix femmes ayant participé plus ou moins directement à la production ou au commerce peuvent être recensées, dont aucune n’est nettement identifiée comme auteur de gravures ; toutes peuvent cependant être considérées comme des travailleuses « anonymes », au sens de non reconnues en leur nom pour leur travail3. Parmi ces femmes, les épouses des principaux membres de la dynastie4 présentent des caractéristiques communes, comme le fait de ne pas venir de familles de graveurs et éditeurs, mais plutôt de familles de marchands et artisans, et de posséder un patrimoine supérieur à celui de leur époux. Elles apportèrent aux Bonnart des relais au sein de la bourgeoisie marchande dont elles étaient issues (notamment celle qui faisait commerce des apparences, dont on peut penser qu’elle joua un rôle dans le succès des gravures de mode auquel les Bonnart furent associés), ainsi que des fonds permettant le développement de leur commerce. Toutes apprirent rapidement le métier de leur époux et surent parfaitement s’adapter aux coutumes de la rue Saint-Jacques.

Anonyme, Monseigneur le Dauphin (état II/II), vers 1729-1730, 30,5 × 21 cm, eau-forte rehaussée de burin publiée par Marie Fontaine au Coq, épreuve enluminée, Paris, BnF, département des Estampes et de la Photographie, collection Smith-Lesouëf, 9080, © BnF.

Anonyme, Ragotin caché dans un grand coffre, vers 1731-1735, 50 × 68 cm, eau-forte rehaussée de burin publiée par Marie Fontaine au Coq, musées du Mans, inv. 1991.40.12.6, © Musées du Mans.
Capables d’assurer toutes les tâches d’une profession qui impliquait, outre la conception des plaques, la rédaction et la signature de billets, les rapports avec les fournisseurs et revendeurs ou encore le lancement de procédures en cas de dettes, les femmes – et en particulier, les veuves – virent cependant leurs éventuelles ambitions entrer en contradiction avec les attentes de la famille, qui étaient d’abord la transmission à des hommes de la marque et du commerce. Les plaques de cuivre, destinées au fils appelé à reprendre l’enseigne, continuaient ainsi, après la mort du mari, alors qu’elles étaient éditées par son épouse, à porter le seul nom Bonnart – ce qui faisait des femmes, même lorsqu’elles dirigeaient la boutique, l’équivalent des sous-traitants employés pour graver, imprimer ou enluminer, payés à la tâche et dont le nom ne figure nulle part sur les produits5. Le seul cas connu d’une modification de la marque après la mort du mari est celui de Marie Fontaine qui, après avoir conservé le nom de Jean-Baptiste-Henri6, choisit finalement de s’affirmer sous celui de « Veuve Bonnart » en produisant quelques « portraits en mode » et en sollicitant des privilèges auprès de l’administration royale [ill. 1 et 2].
Ce choix de se présenter comme éditeur s’effectua parallèlement à une affirmation vis-à-vis de sa belle-famille, avec laquelle elle entra alors en conflit – un conflit dont une partie concerna deux de ses filles qui, probablement avec la bienveillance de leur mère, s’opposèrent à leur tuteur, leur oncle Nicolas II, et à son projet de les faire « entrer dans [un] monastere de religieuses pour y demeurer pensionnaires jusqu’à ce quelles puissent estre pourveues par mariage, et ce pour y estre instruites et y recevoir l’education convenable à des filles de famille7 ».
Le désir d’indépendance dans la gestion des boutiques, exprimé par au moins deux femmes face à des circonstances similaires (la mort du mari et l’absence d’héritier masculin direct), provoqua conflits et désordres au sein de la dynastie, où elles se retrouvèrent accusées de divers maux. Si les documents ne permettent de dresser qu’une histoire fragmentaire de ces péripéties, ils offrent un aperçu de la difficulté du sort des femmes lorsqu’elles voulaient outrepasser leur rôle de « passeuses » des fonds.
Le premier cas concerne Marie Fontaine, qui épousa en 1707 Jean-Baptiste-Henri Bonnart, futur héritier de la boutique du Coq, où elle apprit le métier en compagnie de ses beaux-parents avant d’y travailler seule avec son époux. Après la mort de ce dernier en mars 1727, elle continua le commerce conjugal mais rencontra rapidement des problèmes relatifs à la succession qui l’obligèrent à vendre le fonds et à abandonner temporairement son activité ; les Bonnart de la branche de L’Aigle semblent, sinon avoir été directement à la source de ses soucis, avoir alimenté avec constance les débats. Nicolas II, tuteur des héritières, accusa ainsi Marie Fontaine de malversation avant de se désister de ses plaintes en avril 1736, soit peu de temps avant la vente aux enchères des cuivres du Coq qui, à partir de septembre, fut le seul moyen de régler la succession. Antoine Malbouré, un ami des Bonnart, y acquit une grande partie des plaques du fonds parmi lesquelles « la planche gravée représentant l’enseigne du Coq, qui étoit l’enseigne de ladite demoiselle veuve Bonnard8 ». Il céda ensuite devant notaires la totalité de ces planches à Nicolas II et à son fils Nicolas III, au cours d’une vente qui dut, en raison de la présence de l’enseigne, être ratifiée par Marie Fontaine9.
Celle-ci, qui avait déménagé rue de Bourbon, n’eut pas d’autre solution que de consentir à la cession, qui avait pour but de récupérer le nom et le fonds du Coq afin que Nicolas III puisse s’installer dans sa propre boutique10. Une clause fut cependant ajoutée, obligeant « Nicolas Bonnard pere et Nicolas Bonnard fils » à « rendre à ladite demoiselle veuve Bonnard ladite enseigne dans le cas où elle reprendroit ledit commerce et voudroit user personnellement de laditte enseigne ». Marie Fontaine exerça rapidement ce droit et retourna s’installer rue Saint-Jacques après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part de son second époux, le musicien Louis Naudé11. Elle réobtint alors le bail du Coq, où elle installa son commerce sous le nom de Naudé ; n’ayant récupéré que le local et l’enseigne de son ancienne boutique, elle dut reconstituer un fonds et affronter de nombreux soucis.
Les indications concernant la poursuite de ses affaires laissent paraître une situation chaotique qui contraste avec l’impression de réussite laissée par le commerce lorsqu’il était tenu sous le nom de Jean-Baptiste-Henri. Aux ennuis judiciaires avec ses gendres, auxquels elle fut condamnée à verser de l’argent, s’ajoutèrent les procès avec ses prestataires, fournisseurs et clients, ainsi que des accusations d’avoir géré le fonds à son unique profit après la mort de Jean-Baptiste-Henri. Sa carrière personnelle ne semble avoir été qu’une succession de procédures et luttes dont il est difficile de dire si elle était due aux difficultés faites aux femmes ou à cette femme en particulier, à son caractère ou à son désir de perpétuer seule un commerce dont son ex belle-famille avait voulu s’emparer – une belle-famille qu’elle semble avoir dès lors cessé de fréquenter hors des tribunaux12. Elle termina sa vie avec plusieurs procès inachevés et, au moment de sa mort, dépensait des sommes importantes en frais d’avocat, refusant notamment les voies de conciliation avec ses gendres, selon lesquels elle ne montrait « aucune envie sincère de s’arranger13 ».
Le second cas de veuve en lutte après la mort de son mari concerne la branche de L’Aigle et Catherine-Thérèse Landry, épouse de Nicolas III qui, ne pouvant s’installer sous l’enseigne du Coq, demeura rattaché à celle de ses père et grand-père. Fille d’un important marchand mercier parisien, Catherine-Thérèse devait, comme il est stipulé dans les contrats relatifs à l’entreprise que Nicolas II transmit à son fils, tenir avec lui le commerce de L’Aigle, selon le modèle du couple éprouvé par les générations précédentes. Mais après avoir passé avec Nicolas III « seize années dans la paix & dans la concorde14 », elle se retrouva veuve en 1759, alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant et que le premier, Jean-Nicolas, qui devait mourir peu de temps après, était âgé de quatre ans. Décidant d’organiser une vente aux enchères pour liquider la succession15, elle ne paraît pas avoir songé à continuer dans le commerce de l’estampe et se remaria rapidement avec un marchand drapier, Marie-Claude Le Sage ; elle n’en rencontra pas moins de nombreux problèmes avec son ex belle-famille, et notamment avec son beau-père Nicolas II qui, n’ayant plus de boutique (puisqu’il l’avait transmise à son fils et à sa bru), modifia son testament en défaveur de sa petite-fille (née après la mort de Nicolas III) et se mit à racheter des plaques de cuivre et éléments de L’Aigle – actes qui semblent avoir été motivés par le souci de transmettre ses biens à ses neveux, dont l’un était installé marchand d’estampes. Catherine-Thérèse se retrouva ainsi au cœur de procédures avec la famille de son défunt époux, en même temps qu’elle débutait avec son nouveau mari une vie mouvementée dans laquelle elle fut confrontée à des accusations de malversation et d’incompétence.
Ses secondes noces furent en effet rapidement marquées par des procédures de demande de divorce de sa part – procédures qui ne concernent pas sa vie de marchande d’estampes mais ont laissé des documents sur la façon dont son comportement pouvait être perçu. Son second mari y dresse d’elle un portrait peu flatteur et l’accuse d’avoir été la source de problèmes commerciaux lors de son premier mariage. Si Catherine-Thérèse se plaignit d’un homme violent qui l’insultait, la poursuivait et la frappait, Marie-Claude Le Sage la décrivit quant à lui comme une proto-féministe insensée, l’accusant de vouloir administrer et prendre en mains son commerce avec l’idée de le mener à sa ruine, comme elle l’aurait fait avec celui de son précédent mari16. Évoquant une manipulatrice intéressée, Marie-Claude Le Sage insista sur les revendications de son épouse dans la gestion de son affaire – qu’elle contribua à financer – et sur la dangerosité qu’elle aurait représentée pour cette dernière, mettant en avant une perception du rôle de la femme d’un marchand dont on comprend qu’elle ait pu générer une vive opposition de la part de Catherine-Thérèse si l’on en croit les anecdotes livrées par l’avocat de Le Sage sur sa nostalgie de « l’heureux siècle où les femmes occupoient les Trônes17 ».
Chez Marie Fontaine comme chez Catherine-Thérèse Landry, la mort vint seule clôturer procédures judiciaires et tracas familiaux ; leurs tentatives de direction des destinées d’une boutique auparavant gérée avec leur mari peuvent être perçues, sinon comme un témoignage de l’impossibilité totale pour les femmes de s’affirmer à la tête d’une entreprise, tout au moins des difficultés qui pouvaient leur être faites dans le cadre d’une dynastie comme celle des Bonnart.
Pascale Cugy est ancienne élève de l’École du Louvre et docteur en histoire de l’art de l’université Paris-Sorbonne. Elle travaille principalement sur l’estampe et son commerce, ainsi que sur la figure de Henri Focillon. Sa thèse était consacrée à la famille Bonnart et à l’invention de la gravure de mode au XVIIe siècle.
Sur les femmes dans les milieux de l’estampe sous l’Ancien Régime, voir : Maxime Préaud, « Claudine, Élisabeth, Madeleine, Marguerite, Marie. Hommage à quelques figures féminines obscures de l’estampe française aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n°17, 2004, p. 45-50.
2
Sur le statut des veuves sous l’Ancien Régime, voir : Nicole Pellegrin et Colette H. Winn (dir.), Veufs, veuves et veuvages dans la France d’Ancien Régime, Paris, Honoré Champion, 2003.
3
Sur la dynastie Bonnart, nous renvoyons à nos travaux : Pascale Cugy, La dynastie Bonnart. Peintres, graveurs et marchands de modes à Paris sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
4
Il s’agit de Marie Couillard de La Croix (vers 1660-1728), épouse de Nicolas Ier (vers 1637-1718), de Marie-Madeleine Pierre (vers 1656-1721), épouse de Henri II (1642-1711), de Catherine Lorne (vers 1654-1729), épouse de Robert (1652-1733), de Louise-Françoise Paris (1697-1785), épouse de Nicolas II (1688-1762), de Marie Fontaine (vers 1685-1751), épouse de Jean-Baptiste-Henri (vers 1678-1727), ainsi que de Catherine-Thérèse Landry (1721-avant 1773), épouse de Nicolas III (vers 1716-1759).
5
Marie Couillard de La Croix publia ainsi sous le nom de « Nicolas Bonnart » pendant les dix années de son veuvage et de sa direction de la boutique de L’Aigle, avant de s’effacer entièrement derrière son fils Nicolas II.
6
Le portrait des jumelles Élisabeth et Henriette de France, pourtant nées après sa mort, porte ainsi la mention « A Paris chez J B H Bonnart ruë S. Jacques au Coq ». Château de Versailles : inv. gravures 3055.
7
AN, Y-4524, 6 février 1736.
8
AN, MC, XLIII-367, 18 décembre 1736. La graphie « Bonnard » apparaît dans plusieurs actes du XVIIIe siècle et sur quelques estampes, même si « Bonnart » demeure la norme dans les signatures.
9
AN, MC, XVII-701, 23 décembre 1736.
10
Il est écrit dans le contrat que Marie Fontaine « a declaré qu’elle a consenti et consent à ladite vente de ladite […] planche en ce qu’elle donne droit audit sieur Bonnard fils de se servir de ladite enseigne que cedde et abandonne audit sieur Bonnard fils, pour en faire poser une semblable representant un cocq exterieurement à la boutique qu’il occupera, semblable à celle qu’avoit ladite demoiselle veuve Bonnard à la boutique qu’elle vient de quitter, renonceant à pouvoir ceder le meme droit à toute autre personne, et ce en consideration de ce que ledit sieur Bonnard fils est de sa famille qui depuis plus de quatre vingt ans s’est servy de la meme enseigne et qu’il se trouve aujourd’huy au moyen de la vente cy dessus dattée proprietaire d’une grande partie du fonds dont elle a jouy et qu’elle vient de faire vendre ». AN, MC, XVII-701, 23 décembre 1736.
11
AN, MC, XVII-710, 7 mai 1738.
12
De nombreuses traces de procès émaillent l’inventaire de son second mari (AN, MC, XXIV-708, 16 mai 1747), parmi lesquelles « une liasse de neuf pieces qui sont poursuites et procedures faittes par ladite veuve […] contre le sieur Nicolas Bonnard, maître peintre et graveur » ; les papiers laissés à sa mort, quatre ans après celle de Louis Naudé (AN, MC, LXIX-658, 20 avril 1751), témoignent aussi d’une activité commerciale doublée de tracas judiciaires permanents.
13
AN, MC, LXIX-660, 30 décembre 1751.
14
BnF, 4-FM-19174.
15
Le procès-verbal de cette vente est exceptionnellement conservé (AP, 8 AZ 415, pièce 7, 1er septembre 1760).
16
Le marchand drapier expliqua aux juges que son épouse « avoit été mariée en premières nôces avec le sieur Bonnard, Marchand d’Estampes rue S. Jacques : [et qu’]elle avoit sçu réduire ce premier mari à la plus grande dépendance ; il étoit [plus] soumis à toutes ses volontés, que l’enfant le plus docile auroit pû l’être ; en conséquence il avoit laissé prendre à sa femme les rênes de son commerce. Si elle eut été capable de le bien diriger, ce commerce auroit réussi, la boutique du sieur Bonard étoit une des meilleures en ce genre ; il étoit irréprochable dans ses mœurs & dans sa conduite ». BnF, 4-M-19173.
17
L’avocat de Marie-Claude Le Sage rapporta : « Le caractère hautain de la Dame le Sage lui avoit inspiré de son sexe des idées très-relevées, qui occasionnent quelquefois des débats de conversation entre le mari & la femme. Ils parloient un jour ensemble du génie des deux sexes : le mari prit la liberté de dire que les femmes ressembloient à des girouettes qui tournoient à tous vents ; qu’une armée de femmes céderoit bientôt à une armée d’hommes. La Dame le Sage soutint le contraire, & entra même dans une espéce d’enthousiasme, au milieu duquel elle s’écria, où est l’heureux siécle où les femmes occupoient les Trônes, & remplissoient les Tribunaux de la Justice ? depuis que ces hommes s’en sont emparés par la force majeure, tout va au diable, & l’on vit dans un siécle de fer. Le sieur le Sage rioit beaucoup de cet égarement de sa femme, & voulut lui prouver que son idée ne pouvoit se réaliser que pour le malheur de l’humanité : la conversation s’échauffa ; la Dame le Sage, qui attribuoit à son sexe toutes les vertus & tous les talens, notamment celui de la bravoure, voulut mettre à l’épreuve celle de son mari : elle lui proposa sérieusement un cartel, le traitant de lâche & de poltron, s’il s’y refusoit. Le mari demanda, en plaisantant, dans quel lieu il falloit qu’il se rendît, & avec quelles armes ; la réponse de sa femme, qui ne revenoit pas encore à elle-même, fut qu’elle l’attendroit avec un pistolet au Bois de Boulogne : cette scène se passoit au jour de Fête ; le mari quitta sa femme pour aller à la messe, & lui dit, toujours en plaisantant, qu’elle fît bien ses réflexions, qu’en attendant il alloit à la messe. À son retour il ne fut plus question de ce défi ; la vapeur qui avoit échauffé le cerveau de la Dame le Sage, étoit amortie. » BnF, 4-M-19173.