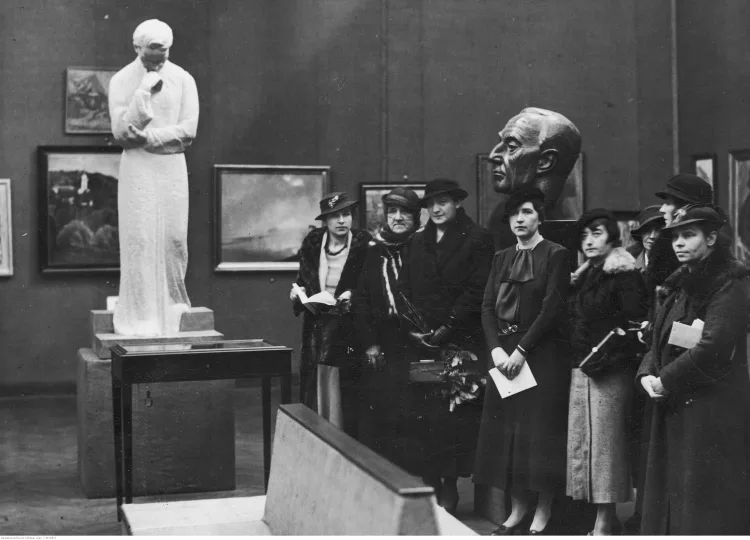Focus
Romaine Brooks, Le Trajet, vers 1911, huile sur toile, 115,2 x 191,4 cm, Smithsonian American Art Museum
L’entre-deux-guerres constitue un contexte favorable à la valorisation des femmes sur la scène culturelle et l’année 1937 en marque l’apogée. Cette année-là, deux évènements majeurs symbolisent la mise en valeur des créatrices dans la capitale française : Les femmes artistes d’Europe exposent au Jeu de Paume du 11 au 28 février et l’Exposition universelle du 25 mai au 25 novembre. Pour autant, ce n’est pas la première fois que des œuvres de femmes sont montrées à Paris dans de grandes manifestations internationales, parmi elles, la peintre suédoise Hanna Hirsch-Pauli (1862-1940) qui présente son travail à l’Exposition universelle de 1889 ou la française Georges Achille-Fould (1865-1951) à celle de 1900.
Les femmes artistes d’Europe exposent au Jeu de Paume, est l’une des premières expositions internationales entièrement dédiée aux femmes. Dans la sélection faite par Laure Albin Guillot (1879-1962), photographe et cofondatrice de la Société des artistes Photographes, toutes les disciplines se mêlent pour refléter la pluralité des pratiques et rendre hommage à l’inventivité des créatrices. En peinture, la modernité de Romaine Brooks (1874-1970) se retrouve dans la similarité de réalisation de ses nus masculins et féminins. Des actrices du cubisme comme Marie Laurencin (1883-1956) et Alice Halicka (1895-1975) viennent étayer le groupe des peintres. Les sculptures de Chana Orloff (1888-1968), mais aussi le rendu cinématographique des toiles de Tamara de Lempicka (1898-1980) illustrent l’implication des femmes dans les courants artistiques contemporains.
L’Exposition universelle, s’organise en pavillons nationaux égrainés dans tout Paris, afin que chaque pays puisse y promouvoir ses innovations techniques et culturelles. D’abord, les artistes femmes répondent à des commandes pour la décoration de ces lieux, où elles doivent réveiller le sentiment patriotique : Marie Raymond (1908-1989) réalise une fresque pour le pavillon régional des Alpes-Maritimes et Odette Pauvert (1876-1967), déjà connue pour ses fresques décoratives réalisées dans des écoles, décore deux autres pavillons. Sur le Champ de Mars, les bâtiments de l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique se font face, le premier survolé d’un imposant aigle impérial et le second, fièrement couronné du couple de l’Ouvrier et la kolkhozienne. Cette sculpture de Vera Ignatevna Moukhina (1889-1953) devient une image récurrente du patriotisme du bloc de l’Est.
Les artistes sont aussi présentes lors des différentes expositions organisées pendant la manifestation, même si elles restent minoritaires face aux hommes. La sculptrice Germaine Richier (1902-1959) reçoit plusieurs médailles d’honneur pour son allégorie de la Méditerranée et l’artiste polonaise-française Mela Muter (1876-1967) se voit attribuer la médaille d’or pour son œuvre expressionniste. Enfin, des artistes s’invitent même dans l’organisation de l’évènement, L. Albin Guillot, travaille en binôme avec Louis-Victor Emmanuel Sougez (1889-1972) à la mise en place de la section Création photographique.
Cette parenthèse encourageante pour les artistes femmes se referme rapidement. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut attendre les années 1970 et plus précisément l’année 1975 – année internationale de la Femme décrétée par l’ONU – pour que le travail des artistes femmes soit montré dans une exposition d’envergure similaire à celle de 1937 : Femmes au présent : Exposition internationale itinérante d’art contemporain (1975-1976). Ce n’est ensuite que 20 ans plus tard, qu’est organisée au Magasin-Centre national d’art contemporain de Grenoble la première exposition mettant en lumière les revendications politiques et féministes des plasticiennes : Vraiment : féminisme et art (1997).
1874 — Italie | 1970 — France

Romaine Brooks
1895 — Pologne | 1975 — France
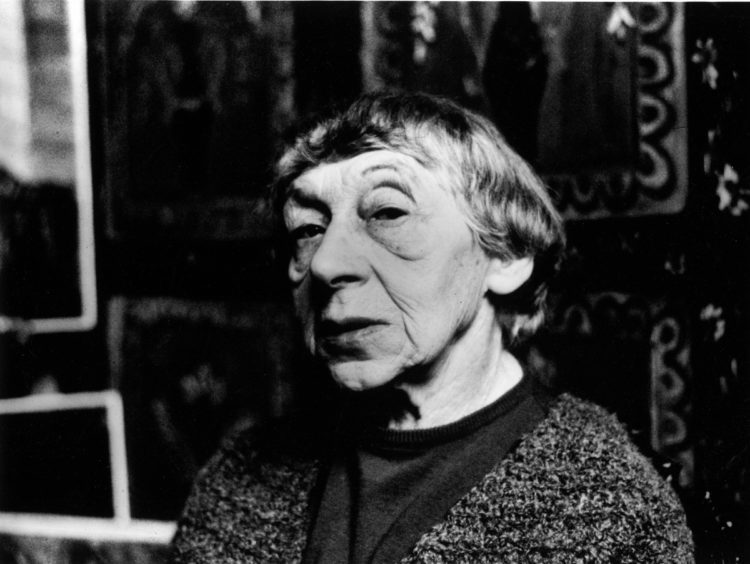
Alice Halicka
1888 — Ukraine | 1968 — Israël
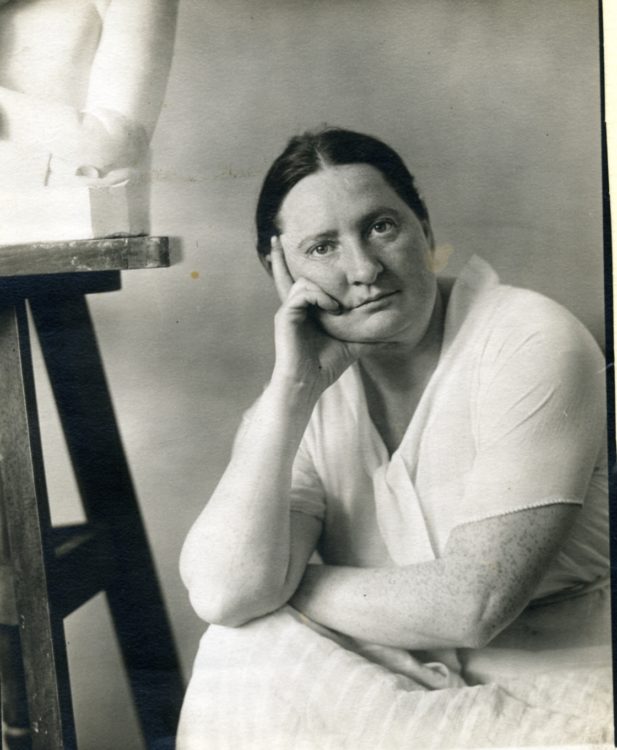
Chana Orloff
1898 — Pologne | 1980 — Mexique

Tamara de Lempicka
1908 — 1989 | France

Marie Raymond
1903 — 1966 | France

Odette Pauvert
1889 — Lettonie | 1953 — Russie

Vera Moukhina
1902 — 1959 | France

Germaine Richier
1876 — Pologne | 1967 — France

Mela Muter
1881 — Espagne | 1932 — France

María Blanchard
1866 — 1932 | France
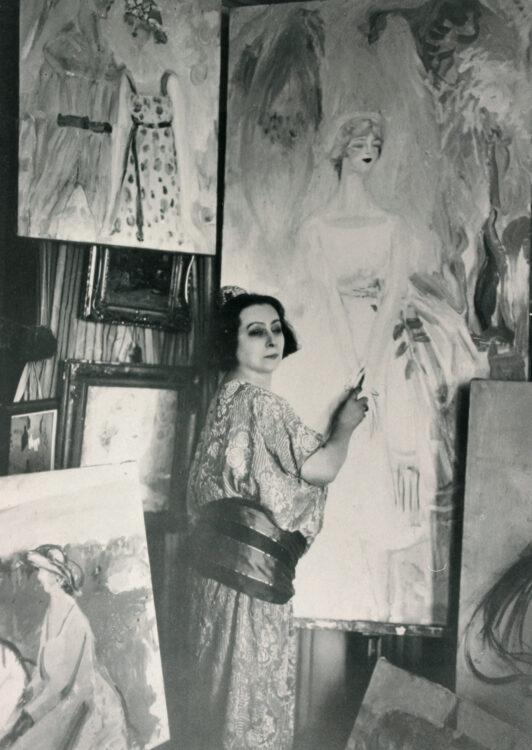
Jacqueline Marval
1879 — 1961 | Royaume-Uni

Vanessa Bell
1862 — 1946 | Finlande

Helene Schjerfbeck
1891 — Pays-Bas | 1955 — Norvège

Charley Toorop
1885 — 1948 | Suède
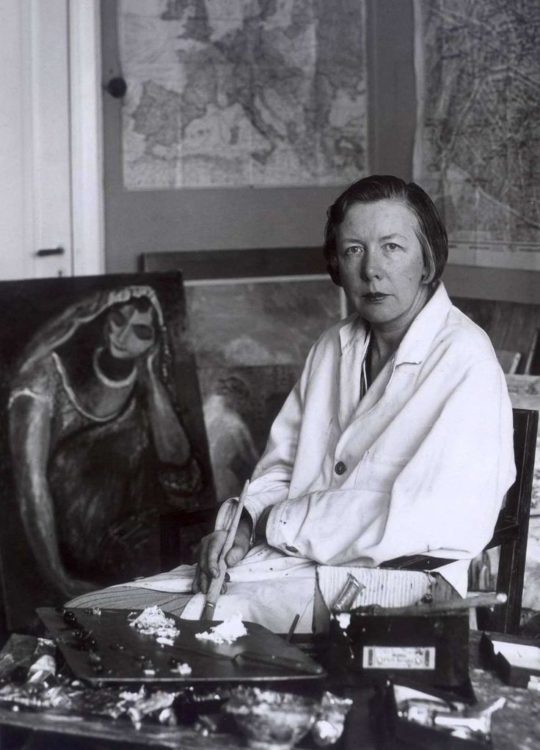
Sigrid Hjertén
1881 — Russie | 1962 — France

Natalia Gontcharova
1902 — 1995 | Espagne

Maruja Mallo
1907 — 1975 | Allemagne

Hanna Nagel
1911 — Danemark | 1984 — France

Sonja Ferlov Mancoba
1859 — 1935 | France

Virginie Demont-Breton
1869 — 1937 | France

Clémentine-Hélène Dufau
1902 — 1988 | Argentine

Raquel Forner
1910 — Palestine | 1999 — Israël

Sima Slonim
1913 — 1994 | États-Unis

Helen Phillips
1908 — 2004 | Espagne

Francis Bartolozzi (Pitti)
1905 — Turquie | 1938 — France

Hale Asaf
1889 — 1970 | Pérou

Elena Izcue
1913 — 1991 | Hongrie

Margit Anna
1884 — 1982 | France

Juliette Roche
1910 — 1993 | France

Jacqueline Lamba
1899 — Allemagne | 1998 — États-Unis

Ilse Bing
1896 — Roumanie | 1971 — France

Jeanne Coppel
1904 — Bélarus | 1982 — France

Nadia Khodossiévitch-Léger
1904 — Estonie | 1993 — Suède

Karin Luts
1890 — 1985 | États-Unis

Grace Albee
1892 — Russie | 1984 — Royaume-Uni

Marevna
1907 — Géorgie | 1988 — France

Vera Pagava
1909 — 1994 | Chypre

Loukia Nicolaidou
1882 — Pologne | 1973 — France

Sarah Lipska
1888 — 1969 | Norvège

Charlotte Wankel
1894 — 1973 | Bulgarie