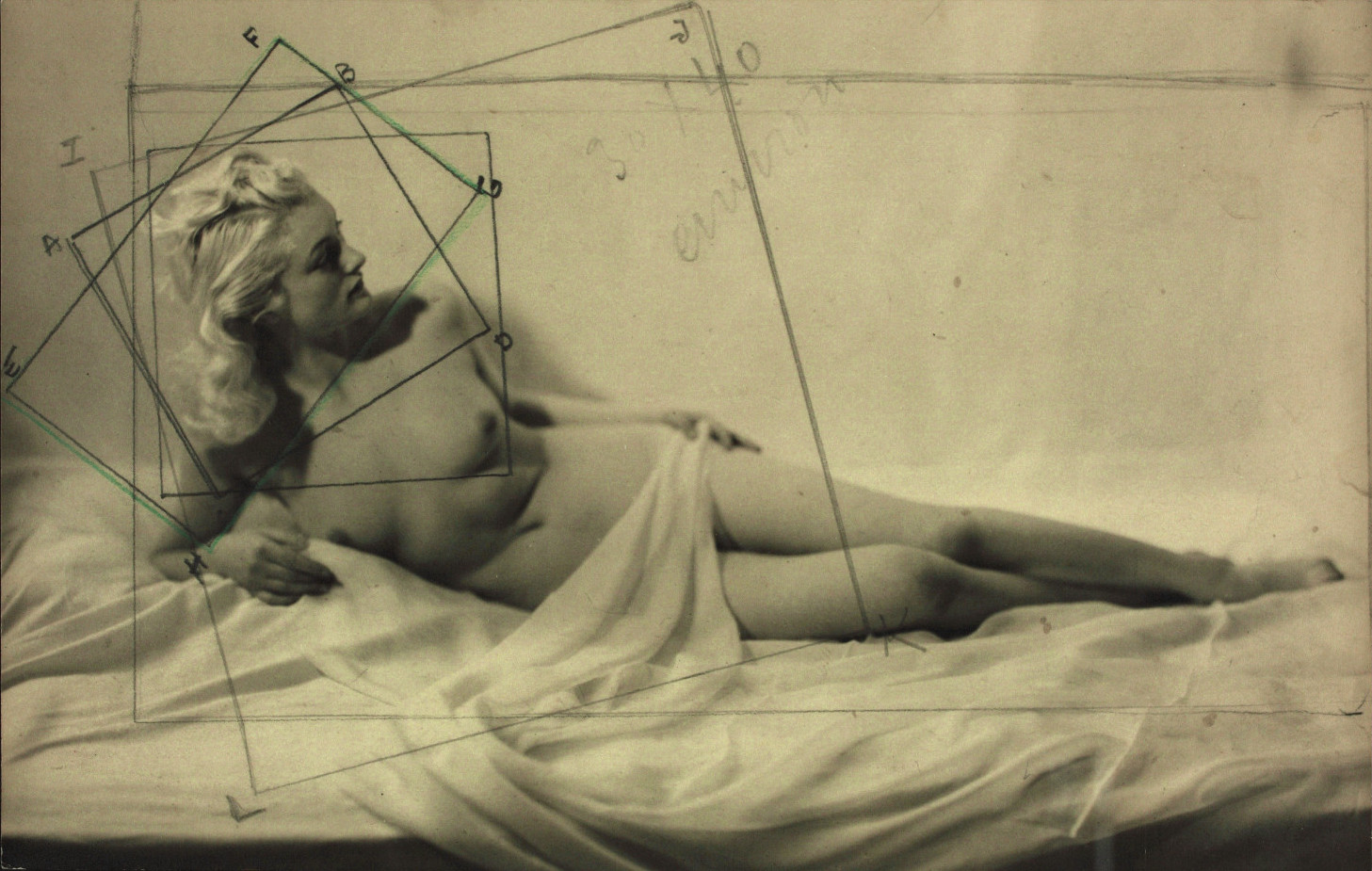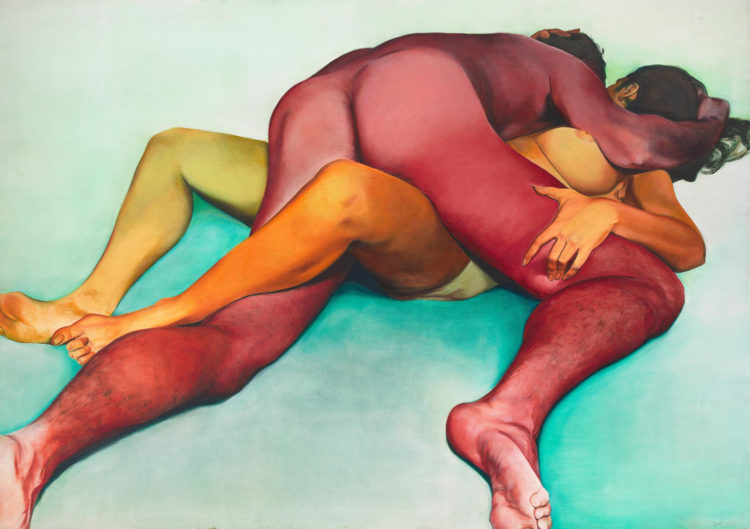Focus
In academic art education as it was organised until the 19th century, the representation of nude models was indispensable for the conception of history paintings. For a long time women artists were excluded from life drawing classes for reasons of morality. Thus they could not claim to be equal to men in the noblest genre. The question of opening life drawing to women generated a heated debate and thus very early the representation of the nude was a true challenge in the training and career of women artists. While their access to classes was a point of contention, some found other paths outside the academies. Immediately part of a form of subversion, the nude was an open door to new artistic explorations and the vehicle for personal, professional and political affirmation.
While the live model was an element of study, the representation of naked bodies was also a means of touching what is most intimate and most universal in humanity. In the sculptures of Camille Claudel (1864-1943), bodies were the support of an expression of emotions through the ages.
Certain female artists took advantage of the narrative and symbolic dimension of the nude in connection to nature. Photographer Anne Brigman (1869-1950) staged nude women in Californian landscapes in images that personified natural forces. A similar association can be found in the sculptures of Maria Martins (1894-1973) that depict hybrid beings blending humans and vegetation in a surrealist vein. More recently, the photographs and videos of multidisciplinary artist Ana Mendieta (1948-1985) retain the traces of performances in which she became one with the elements. Summoning the evocative force of Latin American rituals and sacrifices, she metamorphically rooted herself in a land that was not the same as the one from which she originated, and investigated femininity through her own body.
Under the brush of painter Paula Modersohn-Becker (1876-1907) the nude became a pictorial subject in its own right. In her portraits of nude women and children she evoked motherhood, stripped of any mythological pretext, as well as in a famous 1906 painting where she herself appears pregnant, becoming a pioneer of the nude female self-portrait. Pan Yuliang (1899-1977) devoted herself to the same subject, exploring themes of female bathers and indoor nudes. Many of her drawings share an erotic connotation that was scandalous during her lifetime and considered inappropriate for women.
The canvases in which Lotte Laserstein (1898-1993) staged herself in her studio are an affirmation of the artist’s status. In In meinem Atelier (1928) the imposing presence of the model in the foreground, whose body is realistically detailed, implies an aesthetic statement and consecrates the image of the modern woman whom the painter portrayed several times in the guise of Traute Rose (1904-1997). Alice Neel (1900-1984) fed an emancipated representation of the canons of beauty. Characterised by a raw realism, her nude portraits are sexualised but not eroticised. The subjects appear charged with their condition, like pregnant women. Her frankness can be seen in a unique nude self-portrait that she began in 1975, where she portrays her own 70-year old body without any concession. In addition to the works by female artists, the nude is also an issue in the representation of women in institutions and collections, as highlighted by the actions of the Guerrilla Girls from the 1980s onwards.
Bringing the image of the body into play, some artists use the representation of the nude in a feminist approach to denounce the eroticisation of bodies in the male gaze. Sylvia Sleigh (1916-2010) reverses the scopic relationship by painting nude men in postures attributed to female models in art history, highlighting their erotic dimension by diverting it. Others draw their iconography from pornography. Censorship became the subject in the paintings of Joan Semmel (b. 1932) and in the Fuck Paintings (1969-1974) of Betty Tompkins (born in 1945), betraying the subversive force of sexual imagery. The same phenomenon struck in 1987 with the photographs of Florence Chevallier (born in 1955) from the series Corps à corps, which depicts a heterosexual relationship in its agonistic dimension.
New generations of artists continue to use the representation of the nude to mobilise the self-portrait and reveal the political inscription of bodies, as seen with Jenny Saville (born in 1970) and Allana Clarke (born in 1987), among others.
Referring to the intimacy, fragility and nature of the human being, the representation of the nude cannot leave anyone indifferent, as it also implies the revealing what is usually hidden. Through the above-mentioned works and those of other female artists, the representation of the nude manifests a great poetic and political force, while retaining a deeply subversive character.
1869 — Hawaii | 1950 — United States

Anne Brigman
1876 — 1907 | Germany

Paula Modersohn-Becker
1894 — 1973 | Brazil

Maria Martins
1864 — 1943 | France

Camille Claudel
1895 — China | 1977 — France

Pan Yuliang
1948 — Cuba | 1985 — United States

Ana Mendieta
1900 — 1984 | United States
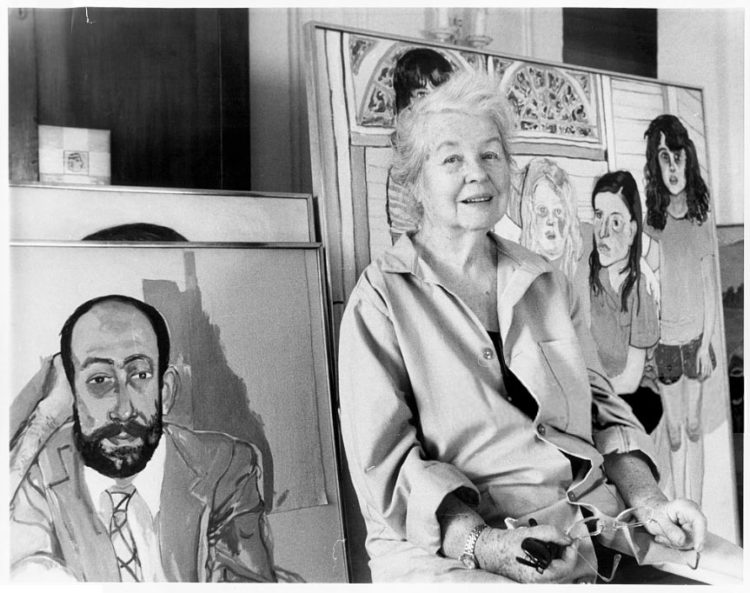
Alice Neel
1945 | United States
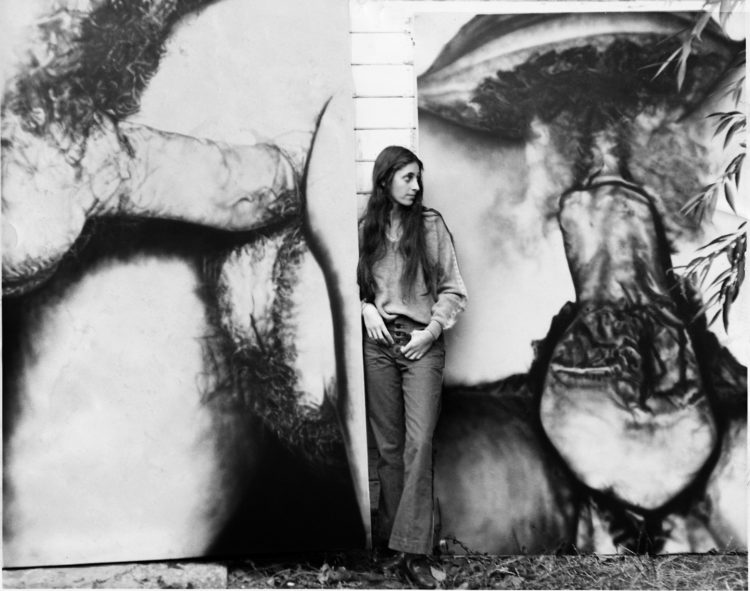
Betty Tompkins
1985 | United States

Guerrilla Girls
1955 | Morocco

Florence Chevallier
1898 — Poland | 1980 — Mexico

Tamara de Lempicka
1937 | Spain

Esther Ferrer
1958 — 1981 | United States

Francesca Woodman
1939 — 2019 | United States

Carolee Schneemann
1971 | Mexico
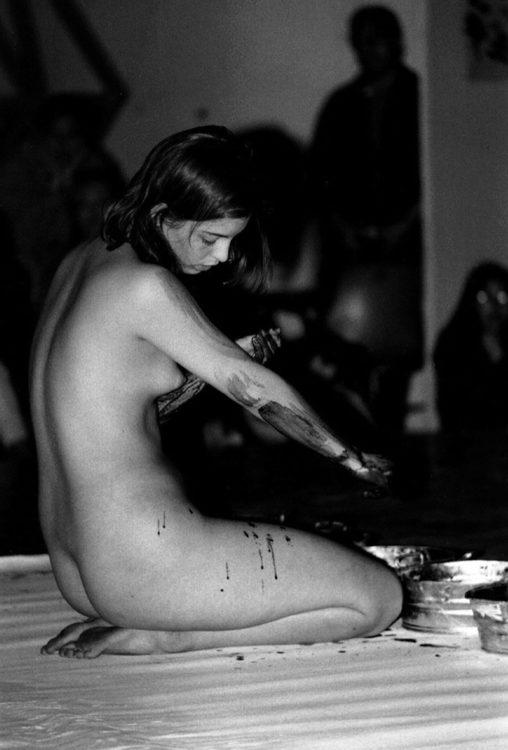
Lorena Wolffer
1956 | Croatia

Vlasta Delimar
1848 — Spain | 1924 — France

Amélie Beaury-Saurel
1844 — 1933 | United-Kingdom

Annie Louisa Swynnerton
1948 — New Zealand | 2014 — England
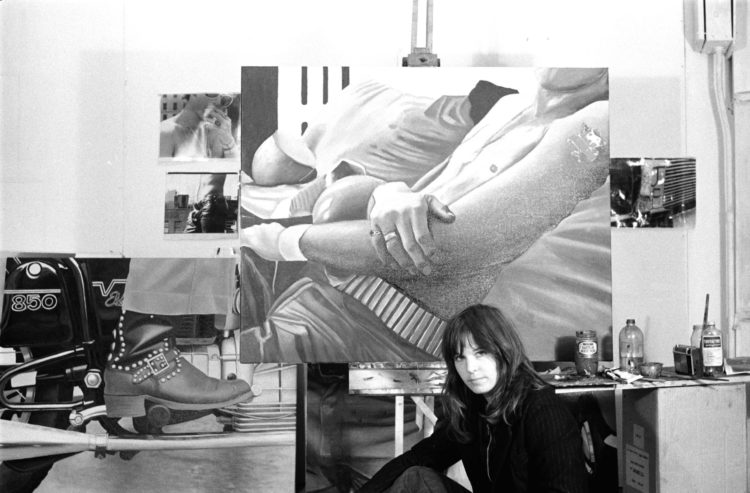
Alexis Hunter
1959 — 2018 | United States

Laura Aguilar
1959 | Mexico

Silvia Gruner
1869 — 1937 | France

Clémentine-Hélène Dufau
1939 — 2020 | Algeria

Leila Ferhat
1962 | Switzerland

Pipilotti Rist
1898 — Prussia (now Pasłęk, Poland) | 1993 — Sweden

Lotte Laserstein
1951 | United States

Donna Gottschalk
1939 — 2019 | United States
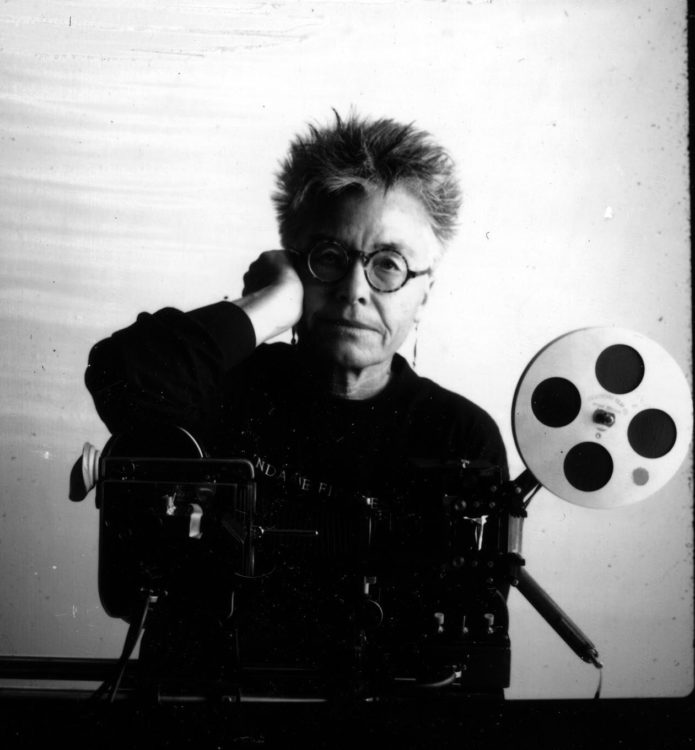
Barbara Hammer
1954 | United States

Annie Sprinkle (aka Ellen F. Steinberg)
1951 | United Kingdom

Cosey Fanni Tutti (Christine Carol Newby, dite)
1970 | Turkey

CANAN (Şenol)
1916 — United Kingdom | 2010 — United States

Sylvia Sleigh
1962 | China

Xiao Lu
1962 | Turkey

Şükran Moral
1927 — 1977 | Bolivia

María Esther Ballivián
1959 | Greenland

Jessie Kleemann
1905 — 1985 | Bulgaria

Vaska Emanuilova
1893 — 1978 | Mexico

Nahui Olin
1951 — 1994 | Argentina
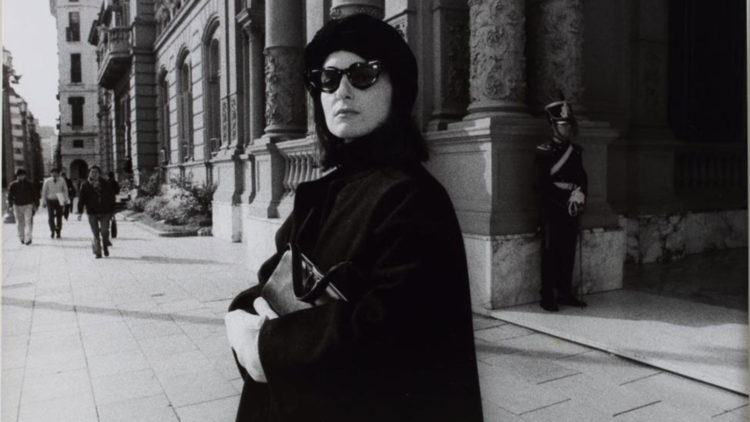
Liliana Maresca
1949 — United States | 2004 — Israel

Pamela Levy
1879 — 1962 | France

Laure Albin Guillot
1963 | Egypt

Ghada Amer
1929 — 2023 | United States
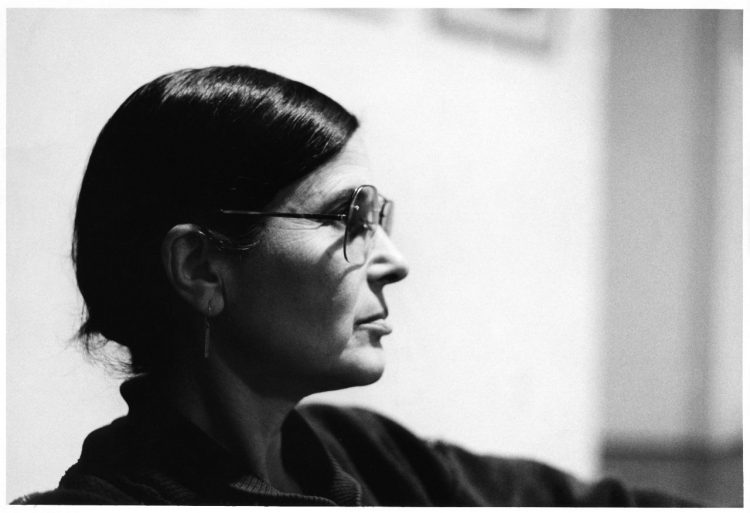
Ida Applebroog
1899 — 1925 | Hungary

Erzsébet Korb
1935 — Portugal | 2022 — Great Britain

Paula Rego
1951 — 2021 | Japan

Tāri Itō
1932 — 2022 | Japan

Asuka Tsuboi
1964 | France

Valérie Belin
1940 — 1993 | United States

Hannah Wilke
1908 — Germany | 1994 — Israel

Liselotte Grschebina
1968 | Albania

Ornela Vorpsi
1939 — 1968 | France

Clotilde Vautier
1970 | Austria

Elke Silvia Krystufek
1935 | Italy

Camilla Adami
1963 | Poland

Katarzyna Kozyra
1970 | France
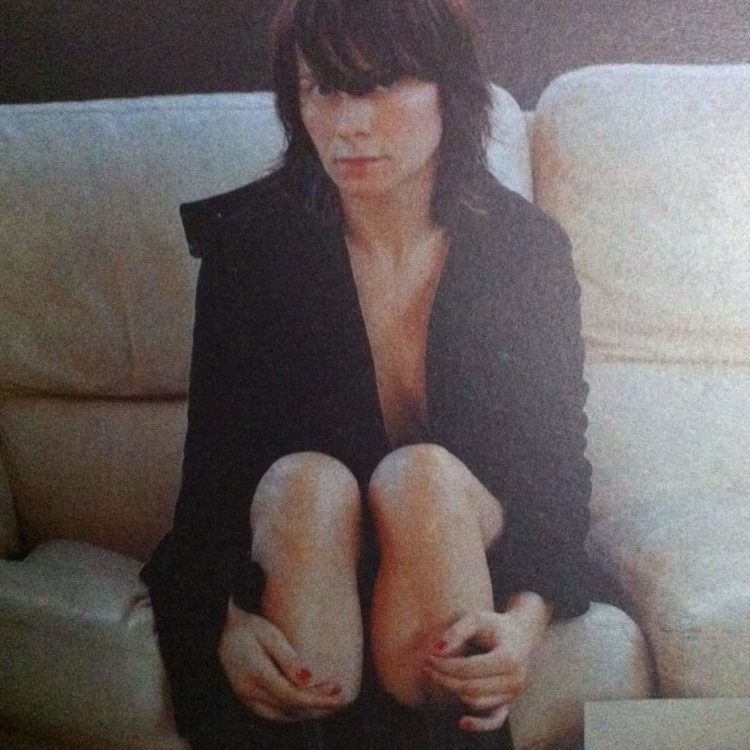
Rebecca Bournigault
1947 | Poland

Zofia Kulik
1969 | United Kingdom

Cecily Brown
1965 | Sierra Leone

Patricia Piccinini
1942 | Yugoslavia (Serbia)

Katalin Ladik
1941 | United States

Sheree Rose
1956 — 2018 | Taiwan
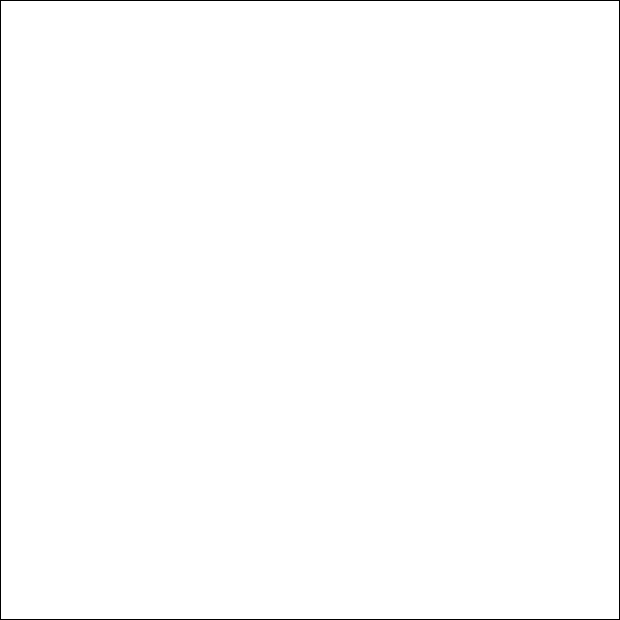
YAN Ming-Huy
1942 | Spain

Mari Chordà
1904 — China | 1991 — France

Colette Richarme
1893 — 1975 | Argentina

Lía Correa Morales
1905 — 2008 | Japan
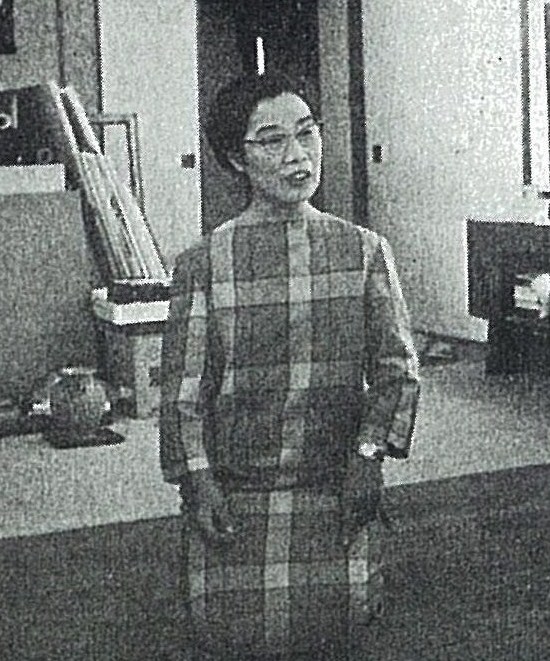
Tamako Kataoka
1896 — 1988 | Japan

Hisako Kajiwara
1972 | Israel

Rona Yefman
1951 | Singapore

Amanda Heng
1970 | Switzerland

Louise Bonnet
1970 | United Kingdom

Jenny Saville
1974 | Belgium

Aline Bouvy
1954 | Vietnam

Hanh Thi Pham
1950 — 2006 | Lithuania

Elvyra Kairiūkštytė
1970 — 2014 | Singapour
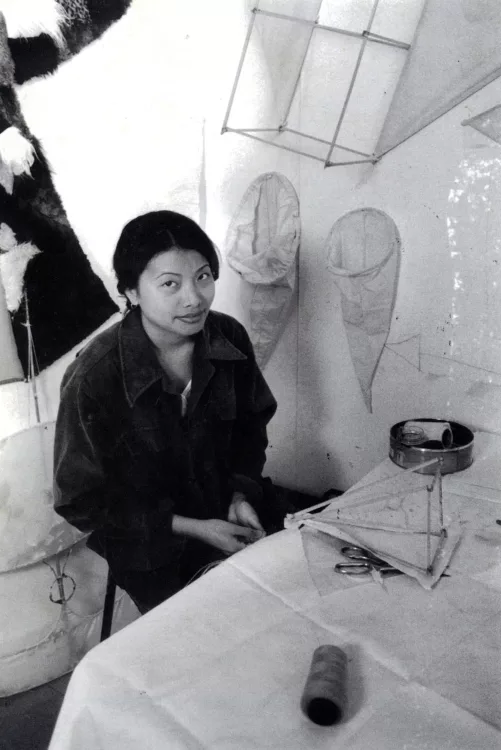
Juliana Yasin
1956 | Syria

Laila Muraywid
1967 | Malaysia

Eng Hwee Chu
1931 — Mandatory Palestine | 2020 — France

Amal Abdenour
1928 — 1980 | Czechoslovakia (Czech Republic)
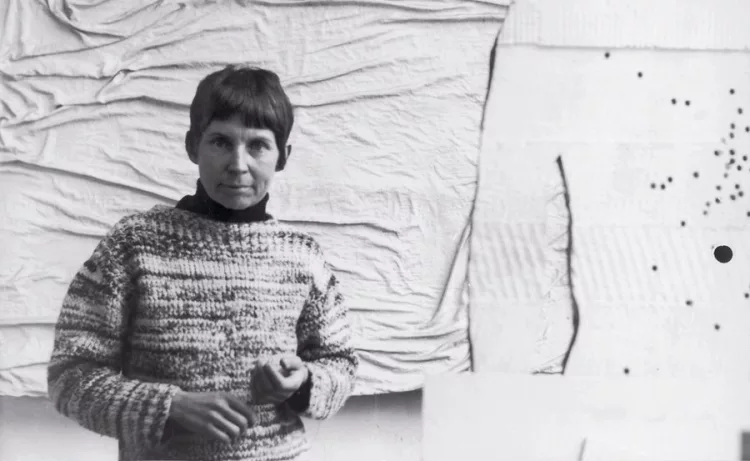
Eva Kmentová
1932 | United States