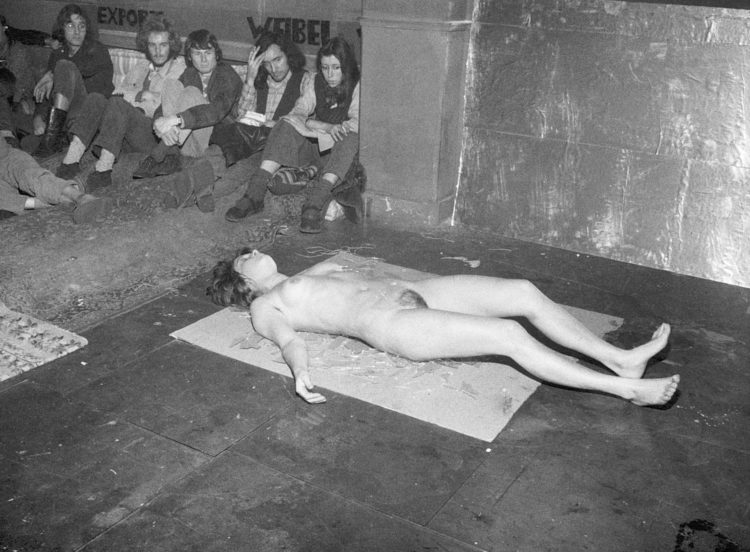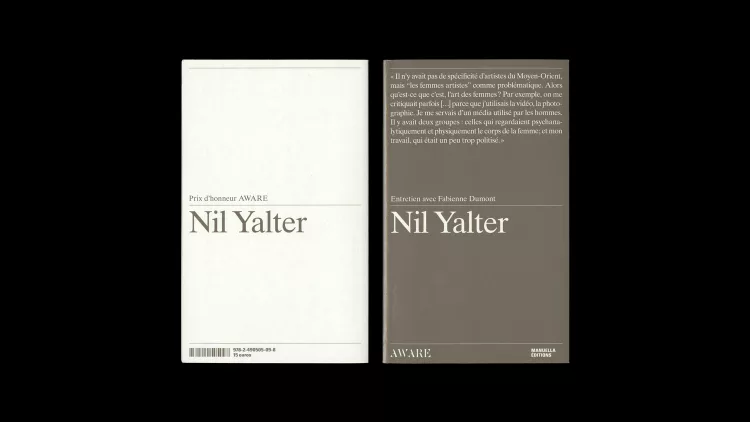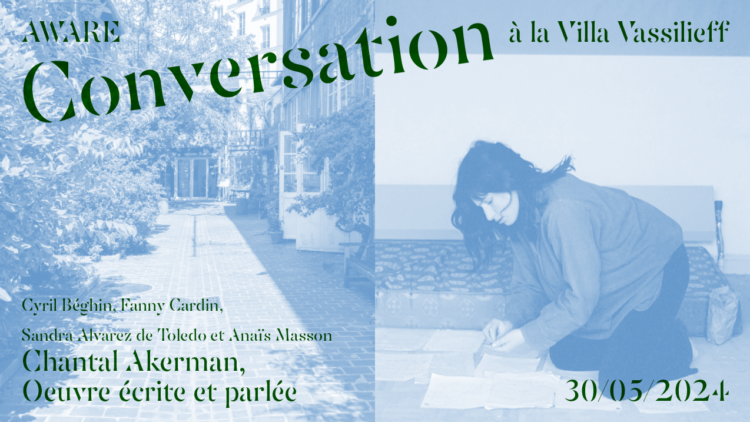Focus
Ulrike Rosenbach, Die Einsame Spaziergängerin [la poussette solitaire], 1979, performance, photographie, © ADAGP, Paris
Avant de devenir un médium à part entière, la vidéo était intrinsèquement liée à la télévision. Il faut attendre le début des années 1960 et notamment la commercialisation à partir de1967 du Portapak Sony – premier enregistreur vidéo portable – pour qu’elle prenne son indépendance vis-à-vis de la transmission télévisée et de ses plateaux. Il devient alors possible de filmer partout, et les artistes se saisissent de cette technique.
Les premières utilisations de l’image électronique comme médium artistique apparaissent au sein du mouvement Fluxus. En mars 1963, Nam June Paik (1932-2006) réalise une distorsion de l’image télévisée en approchant un aimant du tube cathodique. Cette œuvre est retenue comme la naissance de l’art vidéo, et, dès lors, de nombreuses artistes femmes s’en emparent et participent à son développement. VALIE EXPORT (née en 1940) infiltre dès 1971 le monde télévisuel en interrogeant, dans Facing a Family, les liens entre regardant·e et regardé·e. Ulrike Rosenbach (née en 1943) est l’une des premières vidéastes à réaliser des pièces en circuit fermé, filmant et projetant des images en même temps. Les performeuses Marina Abramović (née en 1946) et Leda Papaconstantinou (née en 1945) immortalisent leurs actions dès la fin desannées 1960, modifiant ainsi le rapport de leurs œuvres à l’éphémère. Dès 1972 – et jusqu’en 1980 – se tient le Women’s Video Festival dans l’espace d’exposition The Kitchen à New York mettant en lumière des vidéastes encore sous-représentées, comme la japonaise Shigeko Kubota (1937-2015), membre du groupe Fluxus.
L’art vidéo ouvre un nouvel univers d’expérimentation de l’image ; cette dernière est manipulable ou effaçable, avec ou sans archivage. Nan Hoover (1931-2008) s’intéresse aux potentialités de la transparence, produisant des pièces entre peinture et film. Dóra Maurer (née en 1937) travaille la répétition et la variation en créant des compositions complexes d’images et de sons.
À la fois outil de création et de contestation, la vidéo devient un moyen de réagir aux mouvements artistiques dominants des années 1960. Joan Jonas (née en 1936) réalise ses œuvres dans une démarche introspective, narrative et symbolique, en rupture avec la distanciation de l’art minimal. Carolee Schneemann (née en 1938) dans Up and Including Her Limits (1973) dessine au gré des mouvements de son corps suspendu lors d’une performance filmée et retransmise sur des moniteurs. L’artiste y met en scène une gestualité proche de l’action painting, mais s’en éloigne en considérant les dessins obtenus comme secondaires, posant la question des rapports entre processus créatif et œuvre finale.
Comme la photographie, la caméra s’impose à son tour en médium privilégié de visibilité et de dénonciation des oppressions. Martine Barrat (née en 1937) réalise une série de vidéos sur la vie de membres de gangs du South Bronx. Dans son installation La Roquette, Prisons de femmes, Nil Yalter (née en 1938), en collaboration avec Judy Blum (née en 1943) et Nicole Croiset, dénonce les conditions carcérales. Howardena Pindell (née en 1943) aborde les questions de race et de genre, et Anna Maria Maiolino (née en 1942) dénonce la censure des femmes au Brésil. Quant au duo de cinéastes Maria Klonaris (1947-2014) et Katerina Thomadaki (née en 1947), elles théorisent ce qu’elles nomment le cinéma corporel en faisant du corps et de l’identité féminine un lieu d’exploration plastique et politique. Ainsi, la vidéo, au service de diverses causes militantes, devient un instrument de subversion du patriarcat. Dès 1976, le collectif de vidéastes françaises Les Insoumuses proclame dans la vidéo Maso et Miso vont en bateau : « Aucune image de la télévision ne peut nous incarner, c’est avec la vidéo que nous nous raconterons. »
La vidéo a été massivement investie par les artistes femmes. De nombreux écrits rappellent encore leur place dans l’histoire de l’art, et les convergences entre ce médium et les luttes politiques et féministes. Les ouvrages collectifs Black women film and video artists (1998), édité par Jacqueline Bobo, et Women Artists, Feminism and the Moving Image : Contexts and Practices (2019), dirigé par Lucy Reynolds, constituent des jalons importants de la recherche sur les femmes vidéastes.
1938 | Égypte

Nil Yalter
1939 — 2019 | États-Unis

Carolee Schneemann
1936 | États-Unis

Joan Jonas
1943 | États-Unis

Howardena Pindell
1948 | États-Unis
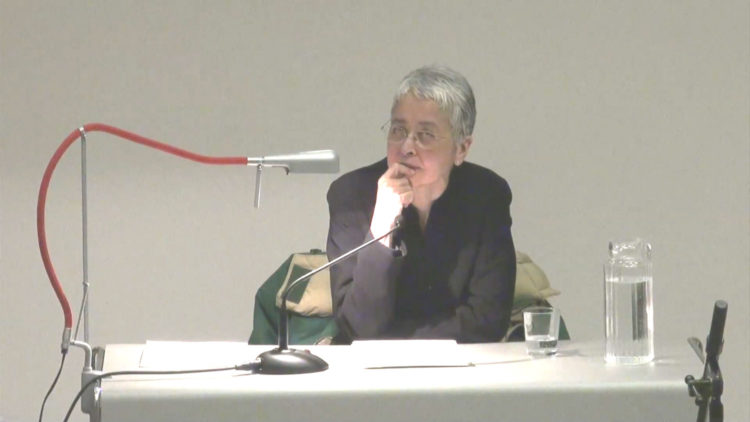
Adrian Piper
1946 | Serbie

Marina Abramović
1948 — Cuba | 1985 — États-Unis

Ana Mendieta
1943 | Allemagne

Ulrike Rosenbach
1940 | Autriche

VALIE EXPORT
1935 — 2022 | Brésil

Sonia Andrade
1935 | États-Unis
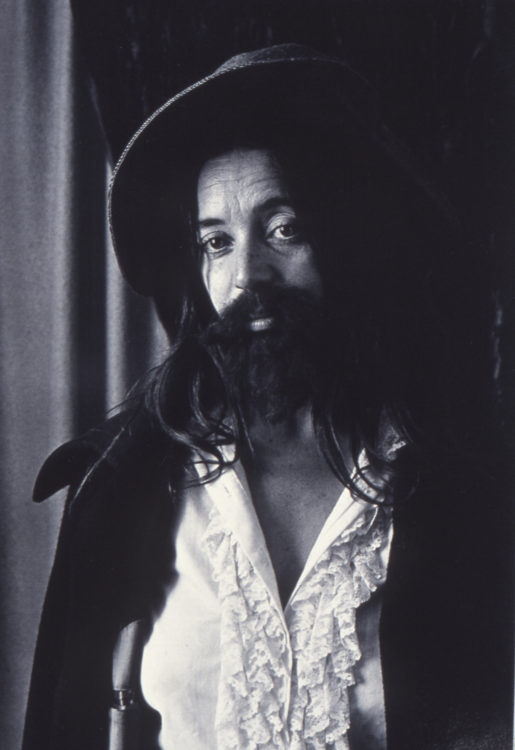
Eleanor Antin
1937 | Algérie

Martine Barrat
1933 | Brésil

Anna Bella Geiger
1931 — États-Unis | 2008 — Allemagne
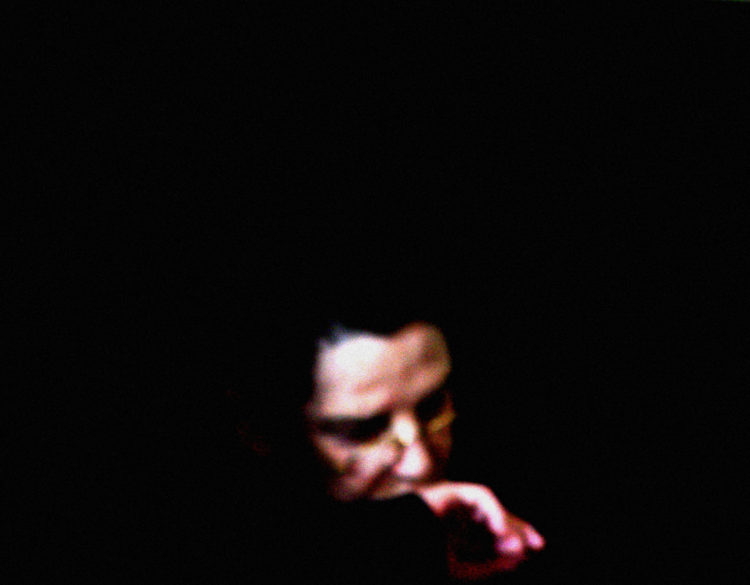
Nan Hoover
1949 | Croatie

Sanja Iveković
1967 | Grèce

Klonaris/Thomadaki
1937 — Japon | 2015 — États-Unis

Shigeko Kubota
1942 | Italie

Anna Maria Maiolino
1937 | Hongrie

Dóra Maurer
1933 | Japon

Yoko Ono
1947 | France

ORLAN
1945 | Grèce

Leda Papaconstantinou
1927 — 2004 | Brésil

Lygia Pape
1945 | Pologne

Ewa Partum
1943 | États-Unis
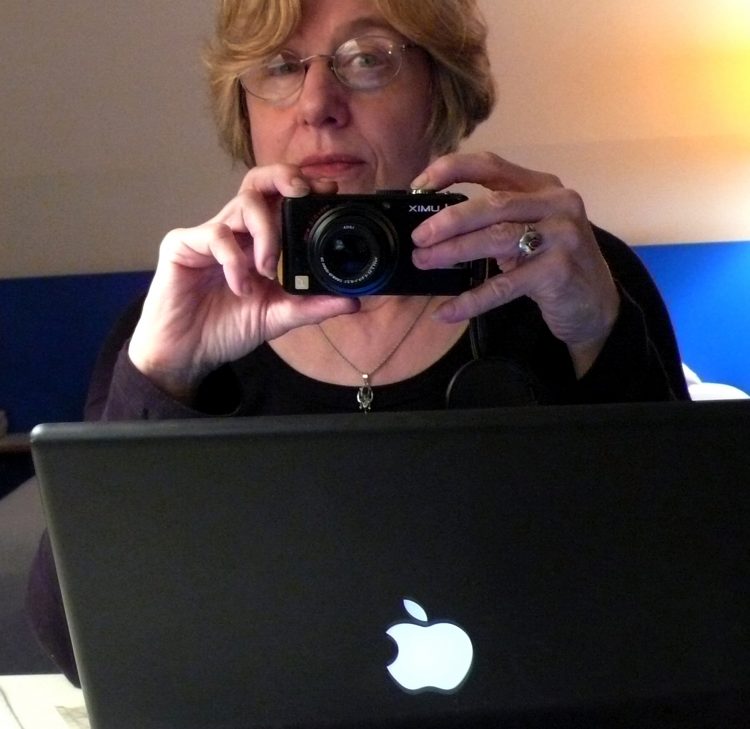
Martha Rosler
1928 — Belgique | 2019 — France

Agnès Varda
1962 | Russie

Olga Chernysheva
1936 | États-Unis

Barbara Kasten
1948 — Nouvelle-Zélande | 2014 — Royaume-Uni
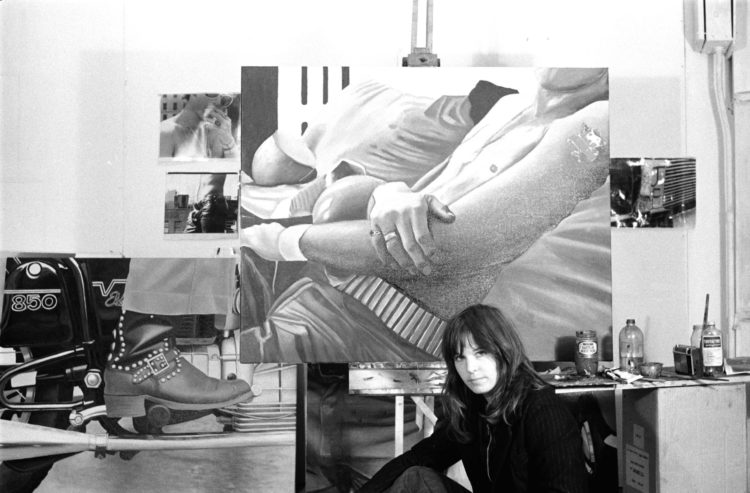
Alexis Hunter
1927 — États-Unis | 2019 — État-Unis

Lillian Schwartz
1909 — 1970 | États-Unis

Marie Menken
1962 | Suisse

Pipilotti Rist
1950 — Belgique | 2015 — France
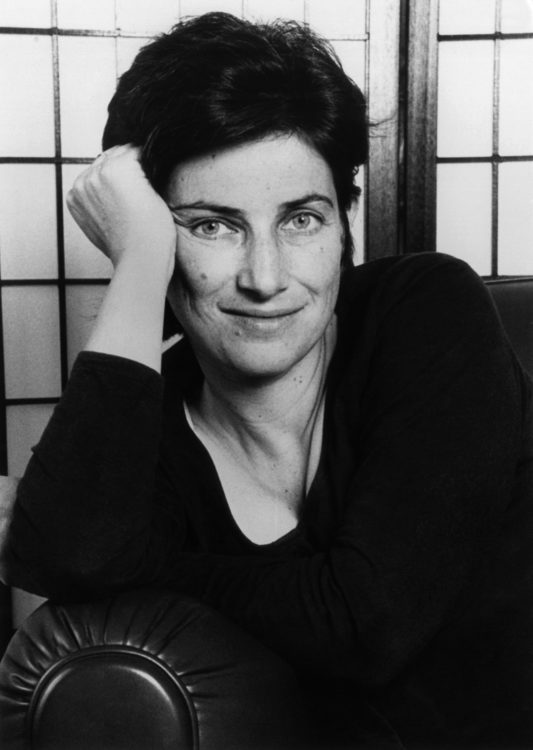
Chantal Akerman
1939 — 2019 | États-Unis
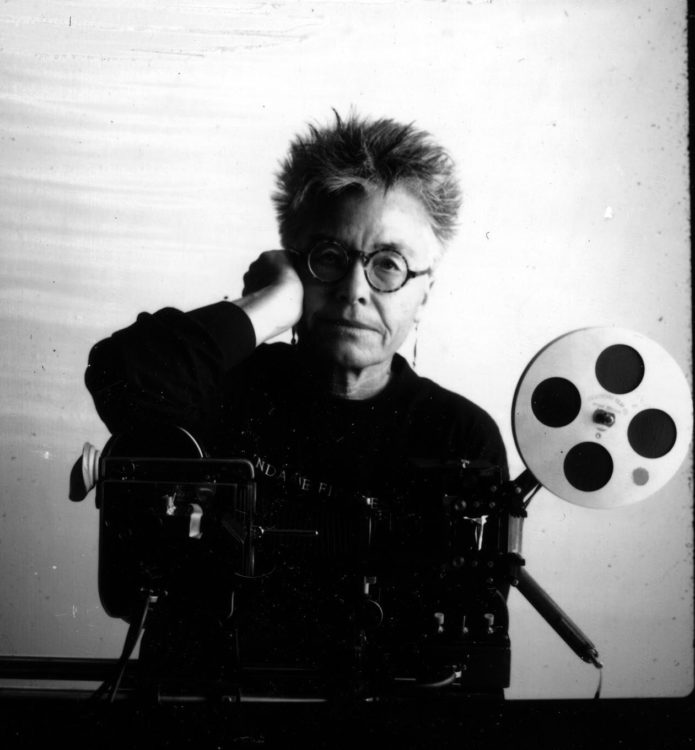
Barbara Hammer
1972 — Suisse | 1963 — Allemagne
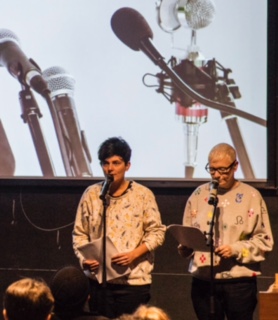
Pauline Boudry / Renate Lorenz
1954 | Taïwan
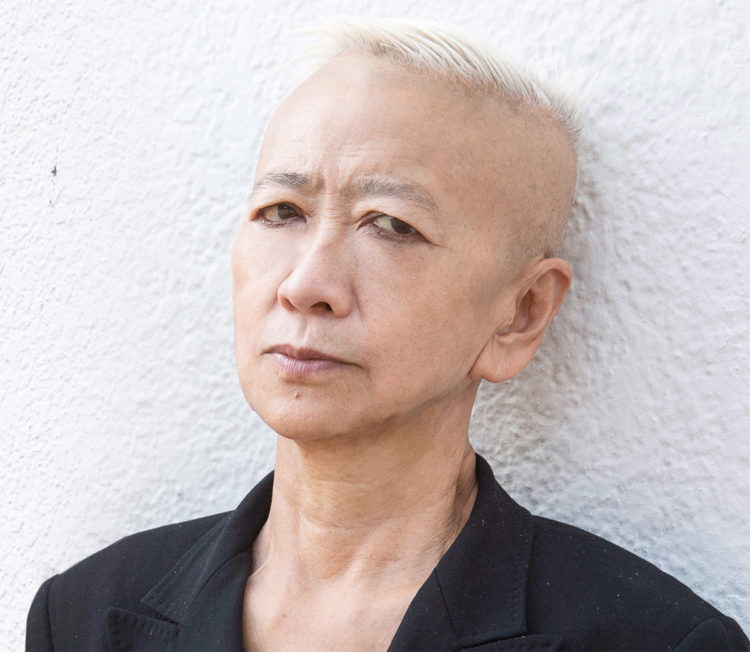
Shu Lea Cheang
1970 | Turquie

CANAN (Şenol)
1934 | États-Unis

Yvonne Rainer
1962 | Turquie

Şükran Moral
1992 | Espagne

Cabello/Carceller
1940 — 2015 | Espagne

Elena Asins
1960 | États-Unis

Lorna Simpson
1965 | Australie

Julie Gough
1961 | Australie

Lynette Wallworth
1956 | Espagne
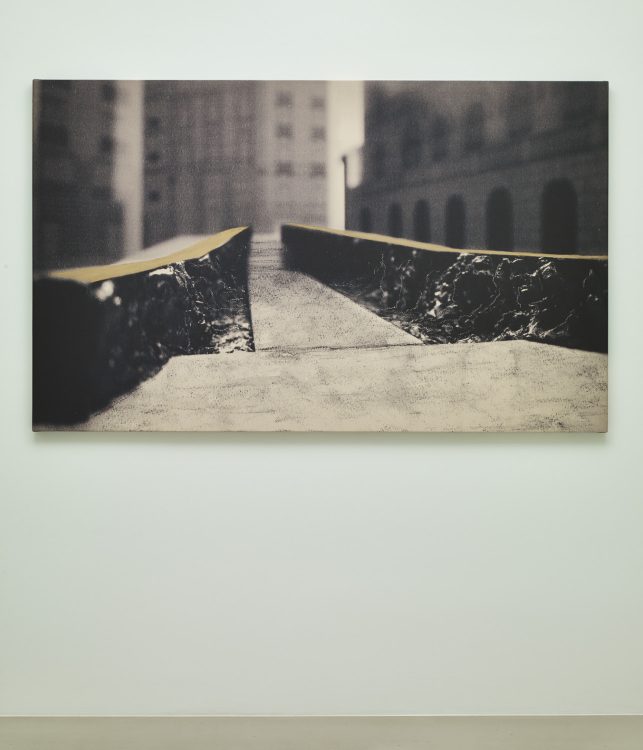
Cristina Iglesias
1951 — 2021 | Japon

Tāri Itō
1963 | France

Zineb Sedira
1959 | Japon

Yoshiko Shimada
1940 — 1993 | États-Unis

Hannah Wilke
1944 | Maroc

Joëlle de La Casinière
1969 | Israël

Nira Pereg
1969 | Hong Kong

MAN Phoebe Ching Ying
1970 | Autriche

Elke Silvia Krystufek
1959 | Estonie

Kai Kaljo
1947 | Pologne

Zofia Kulik
1937 — 2022 | Pologne

Natalia LL
1930 — 1998 | Canada

Joyce Wieland
1946 | Hongrie

Orshi Drozdik
1941 | Pérou
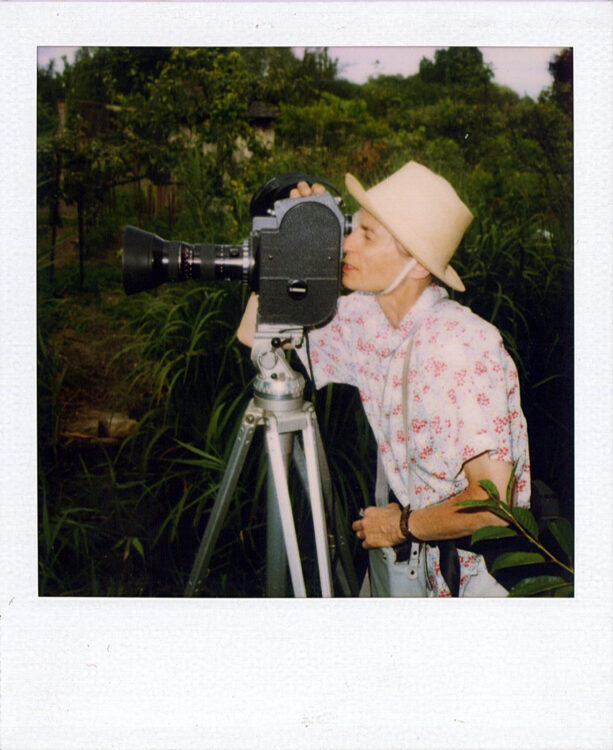
Rose Lowder
1954 | Israël

Michal Heiman
1972 | États-Unis

Maha Maamoun
1966 | Pays-Bas

Patricia Kaersenhout
1972 | Israël

Raida Adon
1951 — Corée du Sud | 1982 — États-Unis

Theresa Hak Kyung Cha
1961 | Chine

PAU Ellen
1959 | Canada

Dana Claxton
1969 | Russie

Louisa Babari
1973 | Viêt Nam

Trinh Thi Nguyen
1973 | Royaume-Uni

Rosalind Nashashibi
1940 | Japon
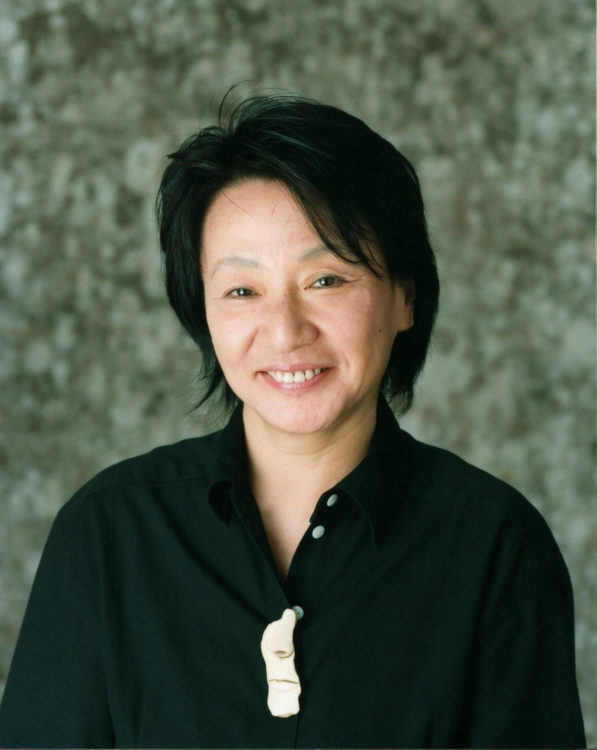
Mako Idemitsu
1960 | Birmanie

Phyu Mon
1962 — 2023 | Taïwan

HOU Lulu Shur-tzy
1973 | France

Agnès Geoffray
1973 | France

Katia Kameli
1973 | France

Maïder Fortuné
1973 | Luxembourg

Su-Mei Tse
1967 | Japon

Miwa Yanagi
1973 | France

Mathilde Rosier
1957 | Thailand

Araya Rasdjarmrearnsook
1973 | Brésil

Clarissa Tossin
1973 | Bulgarie

Rada Boukova
1946 — 2025 | États-Unis

Dara Birnbaum
1970 | Pays-Bas

Deborah Jack
1973 | États-Unis

Erika Vogt
1967 | Nigéria

Fatimah Tuggar
1971 | France

Yto Barrada
1941 | États-Unis

Lynn Hershman Leeson
1967 | Espagne

Tere Recarens
1965 | Espagne

Mabel Palacín
1974 | Danemark

Pia Rönicke
1974 | France

documentation céline duval (doc-cd)
1943 | France

Anne Deguelle
1963 | Espagne

Eulàlia Valldosera
1939 | Brésil

Regina Silveira
1956 | Brésil

Simone Michelin
1948 | République de Corée
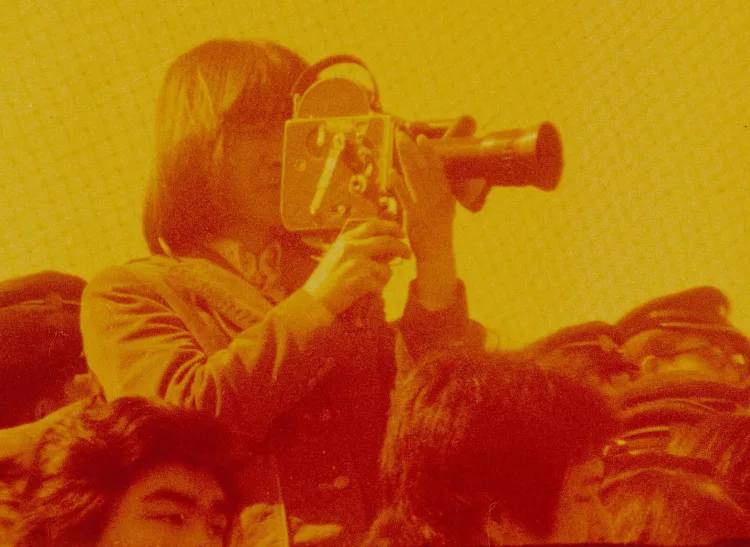
Okhi Han
1965 — 1991 | Mexique

Elvira Palafox Herrán
1974 | Allemagne

Ulla von Brandenburg
1974 | France

Marie Voignier
1970 | Hongrie

Eszter Salamon
1948 — Liban | 2019 — France

Jocelyne Saab
1971 | Ouzbékistan

Anna Ivanova
1958 | Royaume-Uni

Suzanne Treister
1956 | Syrie

Hala Alabdalla
1969 | Birmanie

Chaw Ei Thein
1971 | Ukraine

Kristina Solomoukha
1930 — 2013 | Serbie (Yougoslavie)

Bogdanka Poznanović
1954 | Brésil