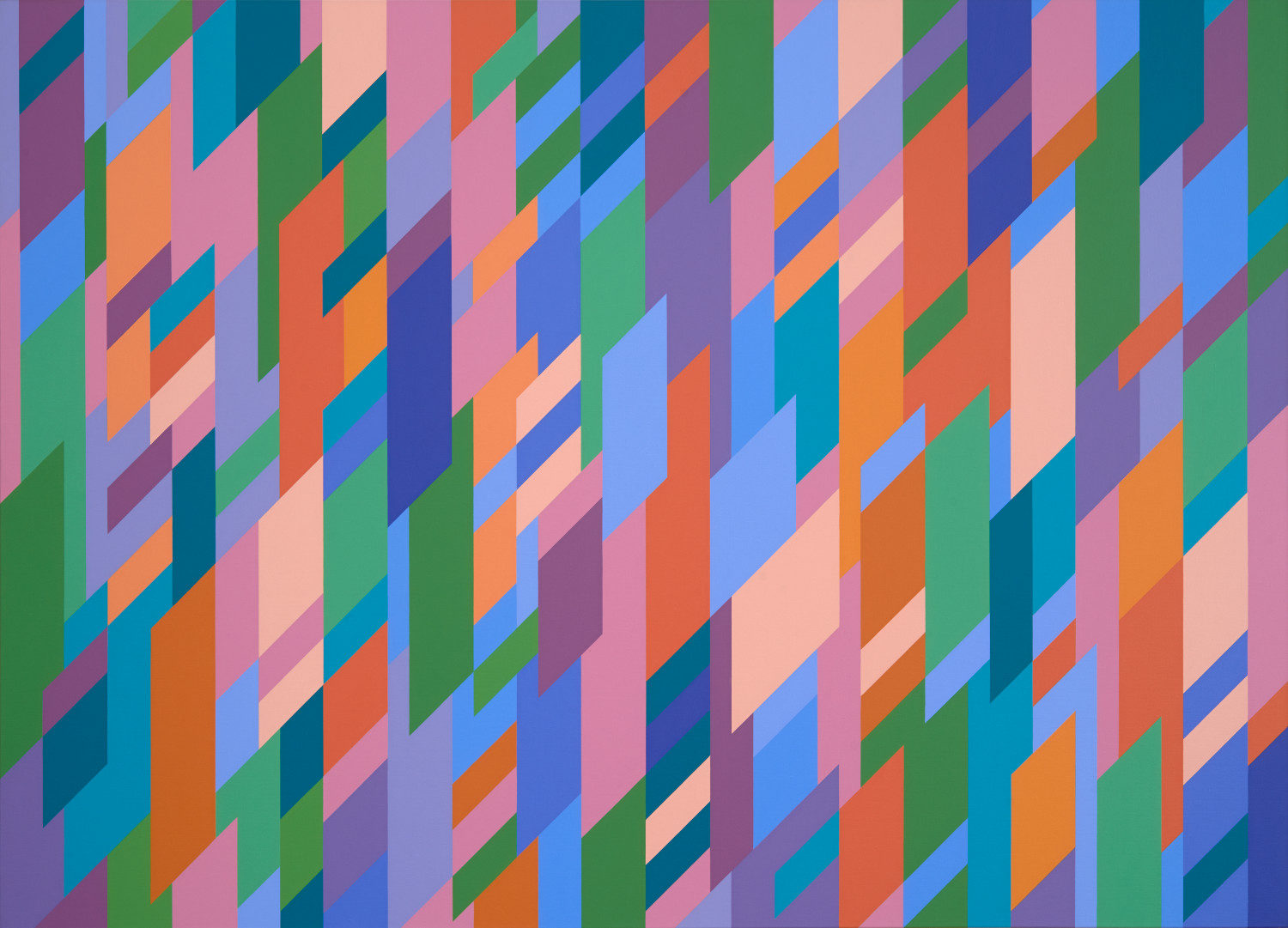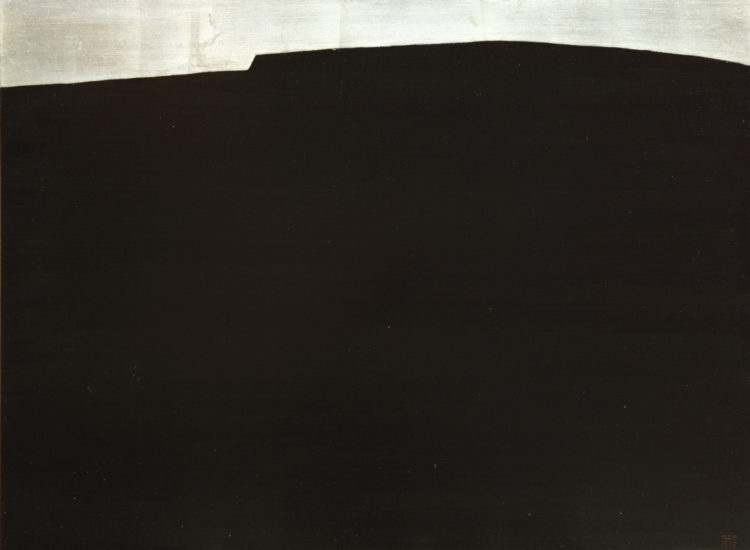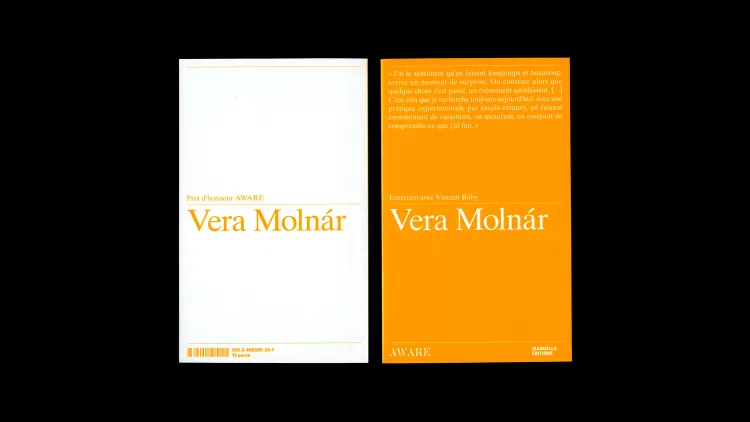Focus
Bridget Riley, For Genji, 1995/1996, huile sur toile de lin, 165 x 228,6 cm, © Droits Réservés, © Cnap, © Photo : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix
L’abstraction est la révolution artistique du XXe siècle. Influencée par le développement de la physique quantique et héritière de l’impressionnisme, du fauvisme et du cubisme, elle s’impose comme l’inspiration principale de la période. Ce courant renouvelle les codes traditionnels de la peinture et de la sculpture, en décomposant l’image pour sacraliser la forme pure et la couleur. En histoire de l’art, la genèse de l’abstraction coïncide à la réalisation en 1910 de Sans titre de Wassily Kandinsky (1866-1944), puis par le travail de jeunes artistes comme František Kupka (1871-1957), Kazimir Malevitch (1879-1935) ou Piet Mondrian (1872-1944) qui abandonnent progressivement la représentation du réel pour n’en garder que l’essence et l’émotion. Selon les récits de l’histoire de l’art, les artistes femmes ne se seraient donc pas saisies des codes de ce mouvement. Pourtant, Hilma af Klint (1862-1944), peintre suédoise, délaisse les compositions figuratives dès 1905. Son travail n’est redécouvert qu’en 1986 à l’occasion de l’exposition The Spiritual in Art : Abstract Painting 1890-1985 au LACMA à Los Angeles, où elle est présentée comme pionnière de l’abstraction. Sa peinture médiumnique, mais aussi la pratique méditative d’Agnes Martin (1912-2004) témoignent des recherches acharnées sur l’essentialisation du geste artistique.
Comme leurs pairs masculins, certaines artistes femmes utilisent les couleurs pour explorer les représentations de la forme. La peintre et sculptrice Marlow Moss (1890-1958) joue avec les lignes orthogonales et diagonales qu’elle dédouble en 1930 et dont finalement elle se détache pour expérimenter la clarté et les reliefs du blanc. Aurélie Nemours (1910-2005), s’adonne aussi à la monochromie et préfère le blanc aux couleurs vives. Les recherches picturales de l’artiste italienne Carla Accardi (1924-2014), partisane de la figuration réaliste, transcende la couleur, en approfondissant d’abord l’étude du noir et blanc pour en venir à l’utilisation des fluos au cours des années 1970.
L’artiste libanaise, Saloua Raouda Choucair (1916-2017) lie sa quête artistique avec la tradition islamique soufie, l’absence de la figuration est pour elle ce qui ramène l’œuvre à l’essentiel de la pensée. La quête de la forme constitue un mouvement à part dans cette révolution picturale : l’abstraction géométrique, à laquelle les artistes femmes prennent pleinement part. D’origine roumaine, Natalia Dumitresco (1915-1997) joue avec la géométrique, ronds, carrés et autres stries se chamaillent pour offrir une vision kaléidoscopique. Bĕla Kolářová (1923-2010) questionne par la photographie, mais aussi l’assemblage et le dessin, les structures des objets qu’elle détourne de leur fonction primaire. Elle innove et invente ses propres moyens de création, comme le négatif artificiel où l’image née par la seule utilisation d’une chambre noire. Vera Molnár (née en 1924), artiste cinétique hongroise, réalise, quant à elle, des expérimentations artistiques à l’aide de l’informatique.
1895 — 1981 | France

Marcelle Cahn
1923 — 2010 | République tchèque
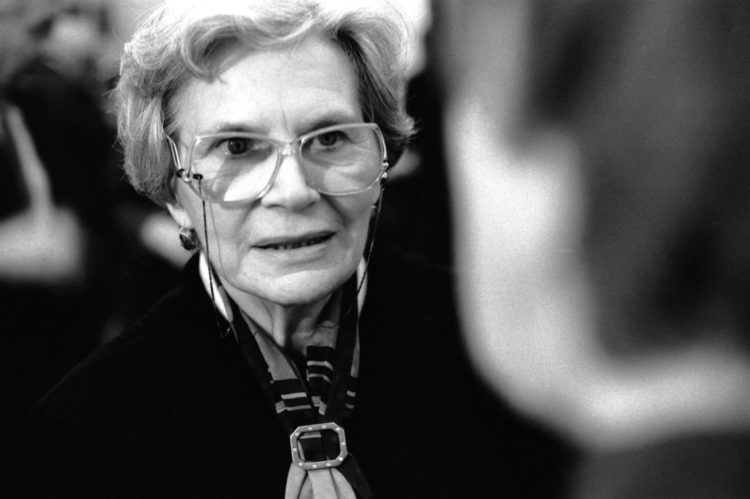
Bĕla Kolářová
1924 — Hongrie | 2023 — France

Vera Molnár
1890 — 1958 | Royaume-Uni
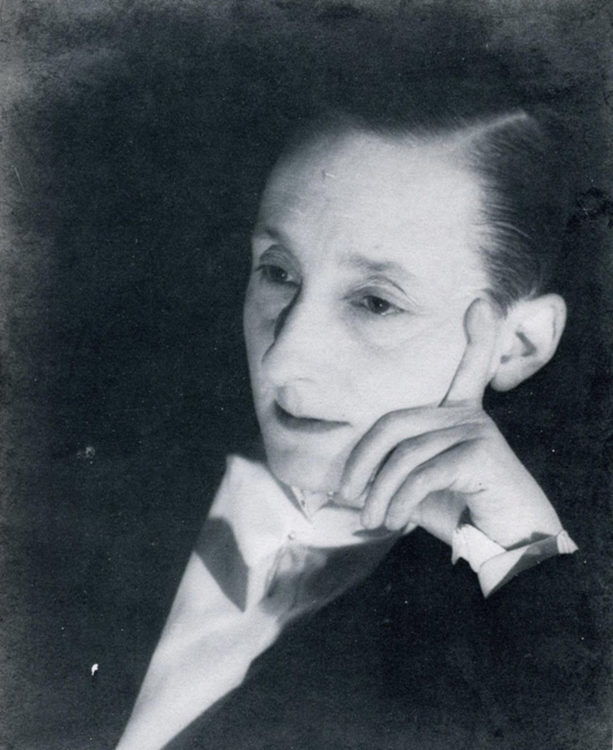
Marlow Moss
1910 — 2005 | France
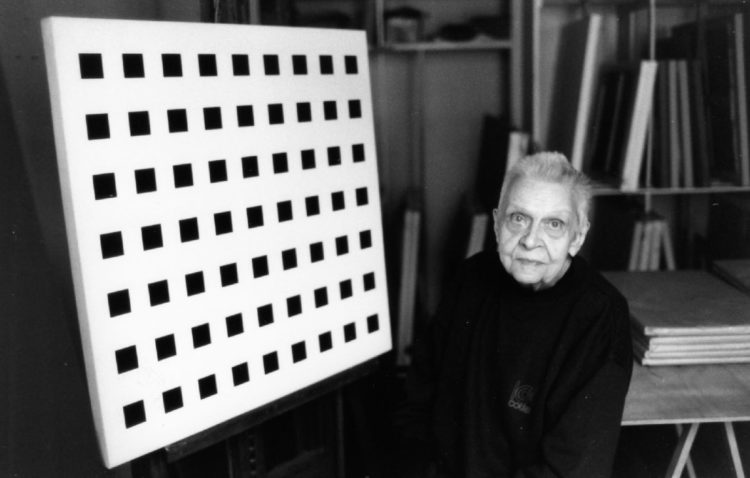
Aurélie Nemours
1924 — 2014 | Italie

Carla Accardi
1931 | Royaume-Uni

Bridget Riley
1935 — 2018 | France

Geneviève Claisse
1950 | Estonie

Sirje Runge
1915 — Roumanie | 1997 — France
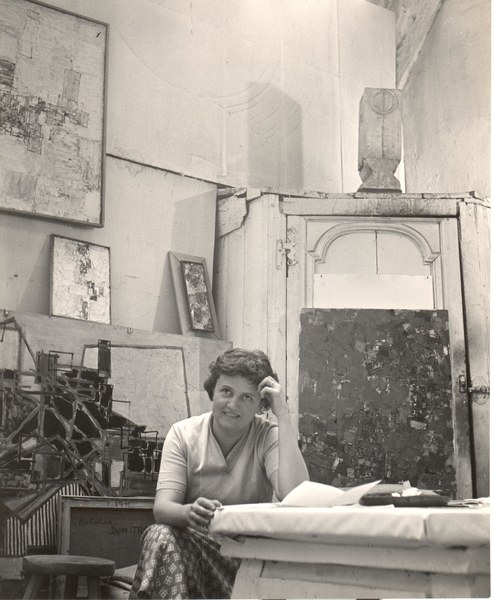
Natalia Dumitresco
1912 — Canada | 2004 — États-Unis
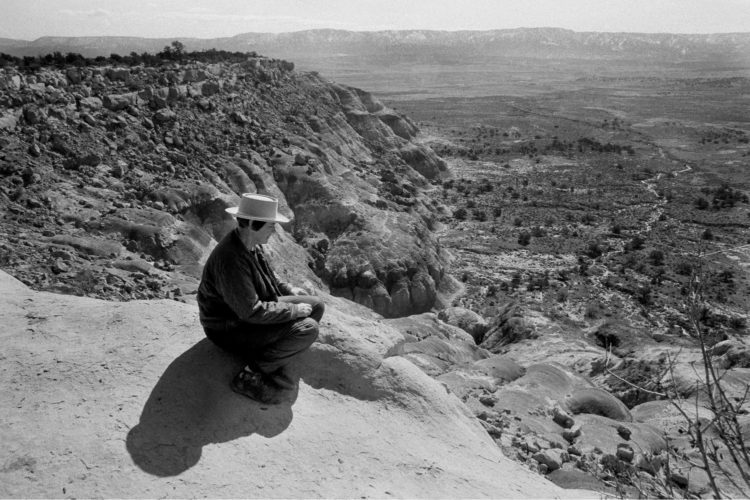
Agnes Martin
1923 — 2021 | France
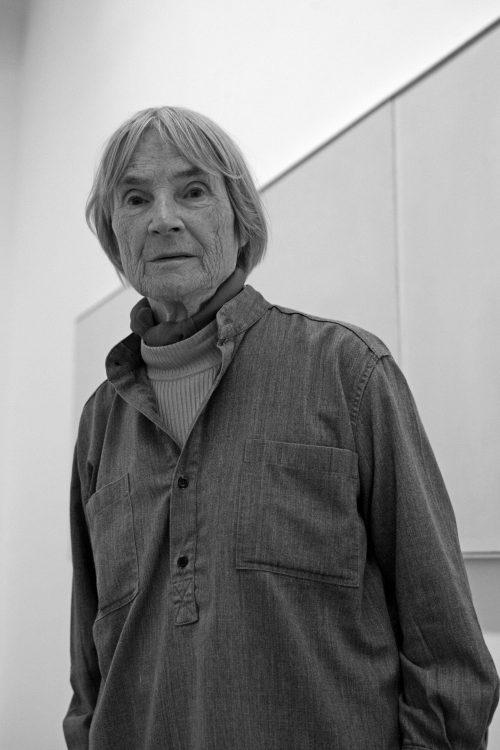
Geneviève Asse
1930 — 2005 | Belgique

Marthe Wéry
1899 — 1986 | Danemark

Franciska Clausen
1862 — 1944 | Suède

Hilma af Klint
1915 — Cuba | 2022 — États-Unis

Carmen Herrera
1909 — Suède | 1987 — France
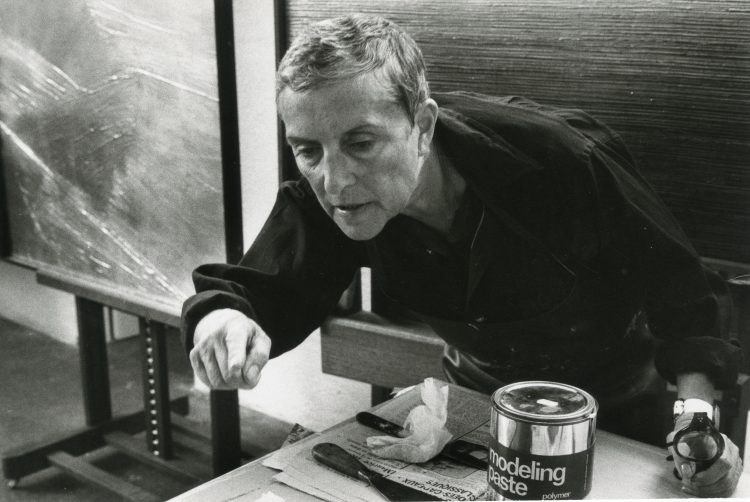
Anna-Eva Bergman
1916 — 2017 | Liban
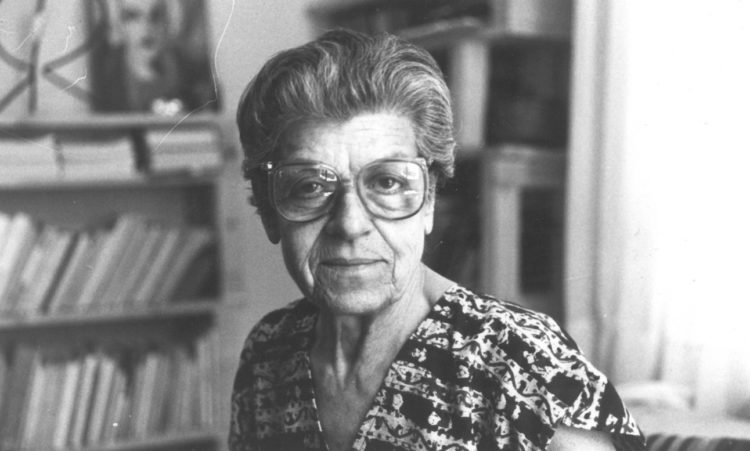
Saloua Raouda Choucair
1877 — 1952 | États-Unis

Katherine Dreier
1918 — 1989 | États-Unis

Elaine de Kooning
1932 — 2005 | Japon

Atsuko Tanaka
1907 — 2007 | États-Unis

Lenore Tawney
1910 — Canada | 1997 — États-Unis

Ida Lansky
1891 — 1978 | États-Unis

Alma Woodsey Thomas
1900 — 1981 | Italie
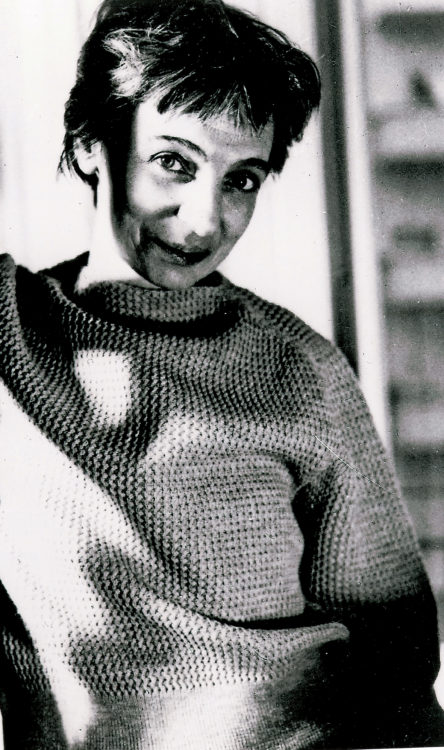
Bice Lazzari
1936 | Palestine mandataire
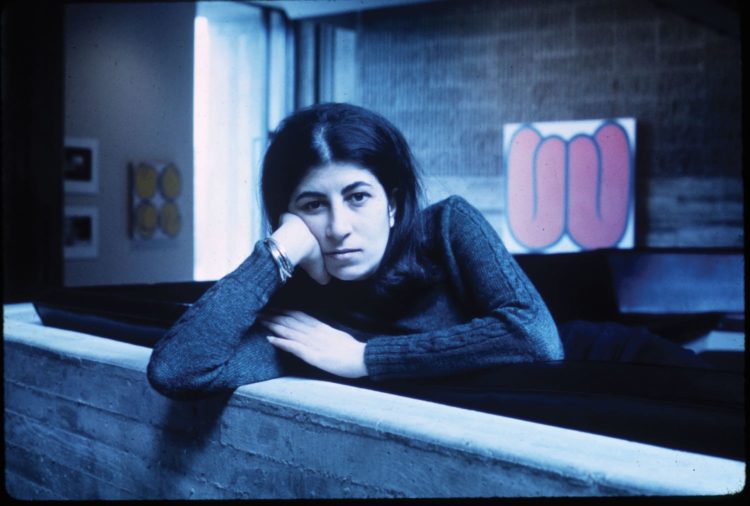
Samia Halaby
1911 — Danemark | 1984 — France

Sonja Ferlov Mancoba
1912 — 2000 | Allemagne
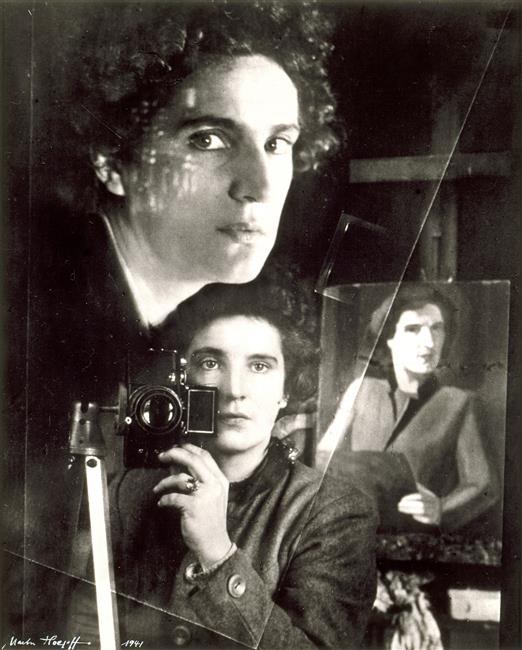
Marta Hoepffner
1912 — 1986 | Suisse
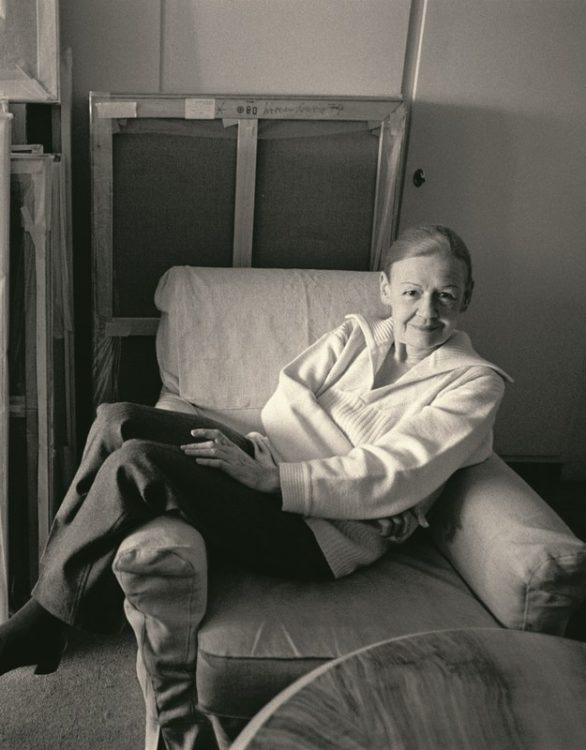
Verena Loewensberg
1937 | Autriche

Tess Jaray
1936 | États-Unis

Barbara Kasten
1929 — 2015 | Norvège

Inger Sitter
1930 — 2004 | Italie

Dadamaino (Eduarda Emilia Maino, dite)
1940 — 1985 | Corée

Wook-kyung Choi
1939 — 2015 | États-Unis

Rosemarie Castoro
1814 — Espagne | 1884 — Royaume-Uni
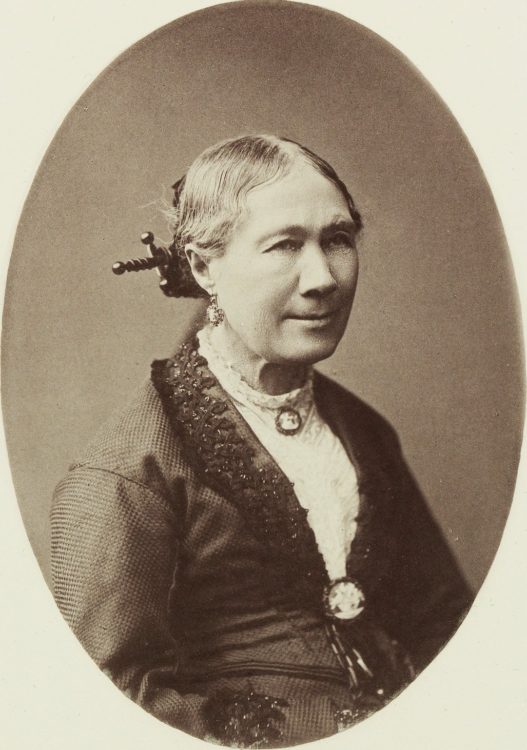
Georgiana Houghton
1929 — 2018 | États-Unis

Marcia Hafif
1903 — 1974 | Turquie

Aliye Berger
1897 — Allemagne | 1983 — Suisse

Gunta Stölzl
1932 | Canada

Dorothea Rockburne
1885 — 1963 | Royaume-Uni

Helen Saunders
1892 — 1976 | Allemagne

Benita Koch-Otte
1927 — États-Unis | 2019 — État-Unis

Lillian Schwartz
1940 | États-Unis
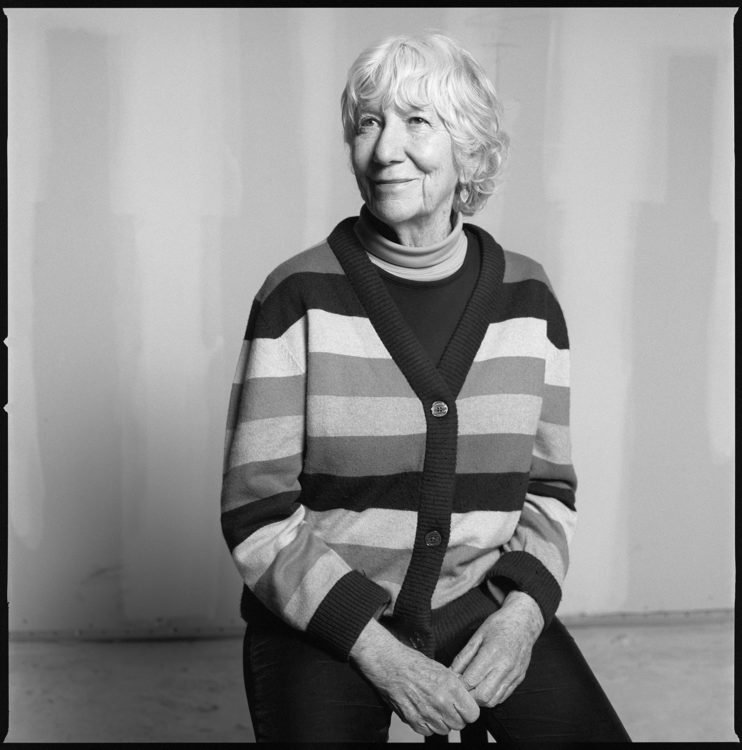
Mary Heilmann
1923 — États-Unis | 2009 — Liban
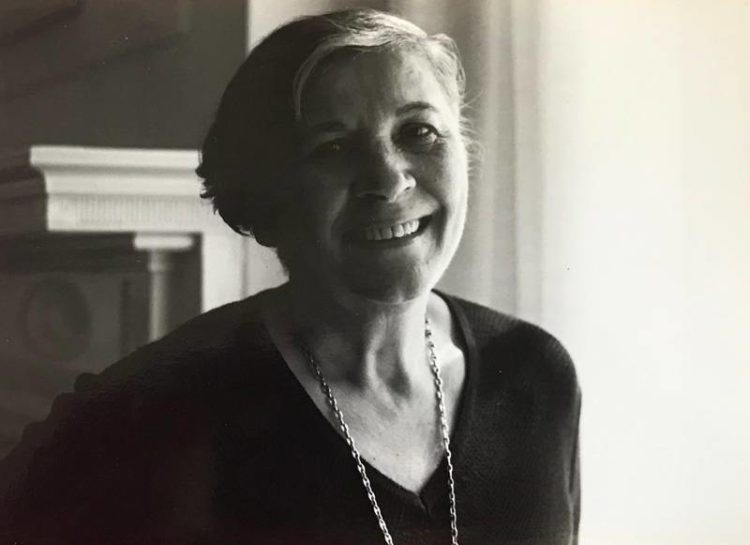
Helen Khal
1930 — Croatie (ancienne Yougoslavie) | 2022 — Italie

Jagoda Buić
1936 — 1998 | États-Unis

Bernice Bing
1896 — 1983 | États-Unis

Charmion von Wiegand
1944 | États-Unis

Harmony Hammond
1910 — 1974 | Danemark

Else Alfelt
1924 — Chine | 2011 — Australie

Irene Chou
1946 | Nouvelle-Zélande

Liz Coats
1889 — 1943 | Norvège

Ragnhild Keyser
1927 | France

Colette Brunschwig
1923 — États-Unis | 2016 — France
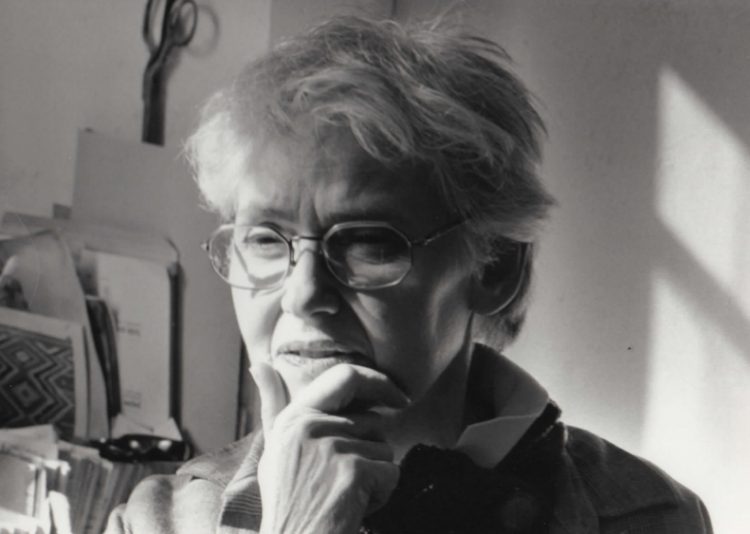
Shirley Jaffe
1956 | Suisse

Silvia Bächli
1950 — 2004 | Japon
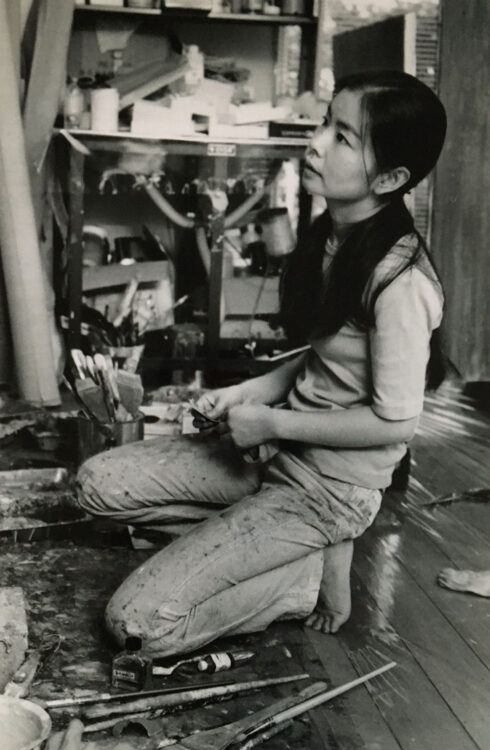
Toeko Tatsuno
1925 — États-Unis | 1992 — France
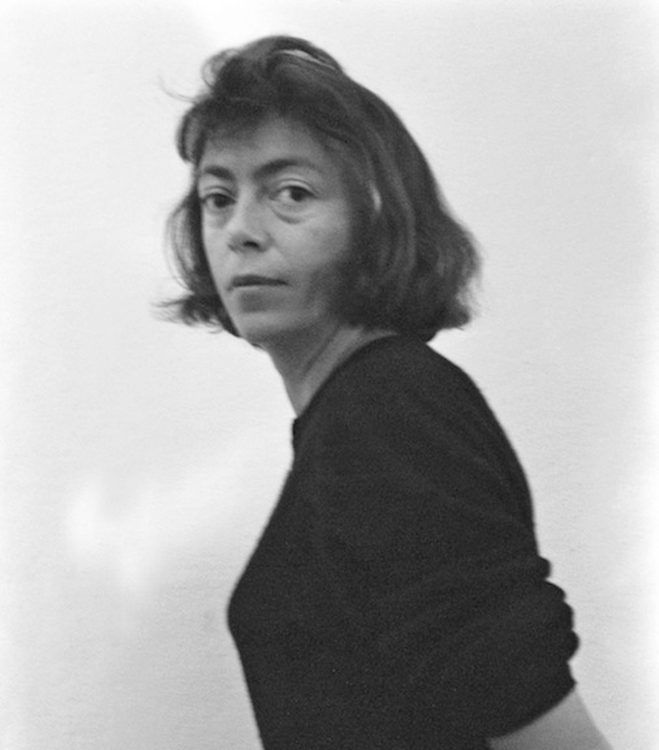
Joan Mitchell
1930 — 2018 | Royaume-Uni

Gillian Ayres
1929 | États-Unis

Jo Baer
1959 | Australie

Judy Watson
1953 | États-Unis

Joanne Greenbaum
1941 — 2009 | Allemagne
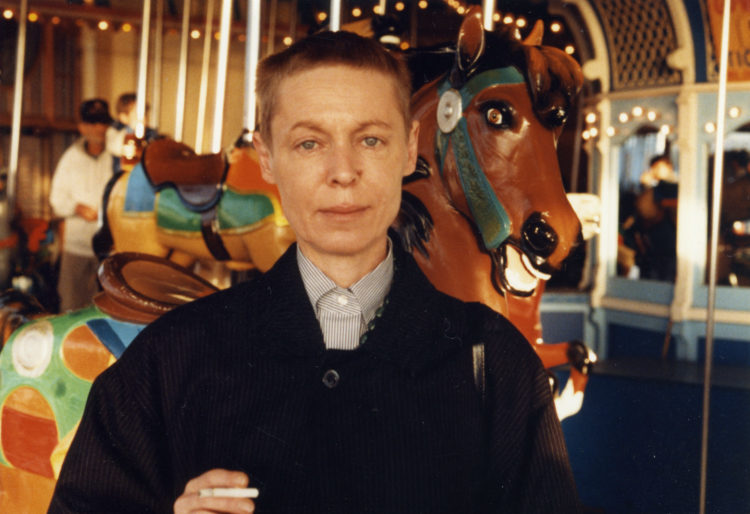
Hanne Darboven
1905 — Moldavie | 1990 — France

Ida Karskaya
1964 | France

Dominique De Beir
1928 — 2011 | États-Unis
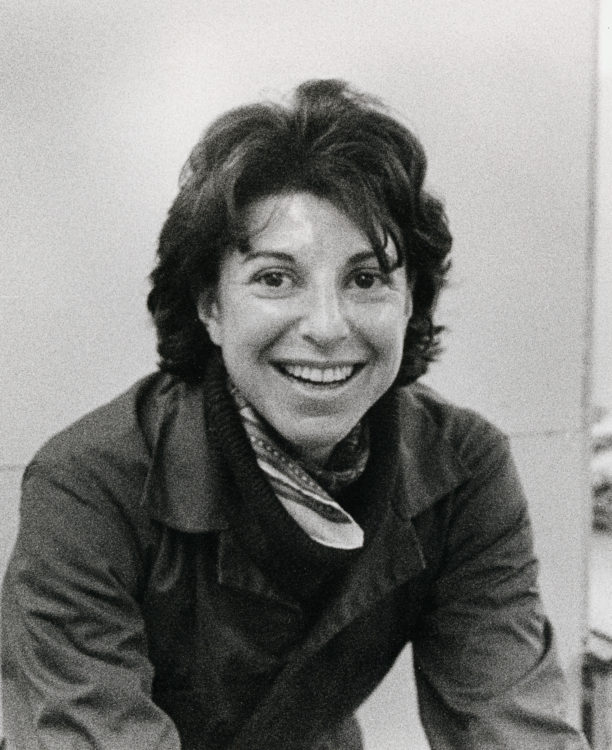
Helen Frankenthaler
1938 | Lettonie
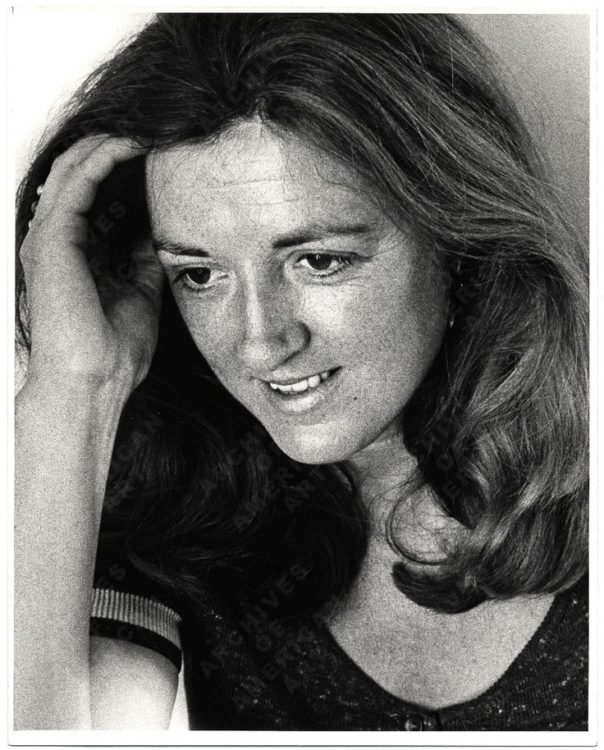
Vija Celmins
1951 | Maroc

Chantal Petit (dite chantalpetit)
1908 — 1984 | États-Unis

Lee Krasner
1928 — 2017 | France

Pierrette Bloch
1943 | Mexique

Edda Renouf
1936 | Royaume-Uni

Gillian Wise
1925 — 2006 | Royaume-Uni

Sandra Blow
1928 — 2021 | Canada

Rita Letendre
1929 — 1989 | États-Unis

Jay DeFeo
1935 | États-Unis

Kay WalkingStick
1921 — Irak | 2015 — Israël

Claire Yaniv
1928 — Brésil | 2024 — Liban

Yvette Achkar
1917 — 2015 | Uruguay
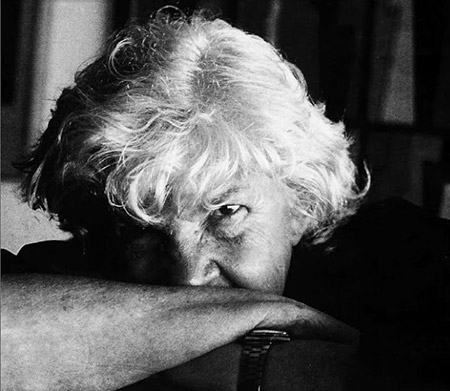
María Freire
1961 | Allemagne

Katharina Grosse
1952 | Suriname

Dineke Blom
1923 | Canada

Françoise Sullivan
1973 | Liban

Lina Jabbour
1941 — 2016 | Malaisie
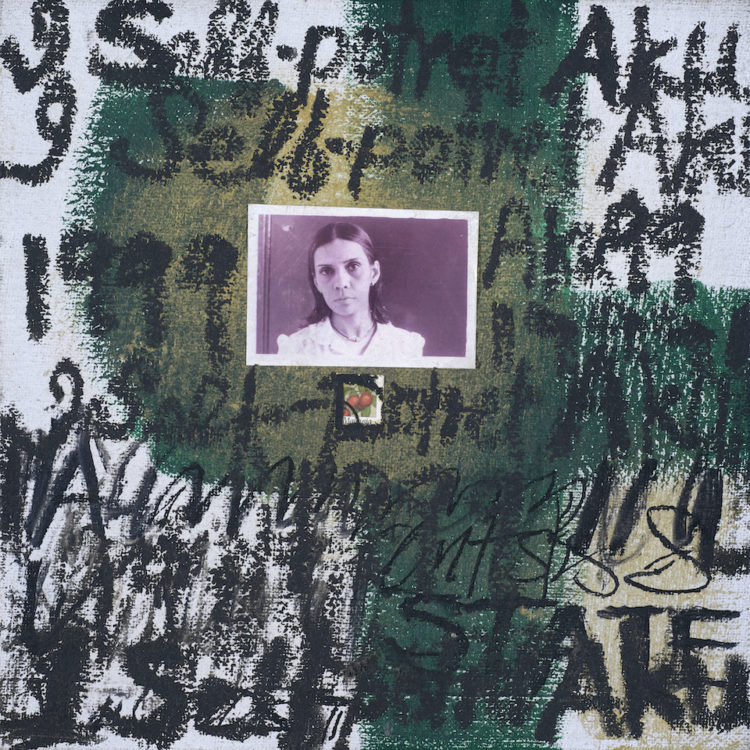
Nirmala Dutt Shanmughalingam
1971 | France

Julie Bessard
1945 | États-Unis
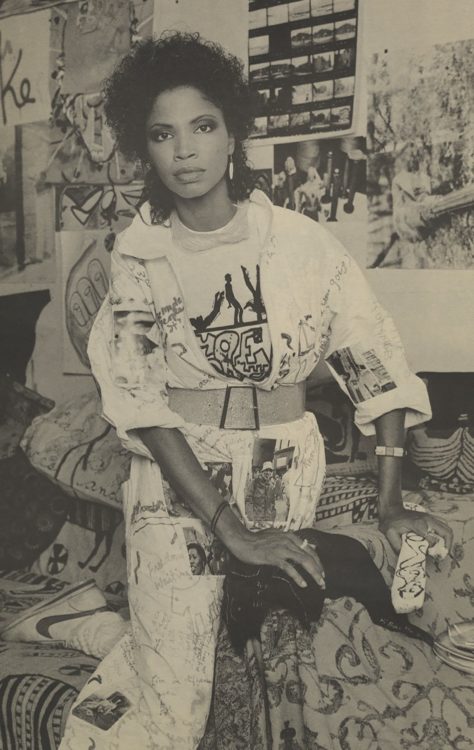
Candace Hill-Montgomery
1901 — 1971 | Cuba

Loló Soldevilla
1931 | Australie
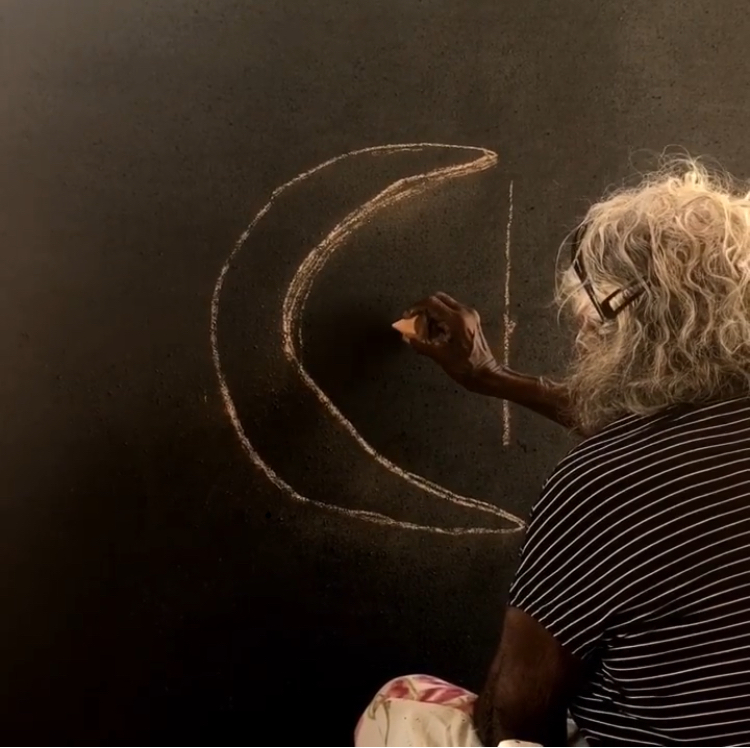
Mabel Juli Wirringgoon
1952 | Israël
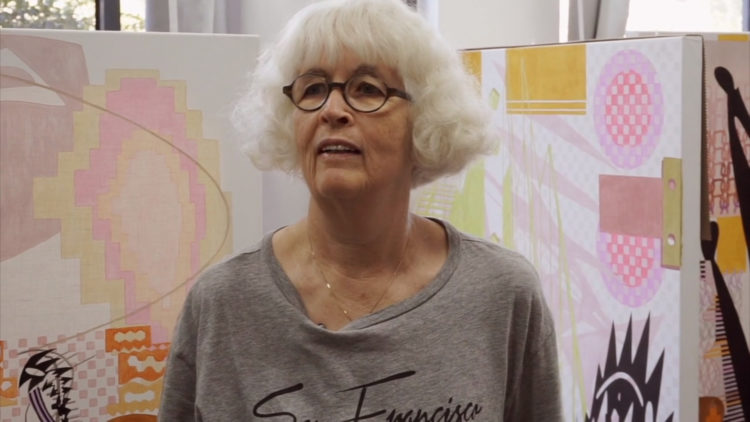
Nurit David
1974 | France

Isabelle Cornaro
1939 | Égypte

Wissam Fahmy
1909 — 1976 | France

Roberta González
1951 | Philippines

Ileana Lee
1933 — 1999 | Lituanie

Kazimiera Zimblytė
1920 — 2005 | France

Huguette Arthur Bertrand
1936 | Liban

Nadia Saikali
1933 — 1988 | Japon

Seiko Kanno
1930 — 2020 | Pologne

Urszula Broll
1944 — 2025 | Liban

Samia Osseiran Junblat
1945 — 2003 | Indonésie
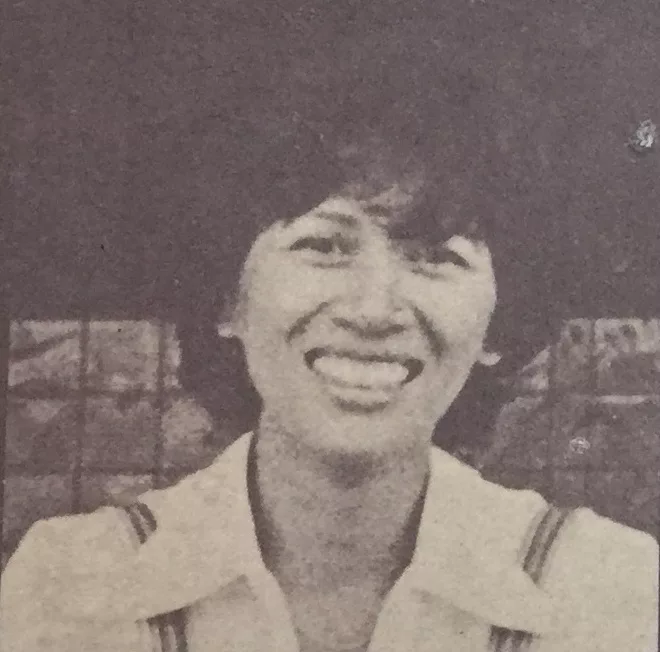
Hildawati Soemantri
1934 — 2014 | Colombie