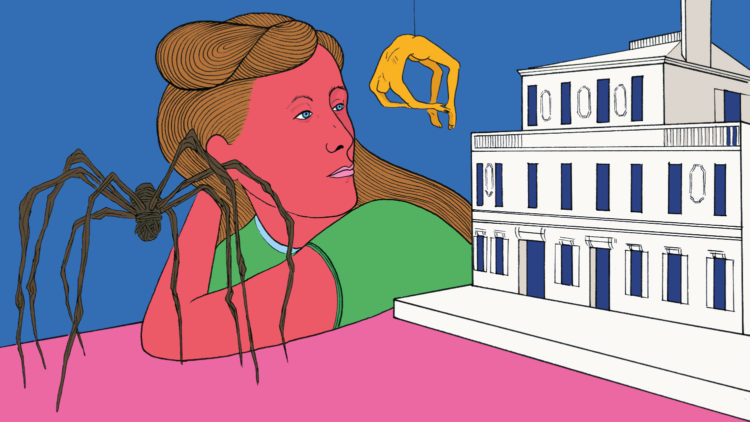Focus
Au XIXe siècle, lorsque la discipline de l’histoire de l‘art se forme, un débat s’ouvre quant aux origines de celui-ci. Bien que l’acte de transformer des ressources végétales ou animales en fibres puis en un tissu soit considéré comme un moment fondamental de la production culturelle, les pratiques textiles sont attribuées à la sphère domestique et féminine, et par conséquent exclues de la théorisation de l’art. Seuls les textiles de haute qualité – et de confection masculine – sont reconnus comme ayant eu une influence sur le développement artistique. Mais, dans l’ensemble, le textile demeure exclu du canon moderne, ce qui s’explique par le discours sur l’autonomie de l’art et sur l’opposition entre les arts appliqués et les arts libres. Cela souligne la subordination de l’art textile, « tactile », à l’art optique de la peinture.
Dès les premières avant-gardes, au tournant du XXe siècle, des artistes femmes explorent les techniques et les matériaux de l’art textile. Sonia Delaunay (1885-1979) conçoit et coud des costumes pour des ballets, dont les motifs en patchwork s’animent sur les corps. Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), quant à elle, réalise des compositions brodées et tissées pour des tapis ou des housses de coussins, ainsi que des objets perlés. Le plus souvent, on considère que le développement du textile en tant que médium de l’art moderne débute au Bauhaus, où il est théorisé pour la première fois. Dans les ateliers de tissage de l’école, Gunta Stölzl (1897-1983), Otti Berger (1898-1944), Anni Albers (1899-1994) et d’autres allient recherche artistique formelle et expérimentations industrielles. Si, au départ, elles s’inspirent d’une approche picturale en produisant des « tableaux » en laine, elles développent par la suite une démarche spécifique au médium et reconnaissent la qualité particulière du textile en tant qu’interface entre le monde haptique et le monde optique.
Dans les années 1960, le mouvement du Fiber Art continue de développer une approche spécifique au textile, en lien avec les théories esthétiques contemporaines. Claire Zeisler (1903-1991), Lenore Tawney (1907-2007), Olga de Amaral (née en 1932) ou Sheila Hicks (née en 1934) libèrent les œuvres du métier à tisser, les transformant en sculptures. Dans une démarche revendiquée comme émancipatrice, le médium s’affranchit de toute fonction utilitaire et s’établit comme un objet du monde de l’art contemporain.
Dans le cadre du mouvement féministe des années 1970, des artistes telles que Miriam Schapiro (1923-2015), Faith Ringgold (1930-2024) ou Annette Messager (née en 1943) se réfèrent à des pratiques textiles considérées comme mineures pour en explorer les qualités spécifiques et mettre en lumière la vie, le travail et la créativité des femmes, longtemps négligés. Elles démontrent ainsi que l’opposition entre art et artisanat repose sur des hiérarchies sociales de genre et de race, et dans le même temps conduit à la stabilisation de celles-ci, la prétendue habileté manuelle intuitive des femmes servant de base pour leur nier toute faculté créatrice.
De nombreuses artistes, dont Ntombephi Ntobela (née en 1966), Marie Watt (née en 1967) et Yee I-Lann (née en 1971), explorent aujourd’hui les techniques et les matériaux textiles, en s‘appuyant sur la transmission de connaissances issues de différentes cultures du monde entier, qu’elles interrogent, revitalisent et/ou développent davantage. Elles contribuent ainsi à une revalorisation du textile dans le monde de l’art et remettent en question la séparation entre la création d’œuvres artistiques et la production d’objets ethnologiques.
1899 — Allemagne | 1994 — États-Unis

Anni Albers
1943 | France

Annette Messager
1936 — Jamaïque | 2017 — France
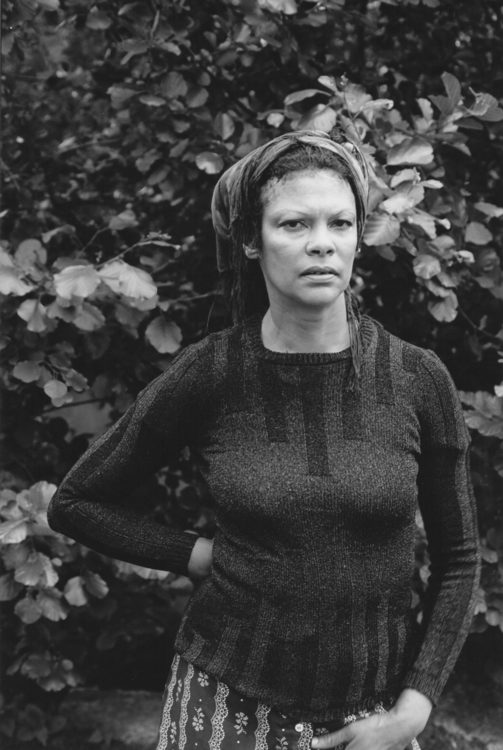
Hessie (Hessie Djuric, née Johnston, dite)
1939 | France

Raymonde Arcier
1934 | États-Unis

Sheila Hicks
1889 — 1943 | Suisse

Sophie Taeuber-Arp
1911 — France | 2010 — États-Unis

Louise Bourgeois
1963 | Égypte

Ghada Amer
1930 — 2017 | Pologne
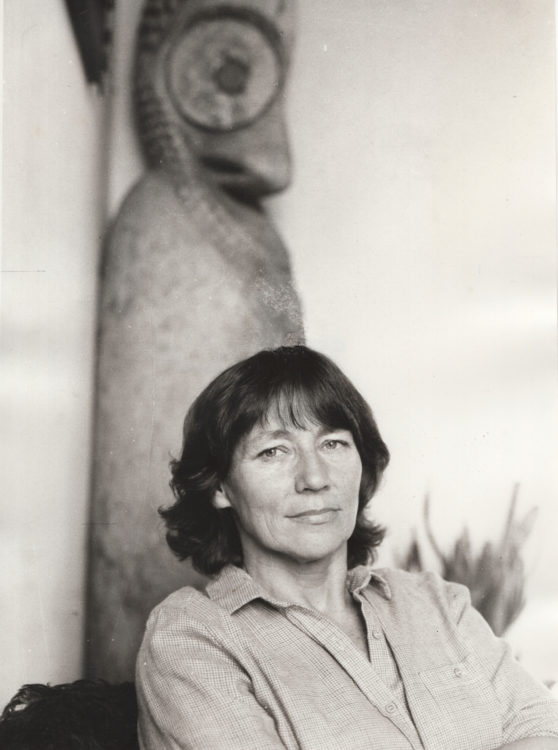
Magdalena Abakanowicz
1925 — Suisse | 2015 — France
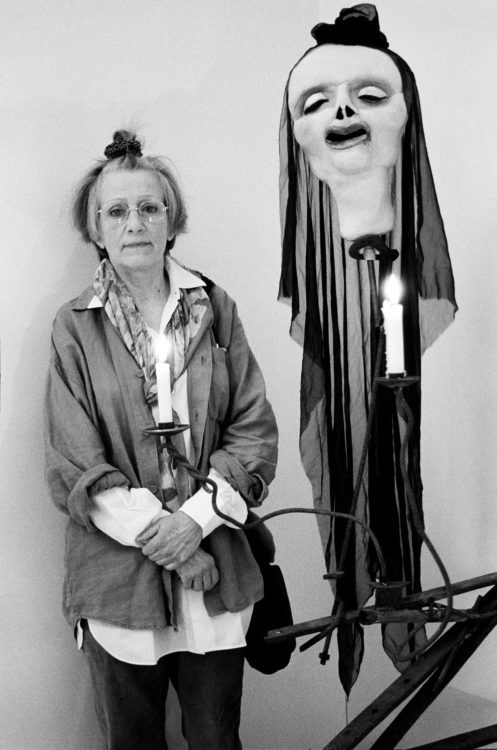
Eva Aeppli
1963 | Inde

Rina Banerjee
1939 | France

Bernadette Bour
1926 — 2018 | Roumanie

Geta Brătescu
1931 — 2019 | Liban
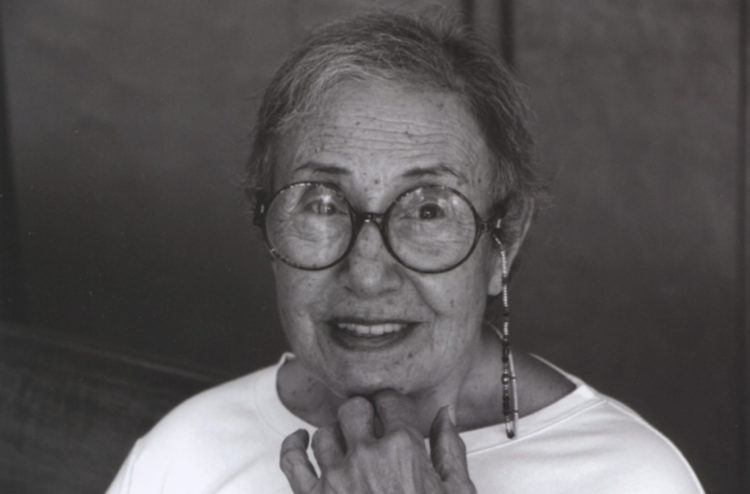
Huguette Caland
1969 | Vietnam

Tiffany Chung
1932 | Colombie

Olga de Amaral
1963 | Royaume-Uni

Tracey Emin
1942 | États-Unis

Jann Haworth
1908 — Ukraine | 1958 — Pologne
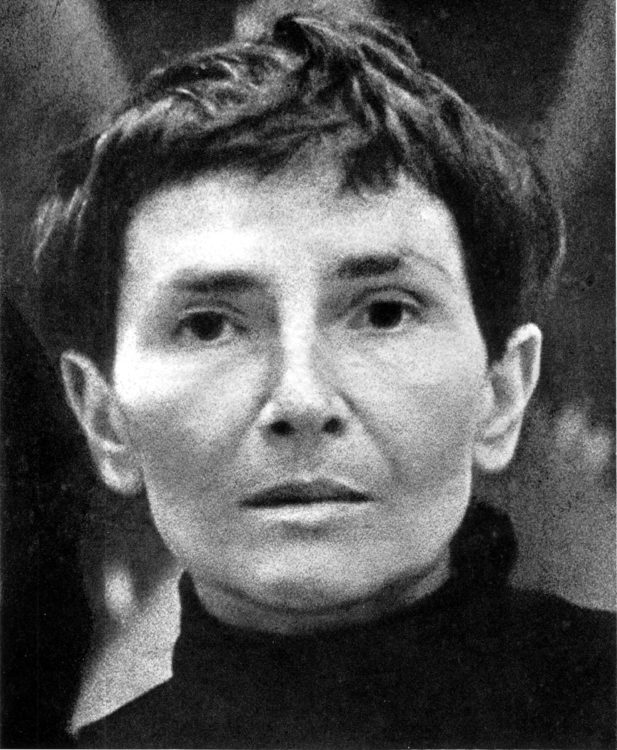
Maria Jarema
1944 | Australie

Yvonne Koolmatrie
1892 — Pologne | 1966 — France

Jeanne Kosnick-Kloss
1958 | Irlande
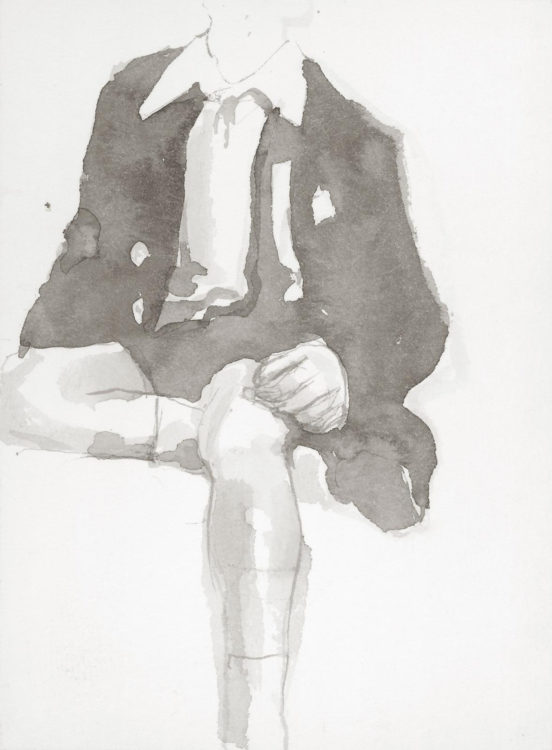
Kathy Prendergast
1929 — Japon | 2025 — Allemagne

Takako Saito
1961 | Chine
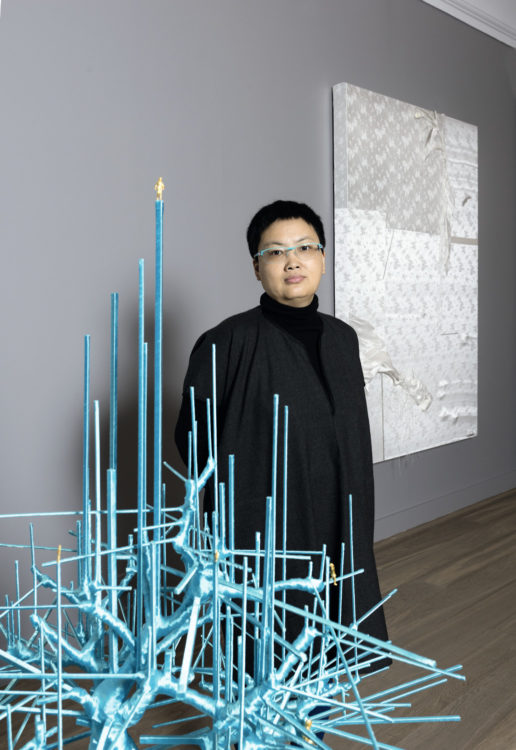
Lin Tianmiao
1942 | Nouvelle-Zélande

Maureen Lander
1907 — 2007 | États-Unis

Lenore Tawney
1966 | Zambie

Agnes Buya Yombwe
1940 | Argentine

Delia Cancela
1971 | Nouvelle-Zélande

Ani O’Neill
1897 — Allemagne | 1983 — Suisse

Gunta Stölzl
1892 — 1976 | Allemagne

Benita Koch-Otte
1894 — Suède | 1970 — Norvège

Hannah Ryggen
1903 — Pologne | 2000 — Allemagne

Gertrud Arndt
1930 — Croatie (ancienne Yougoslavie) | 2022 — Italie

Jagoda Buić
1926 — 2011 | Espagne
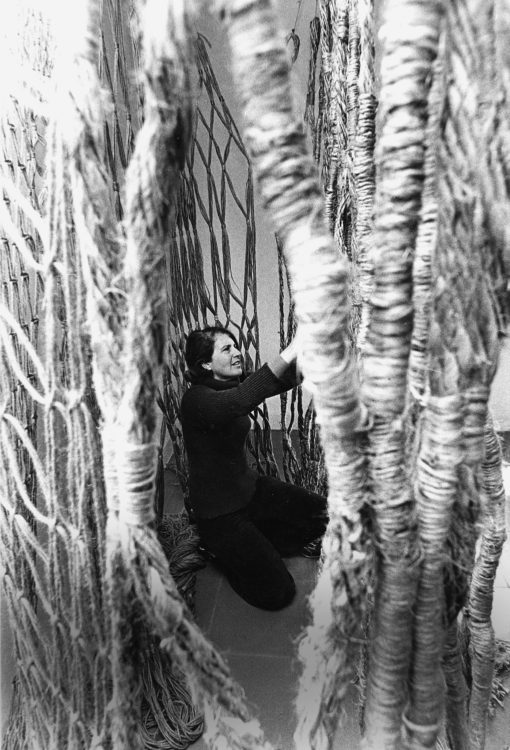
Aurèlia Muñoz
1944 | États-Unis

Harmony Hammond
1889 — Islande | 1966 — Danemark

Júlíana Sveinsdóttir
1964 | Chine

Qing Lu
1834 — 1910 | États-Unis

Harriet Powers
1970 | Brésil

Lídia Lisboa
1964 | Argentine

Nicola Costantino
1908 — 2000 | Turquie

Hripsimeh Sarkissian
1960 | Argentine

Mónica Millán
1897 — 1978 | Mexique

Lola Cueto
1949 — États-Unis | 2004 — Israël

Pamela Levy
1948 | Brésil

Sonia Gomes
1906 — 1985 | Canada
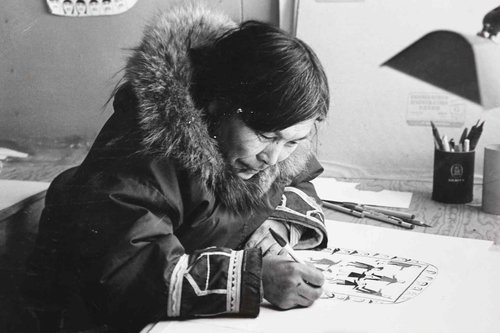
Jessie Oonark
1928 — 2017 | France

Pierrette Bloch
1958 | France

Cécile Bart
1930 — 1998 | Canada

Joyce Wieland
1964 | Martinique, France

Valérie John
1968 | Haïti

Myrlande Constant
1970 | Mexique

Natividad Amador
1970 | États-Unis

Teri Greeves
1967 | Ouzbékistan

Dilyara Kaipova
1965 | Pérou

Gaudencia Aquilina Yupari Quispe
1967 | États-Unis

Marie Watt
1945 — 2025 | Norvège

Elisabeth Astrup Haarr
1875 — 1949 | Japon
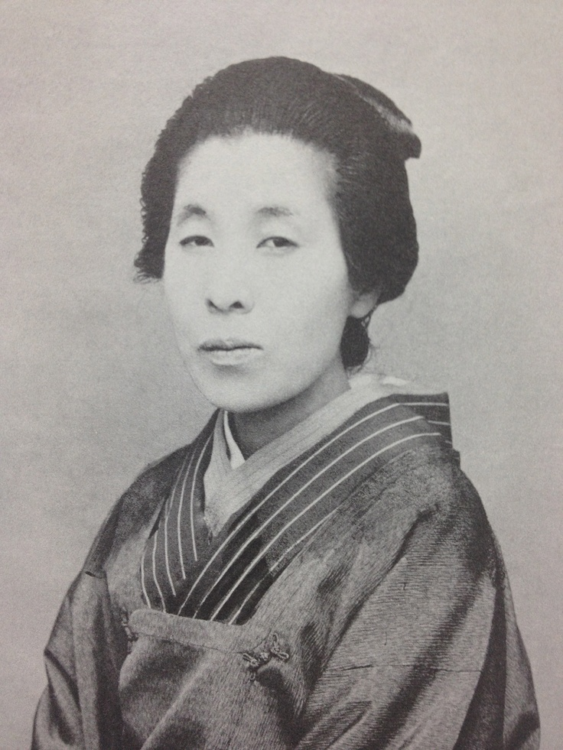
Shōen Uemura
1957 | Argentine

Claudia del Río
1940 | Sénégal

Younousse Seye
1755 — Grande-Bretagne | 1845 — Royaume-Uni

Mary Linwood
1966 | Afrique du Sud

Ntombephi « Induna » Ntobela
1965 — 2024 | Turquie

Gülçin Aksoy
1951 | Espagne

Teresa Lanceta
1973 | Ukraine

Oksana Briukhovetska
1855 — 1931 | Norvège

Frida Hansen
1908 — 2000 | Norvège

Synnøve Anker Aurdal
1974 | France

Karina Bisch
1932 | Kenya

Rebeka Njau
1903 — 1993 | Norvège

Else Christie Kielland
1974 | Algérie

Dalila Dalléas Bouzar
1948 | États-Unis

Joyce J. Scott
1961 | Palestine

Buthina Abu Milhem
1923 — Lituanie | 2019 — États-Unis

Aleksandra Kasuba
1924 — 1966 | Japon

Saori Akutagawa (Madokoro)
1943 — 2014 | États-Unis

Rosemary Mayer
1947 — 2023 | Malaisie

Fatimah Chik
1930 — 2023 | Indonésie

Siti Ruliyati
1965 — 1991 | Mexique

Elvira Palafox Herrán
1974 | Allemagne

Ulla von Brandenburg
1952 | Allemagne

Rosemarie Trockel
1872 — 1938 | Suisse

Alice Bailly
1962 | Pérou

Lastenia Canayo García (Pecón Quena)
1934 — 2023 | France

Marinette Cueco
1885 — Ukraine | 1979 — France
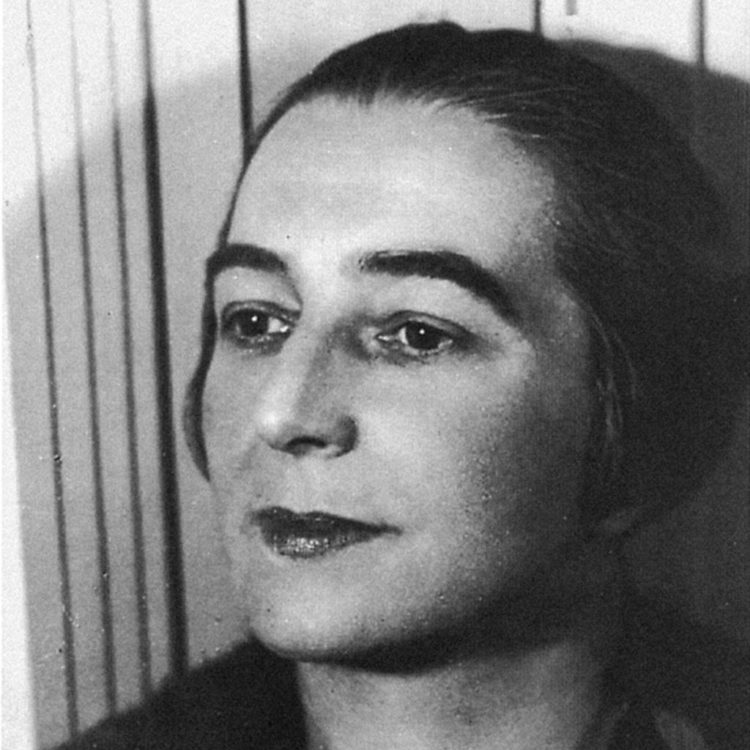
Sonia Delaunay
1924 — 2004 | Tunisie

Safia Farhat
1890 — 1957 | Hongrie
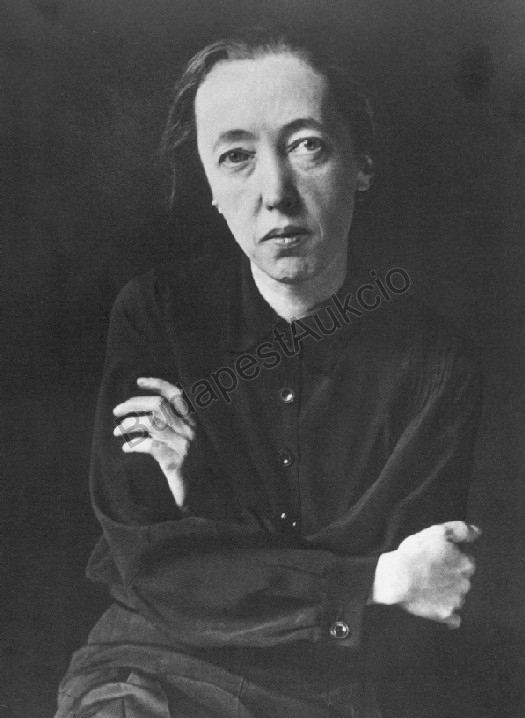
Noémi Ferenczy
1959 | Argentine

Mónica Giron
1957 | Inde

Sheela Gowda
1895 — Pologne | 1975 — France
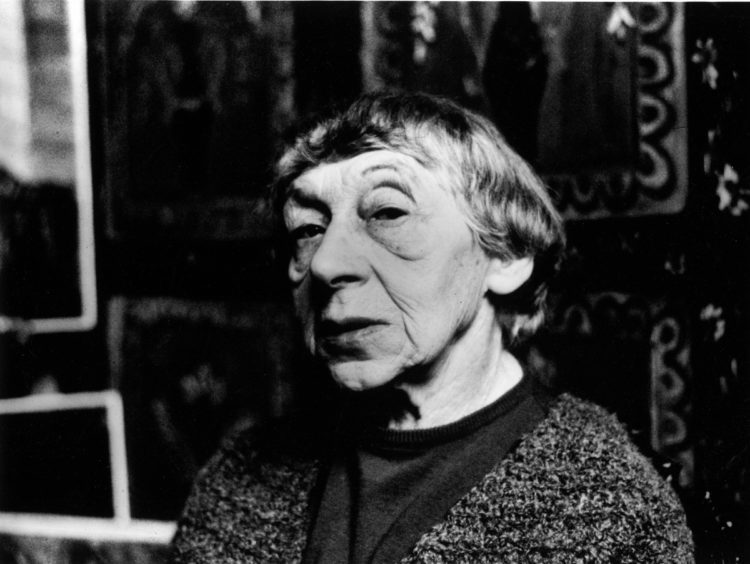
Alice Halicka
1945 | États-Unis
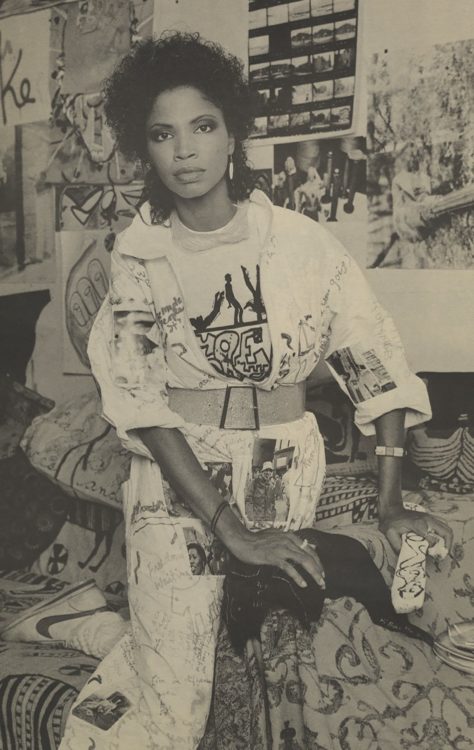
Candace Hill-Montgomery
1971 | Malaisie

Yee I-Lann
1936 — 1997 | Nigeria

Josephine Ifueko Omigie
1889 — 1970 | Pérou

Elena Izcue
1940 | Roumanie

Ana Lupaș
1949 — 2015 | Inde

Mrinalini Mukherjee
1927 — 2004 | Brésil

Lygia Pape
1971 | États-Unis

Shinique Smith
1953 — Pologne | 2020 — France

Teresa Tyszkiewicz
1876 — 1959 | Pays-Bas
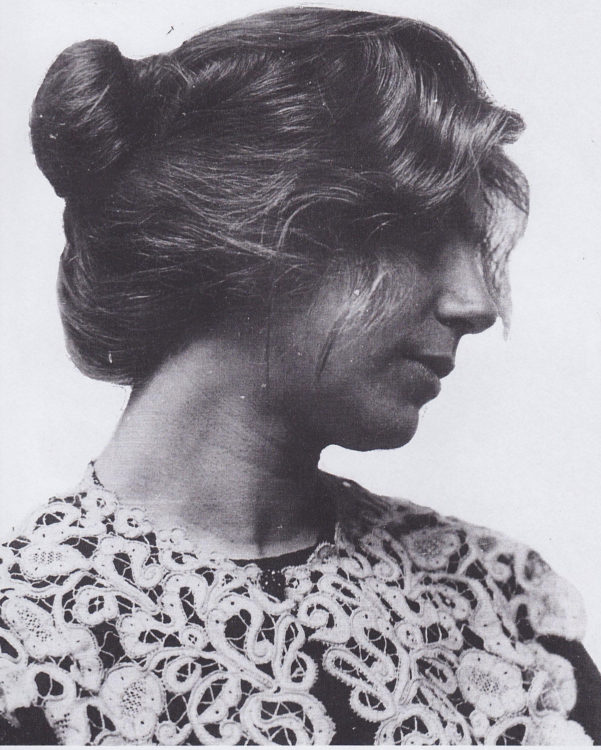
Adya Van Rees
? |

Céline Condorelli
1956 — 2020 | Madagascar

“Madame Zo” Zoarinivo Razakaratrimo
1971 | Ouzbékistan

Anna Ivanova
1946 | États-Unis

Nina Yankowitz
1974 | Guatemala

Sandra Monterroso
1847 — 1917 | Japon

Shohin Noguchi
1909 — Hongrie | 1990 — France

Klára Spinner, dite Claire Vasarely
1919 — royaume de Hongrie (actuelle République tchèque) | 1994 — France
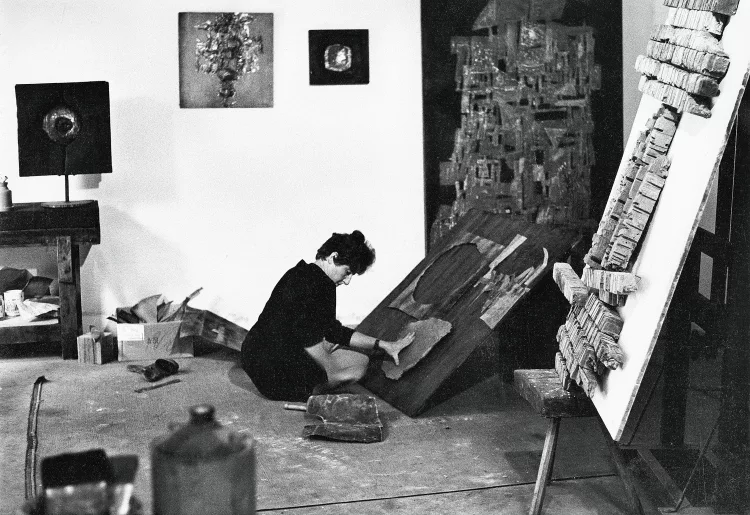
Vera Székely
1948 | Chili
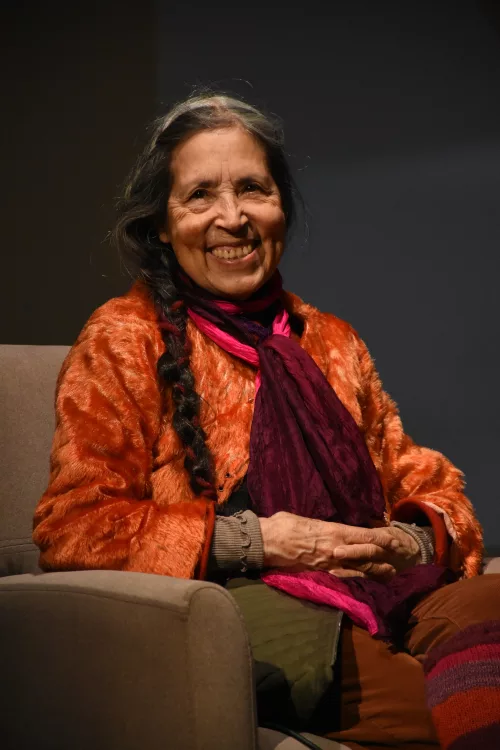
Cecilia Vicuña
1974 | Chili

Loreto Millalén Iturriaga
1934 — 2014 | Colombie

Marlene Hoffmann
1965 | Cambodge